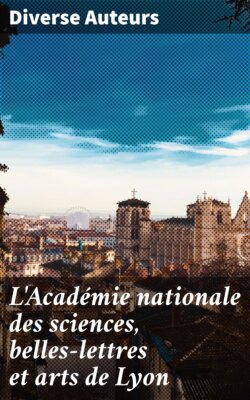Читать книгу L'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon - Diverse Auteurs - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LES FÊTES DU DEUXIÈME CENTENAIRE DE L’ACADÉMIE
ОглавлениеTable des matières
DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON
29 et 30 mai 1900
Lorsque, dans sa lettre du 10 avril 1700, Brossette annonçait à Boileau la fondation de l’Académie de Lyon, en lui faisant connaître qu’elle se composait seulement de sept membres, il est difficile de ne pas songer aussitôt à cette première ébauche d’Académie, connue sous le nom de Pléiade, que Baïf avait formée aussi, avec six de ses amis, au milieu du XVIe siècle.
Il est vrai que Brossette avait soin d’ajouter: «Nous avons cru qu’un plus grand nombre nous embarrasserait et pourrait nuire à la liberté dont nous voulons jouir.» Mais cela peut-il suffire pour écarter l’idée de toute influence rétrospective? Et ne doit-on pas supposer que, vis-à-vis de Boileau, Brossette a dû faire quelque réserve, pour éviter d’être accusé de présomption, en essayant de faire revivre un groupe littéraire qui a tenu une certaine place dans l’histoire de la littérature française? Toujours est-il que cette coïncidence méritait d’être signalée, et que le rapprochement s’impose forcément.
Quant à Brossette, il était loin de penser, sans doute, que sa lettre à Boileau allait devenir un document historique et que, seule, elle devait fixer la date de la fondation de l’Académie de Lyon, à une époque où la nouvelle Compagnie s’abstenait de tenir des procès-verbaux de «ses réunions familières», comme il les qualifie modestement.
Ce qui est certain aussi, c’est que jamais l’Académie n’avait oublié cette date mémorable de son histoire. Et si, en 1800, on ne la vit pas célébrer son premier centenaire, c’est que, d’abord, à cette époque, ce n’était guère l’usage Puis, si, après une suppression qui avait duré sept années entières, un arrêté du 24 messidor an VIII avait rétabli l’Académie, cet arrêté ne lui avait donné que le nom provisoire d’Athénée. Au lendemain de la Révolution, alors qu’un si grand nombre de ses membres avaient été victimes de la Terreur, la joie des survivants était loin d’être sans mélange; car on devait vivre plus avec l’espérance d’un meilleur avenir qu’avec les souvenirs douloureux d’un passé trop récent encore.
Mais à la veille du XXe siècle, il en était autrement. Dans les sciences, dans les lettres et dans les arts, le XIXe siècle tiendra une grande place dans l’histoire de la civilisation, et l’on pouvait fêter sans réserve, et non sans un orgueil légitime, le deuxième centenaire de l’Académie.
Mais, pour assurer le succès de cette fête et lui donner un éclat digne de la Compagnie, on comprit qu’il ne serait jamais trop tôt pour s’y préparer d’avance, et c’est ainsi que, dès le 21 juin 1898, fut nommée, au scrutin, une Commission de sept membres, chargée, avec le Bureau, de préparer, dans tout son ensemble, la solennité projetée.
Cette Commission fut composée de:
MM. Edouard Aynard,
Beaune,
Ollier,
Caillemer,
MM. Locard,
Rougier,
Morin-Pons.
En même temps, une sous-Commission, composée de MM. Morin-Pons, Bleton et Crolas, fut chargée spécialement des diverses questions de détail pour l’organisation de la fête.
La Commission, ainsi constituée, se réunit à plusieurs reprises, à compter du 24 avril 1899.
Dans sa première réunion, il fut décidé :
1° Que les fêtes du deuxième Centenaire comprendraient deux journées, inaugurées par un service religieux dans l’église primatiale, avec deux séances publiques et un banquet de clôture;
2° Qu’il serait publié, pour en conserver le souvenir, deux volumes: le premier, renfermant les comptes rendus des travaux de chaque section, précédés d’une notice sur les premiers temps de l’Académie, pendant que le second serait réservé à la publication des lectures faites dans les deux séances publiques et de divers travaux originaux.
Ce dernier volume est celui qui paraît actuellement.
Quant au volume des rapports, chaque section dut désigner son rapporteur.
Dans la classe des sciences, M. Leger fut chargé ainsi de présenter un rapport au nom de la section des mathématiques, mécanique et astronomie, physique et chimie.
Le rapport de la section des sciences naturelles, zoologie, botanique, minéralogie, géologie et économie rurale, fut confié à M. Locard, et celui sur les travaux de la section des sciences médicales, à M. Teissier.
Dans la classe des lettres, M. Bleton présenta le rapport de la section de littérature, éloquence et poésie; M. Pariset, celui de la section d’histoire et antiquités; M. Rougier, celui de la section de philosophie, morale, jurisprudence, économie politique, et enfin, M. Sainte-Marie Perrin celui de la section des beaux-arts.
M. Vachez, secrétaire général, fut chargé de l’introduction, dont les éléments devaient être empruntés soit à la correspondance de Brossette avec Boileau, soit à celle de l’un des fondateurs de l’Académie, le président Dugas, avec son parent Bottu de Saint-Fond, membre de l’Académie de Villefranche, avant de devenir membre de l’Académie de Lyon.
En même temps, M. Morin-Pons préparait généreusement, à ses frais, la publication d’un beau volume, orné de planches et consacré à la Numismatique de l’Académie.
Sans relâche et avec un soin attentif et infatigable, la Commission du Centenaire s’attacha à remplir la mission qui lui avait été confiée. Dès le 15 décembre 1899, elle décide que la date des deux jours de fête était fixée au 29 et au 30 mai 1900. Peu de jours après (27 décembre), M. Ollier qui, dans la séance du 5 décembre, venait d’être appelé aux fonctions de Président de la classe des sciences et, par cela même, chargé de présider les fêtes du Centenaire, annonçait que, sur sa demande, M. le Maire de Lyon avait mis gracieusement à la disposition de l’Académie la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, pour les deux réunions publiques du 29 et du 30 mai 1900.
En même temps, le Maire accordait à la Compagnie l’autorisation de se servir du coin de la médaille de l’Exposition de 1894, qui appartient à la ville, de sorte que l’Académie n’aurait ainsi qu’à s’entendre avec le graveur, Patey, pour la gravure du revers, qui porterait l’inscription suivante:
ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON DEUXIÈME CENTENAIRE
1700-1900
Cette médaille commémorative, en bronze et frappée à 150 exemplaires, était destinée à être distribuée à tous les membres de la Compagnie, titulaires, associés et correspondants, ainsi qu’aux Présidents des Sociétés savantes, invitées aux fêtes du Centenaire.
Il fut décidé, en outre, dans la même séance que, pour s’assurer le concours de personnages distingués, seraient nommés membres associés plusieurs savants, artistes ou littérateurs d’une grande notoriété et que des liens particuliers pouvaient rattacher à Lyon. C’est ainsi que, dans la séance de l’Académie du Ier mai 1900, furent élus membres associés:
MM. Bourget et Melchior de Vogüé, de l’Académie française;
MM. Camille Jordan, Ranvier, Bouchard, Violle et Guignard, de l’Académie des sciences;
MM. Revoil et de Meaux, déjà membres correspondants;
Et M. Bonvalot, explorateur.
En même temps, la Commission du Centenaire eut à dresser la liste des Sociétés savantes de la ville de Lyon et de la région lyonnaise, avec lesquelles l’Académie échange régulièrement ses publications, et dont les Présidents seraient invités à participer à la fête.
A Lyon, ce furent notamment la Société littéraire, la Société d’éducation, la Société de géographie, la Société académique d’architecture, la Société de médecine et la Société des sciences médicales.
Dans la région avoisinant Lyon, furent désignées notamment: l’Académie delphinale, la Société de statistique de Grenoble, la Société de la Diana, de Montbrison; la Société d’agriculture, industrie, sciences, arts et belles-lettres, de Saint-Etienne; l’Académie de Mâcon, la Société Eduenne, la Société d’histoire et d’archéologie de Chalon-sur-Saône; l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de la Savoie; la Société savoisienne d’histoire et d’archéologie; la Société d’archéologie et de statistique de la Drôme; la Société d’émulation de l’Ain; l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon; l’Académie et la Société d’émulation de Besançon, et quelques autres Compagnies de moindre importance.
En outre, la Commission choisit dans le monde des sciences et des lettres, et surtout dans le corps enseignant des deux Universités de Lyon, quelques personnes pouvant rehausser aussi par leur présence la solennité des fêtes projetées, en même temps que les principaux fonctionnaires de l’ordre judiciaire ou administratif, et les représentants des divers corps constitués.
Enfin, pour aider l’Académie à supporter une partie des dépenses de la solennité, une double subvention lui fut votée, sur sa demande, soit par le Conseil municipal, sur le rapport de M. Beauvisage, soit par le Conseil général, sur le rapport de M. Gourju.
A la suite de tous ces préparatifs, les fêtes du deuxième Centenaire eurent lieu à la date indiquée, d’après un programme arrêté d’avance.
Le mardi, 29 mai, à 9 heures, un service à la Primatiale, en mémoire des Académiciens défunts, annoncé en grande pompe par le bourdon de Saint-Jean, fut célébré par Son Eminence Monseigneur le cardinal Coullié, membre associé de l’Académie.
Après l’évangile, se tournant vers les membres de l’Académie et les invités, qui remplissaient le chœur de l’église, l’éminent prélat fait connaître d’un geste qu’il va parler, puis il prononce l’allocution suivante:
MESSIEURS,
Deux siècles se sont écoulés depuis la fondation de votre Compagnie. Pendant ce long espace de temps, les bouleversements ont succédé aux bouleversements, et l’histoire contemporaine nous raconte toutes les tentatives faites pour établir un ordre social sur des bases solides.
Etrangère à toutes ces agitations, l’Académie de Lyon est demeurée fidèle à ses traditions. Dans le sanctuaire des sciences, des lettres et des arts, elle a su former une famille intellectuelle et grouper des hommes éclairés, indépendants, dont les noms sont inscrits avec honneur dans votre Livre d’Or. Vous aurez occasion, en ces jours de fête, de réveiller leur souvenir.
Mais votre Académie ne saurait oublier qu’elle est lyonnaise; et, à ce titre, elle revendique sa part dans les glorieuses traditions d’une ville appelée justement la ville des martyrs et la Rome des Gaules. La pensée de Dieu demeure la pensée maîtresse de vos travaux et vous êtes heureux d’être les instruments de sa providence, en encourageant par vos largesses le travail et la vertu.
C’est cette pensée supérieure qui vous a conduits dans cette église primatiale, pour accomplir un devoir de charité fraternelle. Vous nous avez demandé de porter au saint autel le souvenir de vos confrères décédés. Votre foi vous a dit que ces frères disparus sont toujours vivants: «Vita mutatur, non tollitur.» Vous savez aussi qu’avant d’être fixée dans l’immortalité, notre âme doit, après cette vie d’épreuves, paraître devant la justice d’un Dieu trois fois saint qui, s’il récompense un verre d’eau froide donné en son nom, ne peut admettre en sa présence que les âmes purifiées. Vous savez enfin que, dans sa miséricorde infinie, ce Dieu bon a confié à son Eglise des trésors spirituels, mis à notre disposition pour acquitter les dettes de nos frères défunts.
Ces trésors, vous les demandez pour les membres de votre Compagnie; et puisque j’ai la consolation d’en être le dispensateur autorisé, je viens répondre à votre foi et présenter à Dieu toutes vos intentions dans ce sacrifice auguste, dont Jésus-Christ est le prêtre véritable et la victime.
Confiants, Messieurs, dans cette prière solennelle, redites dans vos cœurs les noms de ceux que vous avez aimés. Faites revivre le nécrologe complet de la Compagnie, et, grâce à vos prières unies aux mérites de Jésus-Christ, il y aura fête au ciel comme il y a fête sur la terre.
O Jésus, victime sainte, dont le sang est la rançon de nos âmes, bénissez la démarche de ces vaillants chrétiens, heureux, en cette circonstance, d’affirmer leur foi et leurs espérances; et, en accueillant dans votre Paradis les âmes pour lesquelles nous offrons le saint sacrifice, répandez sur cette Assemblée, sur les membres de l’Académie et sur leurs travaux les bénédictions les plus précieuses et les plus abondantes.
Amen!
Vivement touchés par ces paroles émues, qui leur allaient au cœur, tous les membres de l’Académie se rendent, à l’issue de la messe, au palais archiépiscopal, pour remercier Son Eminence de cet hommage délicat, rendu à la mémoire de ses membres défunts, dont les talents et les travaux ont valu à l’Académie la juste considération dont elle jouit aujourd’hui.
En quittant le palais archiépiscopal, l’Académie accompagne ses invités à l’église de Fourvière, où M. Sainte-Marie Perrin, architecte et membre de la Compagnie, qui a exécuté avec tant d’habileté les plans de son devancier, M. Bossan, leur explique dans quelles circonstances a été entreprise la construction de la superbe basilique, et les diverses particularités architectoniques du monument.
Le reste de la matinée est consacré à la visite des ruines de deux monuments intéressants de l’ancien Lugdunum. Ce sont d’abord, dans la rue du Juge-de-Paix et dans la propriété de M. Lafon, ancien président de l’Académie, les substructions dégagées de l’ancien amphithéâtre, où mourut sainte Blandine avec cinq autres martyrs de la persécution de l’an 177. Puis, un peu plus loin, à l’extrémité de la même rue, plusieurs arceaux très imposants et très solides encore de l’ancien aqueduc du mont Pilat.
A 2 heures, les musées d’Antiquités et des Beaux-Arts sont ouverts aux invités de l’Académie, qui peuvent, sous la direction des Conservateurs, admirer les objets les plus intéressants de ces riches collections.
A 4 heures, réception des fonctionnaires de la ville et des invités du dehors dans la salle Henri IV. On distribue aux membres associés ou correspondants, ainsi qu’aux présidents des Sociétés savantes qui assistent à la fête, le volume des rapports du deuxième centenaire de l’Académie, avec la médaille commémorative gravée par Patey.
Puis la séance publique, consacrée aux communications scientifiques, s’ouvre à 4 h. 30, dans la grande salle des fêtes, sous la présidence de M. Ollier, président de la classe des sciences.
Sur l’estrade réservée aux membres de l’Académie, figurent aussi M. le comte d’Haussonville et M. le vicomte de Vogué, de l’Académie française, puis MM: Chauveau, Camille Jordan et Bouchard, de l’Institut, et M. le vicomte de Meaux, ancien ministre, président de la Société de la Diana de Montbrison.
A l’ouverture de la séance, M. Ollier donne lecture d’un discours intitulé : Les deux premiers siècles de l’Académie de Lyon.
Après avoir remercié les membres illustres de l’Institut de France qui ont apporté à cette fête le fortifiant témoignage de leurs sympathies, il présente un tableau attachant des travaux de l’Académie pendant la période de deux siècles qui s’achève. Il rappelle que si, autrefois, la Compagnie jouissait d’une moindre notoriété dans le grand public, le monde savant, au contraire, prenait le plus vif intérêt à ses travaux. Les hommes les plus célèbres du XVIIIe siècle: Voltaire, Raynal, Buffon, Ducis, Thomas et bien d’autres, tenaient à lui être attachés à titre de membres associés. A ses concours, on vit un jour Daunou disputer le prix à un modeste lieutenant d’artillerie, qui devait devenir l’empereur Napoléon Bonaparte.
A cette époque, l’Académie ne se renferme pas seulement dans les travaux littéraires et l’étude des sciences de pure théorie; elle prend aussi une large part à toutes les découvertes d’un intérêt pratique et général. Personne n’ignore que les premiers essais de navigation à vapeur furent tentés, en 1783 sur la Saône, par le marquis de Jouffroy, sous les auspices et le contrôle de l’Académie.
L’année suivante, c’est encore avec le concours de la Compagnie, que Montgolfier, devenu l’un de ses membres associés, fait à Lyon l’une de ses premières ascensions en ballon.
Au commencement de ce siècle, apparaît, avec un éclat incomparable, le nom d’Ampère, dont la gloire rayonne aujourd’hui sur le monde entier, et dont l’immortelle découverte reçoit chaque jour quelque nouvelle application. Mais la gloire du grand savant ne saurait nous faire oublier que la période de 1840 jusqu’à ce jour comptera aussi parmi les plus beaux temps de l’histoire de l’Académie. Aussi ajoute-t-il en terminant: «Le troisième siècle de l’Académie s’ouvre sous d’heureux auspices, et si nos compatriotes veulent bien lui continuer leur concours et lui conserver leurs sympathies, elle prospérera par elle-même, vivra par ses propres forces et prouvera, une fois de plus, que Lyon est toujours un foyer ardent de culture intellectuelle, allumé depuis vingt siècles déjà et qui ne s’est jamais éteint.»
Ce beau discours, vivement applaudi, est suivi d’une communication du docteur Bouchard, de l’Académie des sciences, sous ce titre: Variation du poids des corps et glycogénie.
Au premier abord, ce travail purement scientifique peut paraître un peu ardu pour le plus grand nombre des auditeurs, car il s’adresse surtout à des savants et à des chimistes. Mais l’orateur en relève heureusement l’intérêt, en faisant ressortir l’importance pratique du sujet pour le traitement du diabète, maladie trop fréquente de nos jours.
C’est aussi par l’intérêt pratique de sa communication que M. Arloing, qui succède au précédent orateur, captive l’attention de l’Assemblée dans son travail intitulé : Un Épisode d’une crise récente de la bactériologie. Car la crise rappelée par l’orateur consiste dans l’exposé des mécomptes éprouvés dans l’emploi de la tuberculine pour le traitement de la tuberculose, et de l’importance du service rendu au diagnostic et à la thérapeutique par la séro-agglutination.
Le dernier orateur inscrit est M. Ernest Chantre, qui donne lecture d’une étude ethnographique et anthropométrique sur les Bicharieh et les Ababdeh, deux tribus de la famille nubienne, qui vivent dans cette vaste région déserte, entrecoupée de montagnes et d’oasis et située entre l’Egypte et l’Abyssinie.
Le soir du même jour, à 9 h. 1/2, une grande réception a lieu chez M. le président Ollier, où tous les invités des corps savants peuvent entrer en communication.
Le lendemain, 30 mai, à 10 heures du matin, les musées, les bibliothèques et les collections publiques sont de nouveau ouverts aux membres des Académies et des Sociétés savantes de la région, invités à la fête.
A 2 heures, le Musée des Tissus de la Chambre de commerce, au Palais de la Bourse, ouvre aussi ses portes aux invités, qui, sous la conduite et les indications du Directeur, peuvent faire une étude comparative intéressante des étoffes de toutes les époques, depuis les temps les plus reculés de la civilisation égyptienne, jusqu’aux produits les plus beaux de la Fabrique lyonnaise.
A 4 heures, réunion à l’Hôtel-de-Ville, salle Henri IV, comme la veille. Puis s’ouvre, dans la grande salle des Fêtes, sous la présidence de M. Beaune, président de la Classe des lettres, la seconde séance publique, où assistent, parmi les Académiciens, Monseigneur le cardinal Coullié, archevêque de Lyon, membre associé de l’Académie, et M. Costa de Beauregard, de l’Académie française, arrivé à Lyon, seulement la veille, dans la soirée.
Cette séance est consacrée à la lecture de travaux littéraires. Aussi l’assistance est-elle plus nombreuse que la veille, et c’est devant une salle comble que M. Beaune prononce un discours, dans lequel, après avoir souhaité de nouveau la bienvenue aux hôtes illustres de l’Académie de Lyon, il fait ressortir, dans un langage élevé, où les pensées délicates s’allient aux charmes de la forme la plus élégante, le but utile des Académies, réunions hospitalières où se rencontrent, sans se combattre, les opinions les plus diverses, et qui, aujourd’hui, sont appelées de plus en plus, grâce à la générosité d’hommes de bien, à récompenser d’humbles vertus et à soulager de grandes souffrances.
En ce qui la concerne, l’Académie de Lyon est demeurée un corps fidèle à ses traditions. Aussi constitue-t-elle, comme ses sœurs de province, une véritable force sociale, dont on trouve la plus haute expression dans cette glorieuse Académie française, dont trois membres éminents honorent de leur présence la solennité de cette fête.
Ce discours, vivement applaudi, est suivi de la communication d’un travail historique de M. le comte d’Haussonville sur un épisode de la guerre de la Succession d’Espagne: la trahison de Victor-Amédée. On sait qu’au cours de cette guerre, ce dernier, qui s’était attaché d’abord à la cause de la France, fut infidèle à sa parole, mais que Louis XIV prévint les effets de cette perfidie, en faisant désarmer les troupes savoyardes.
Mais à quelle époque précise se place cette trahison? Tel est le point qui était demeuré obscur, mais qu’à l’aide de nouveaux documents, l’orateur s’est attaché à éclaircir, en démontrant, avec une érudition et une sagacité peu communes, qu’on ne peut, comme on l’a fait quelquefois, attribuer la cause des revers de la campagne de 1701 à cette défection, dont Victor-Amédée ne se rendit coupable que dans le courant des deux années suivantes.
A la suite de cette lecture, M. le vicomte de Meaux communique un travail sur le Progrès des études historiques en France, au XIXe siècle, tableau plein d’aperçus curieux sur le caractère des œuvres des historiens contemporains.
Au XIXe siècle, fait remarquer l’orateur, trois hommes surtout ont, parmi nous, découvert le moyen âge: Guizot, Augustin Thierry et Michelet, et la connaissance du moyen âge a tourné, comme cela était inévitable, à l’avantage de l’Eglise catholique; car c’est alors qu’apparaît cette admirable phalange où figurent Ozanam, Montalembert, de Champagny et de Broglie.
Mais il fait observer aussi que le progrès de l’histoire de France, durant notre siècle, paraît devoir s’arrêter, d’un côté à la fin du moyen âge, et se reprendre, de l’autre, au début de la Révolution; d’où entre ces deux périodes, il reste une lacune de trois siècles à remplir, et qu’on ne pourra éclairer qu’à l’aide de fonds d’archives encore inexplorées.
M. Bleton, membre de l’Académie, termine la séance par la communication d’une étude littéraire, déjà lue dans la réunion de la Compagnie du 1er août 1899 et qui, à raison de son intérêt, avait été réservée pour l’une des séances publiques des fêtes du Centenaire.
Molière à Lyon. Tel est le sujet traité par l’orateur, qui rappelle que c’est à Lyon et dans l’ancien jeu de Paume du quartier Saint-Paul, que Molière, venu dans notre ville dès l’année 1652, joua pour la première fois l’Etourdi, qui ne fut imprimé seulement que dix ans plus tard. A la suite de cet heureux début, l’illustre comique se rendit, à plusieurs reprises, dans le Languedoc, avec sa troupe, pour revenir fréquemment à Lyon, où on le voit donner, notamment en 1657 et en 1658, des représentations en faveur des pauvres.
Or, l’intérêt que présentent ces souvenirs s’accroit encore aujourd’hui, où de prochains travaux vont transformer le vieux quartier de Saint-Paul. Ne conviendrait-il pas, en effet, de profiter de cette transformation, pour y élever un monument, destiné à rappeler le séjour de Molière à Lyon?
Cette seconde séance, où tous les orateurs ont été vivement applaudis, est suivie, dans les salons Monnier, place Bellecour, d’un banquet, où assistent plus de cent convives.
Au dessert, M. Marty, secrétaire général pour la police, qui remplace M. le Préfet absent, prend le premier la parole, pour rendre hommage aux hôtes illustres de l’Académie de Lyon, et à tous ceux qui, dans les sciences, les lettres et les arts ont contribué à donner à notre ville une renommée légitime.
M. Ollier se lève à son tour pour exprimer, d’abord, la juste satisfaction qu’il éprouve en présence du succès des fêtes du deuxième centenaire de l’Académie, et remercier ensuite, à la fois, les représentants de l’Institut et ceux de tous les corps savants, qui ont ajouté, par leur présence, à l’éclat de la solennité.
Puis, aux applaudissements unanimes de l’assistance, il annonce que M. Paul Rougier, ancien président de l’Académie, est nommé chevalier de la Légion d’honneur, et qu’à l’occasion du prochain Congrès des Sociétés savantes, MM. Armand-Calliat, Perrin et Horand seront nommés officiers de l’Instruction publique et MM. Leger et Tavernier, officiers d’Académie.
M. le vicomte de Vogué prend ensuite la parole:
Au nom de mes collègues de l’Académie française, dit-il, je remercie d’abord, de l’accueil si cordial que nous avons reçu, cette sœur, à peine moins âgée qu’elle, si vénérable et si aimable en même temps, malgré ses rivalités très justifiées, puisqu’elle a reçu des femmes dans son sein, ce que n’a jamais fait l’Académie française.
Quant à moi, je m’honore d’être à demi lyonnais; un Lyonnais de la banlieue, si vous voulez, car du haut de nos chères montagnes du Vivarais, le clocher de Fourvière nous apparaissait toujours comme le clocher de la grande ville; pour nous, les jeunes, c’était l’«Urbs». C’était là ma première ambition de jeune homme, et ma première Académie fut la grande école fondée à Oullins, par Lacordaire. Je me souviens même que je composai, un jour, et dès mon arrivée, une ode à la grande martyre d’alors, la Pologne, en 1863, ne prévoyant pas que, plus tard, ma vie serait consacrée presque tout entière à la diffusion de la littérature russe.
C’est aussi à Lyon que je venais m’initier aux beautés de l’art, dans vos musées, dans vos théâtres, où j’entendis, pour la première fois, l’Africaine, le chef-d’œuvre acclamé de ce temps déjà loin.
J’ai donc une part d’obligation envers votre laborieuse cité.
La vie, Messieurs, reçoit toutes ces impressions; nos esprits sont comme vos métiers à tisser, où la vie brode lentement les événements et en laisse la trace ineffaçable.
Nous souffrons tous d’une maladie bien propre à notre siècle: le cabotinage. Eh bien, je dois reconnaître que Lyon a conservé absolument l’immunité de cette maladie. Tous les grands Lyonnais, Ampère, Ballanche, Ozanam, Flandrin, Laprade, ont été des modestes, ennemis de la réclame tapageuse. Puvis de Chavannes étonna autant Paris par son désintéressement que par son génie. Même dans la politique, cet art si tentateur, vous avez su envoyer à nos Parlements des hommes dont le mérite égalait la modestie. Je n’en veux pour exemple que M. Aynard, à qui j’envoie d’ici un salut ému, après les grandes douleurs qu’il a éprouvées.
Oui, Lyon est la ville déconcertante par excellence, parce qu’elle a créé de grands génies, même ces humbles tisseurs, — je ne parle pas des frères Tisseur, de grands génies aussi que je salue — qui portent à tous les vents du ciel la gloire de Lyon.
Tout récemment, en visitant l’Exposition de l’art ornemental au Palais des Champs-Élysées, j’admirais l’œuvre de ces artisans modestes, tisserands, potiers, ciseleurs et autres, qui contribuent si magnifiquement à l’épanouissement de l’art français. L’impression que j’en avais ressentie, ces jours derniers, à l’Exposition, je l’ai retrouvée dans ma visite au Musée des tissus de Lyon, où rayonne dans tout son éclat l’art de la grande industrie lyonnaise.
Dans cette visite, il m’a été donné de juger ainsi des transformations successives de l’industrie qui fait la gloire de votre ville. Ce musée est un curieux chapitre d’histoire, l’un des plus révélateurs sur les révolutions du goût. Dans notre siècle seulement, chaque époque a laissé son empreinte sur ces soies chatoyantes; c’est pour chacune d’elles la poursuite obstinée et changeante de cette chose mobile, fugitive, insaisissable: le caprice de la femme. Eh bien, quand on voit comment vous luttez contre cet ennemi redoutable, on s’incline et on admire.
Et si, au cours de ces deux jours de fête, j’ai pu ainsi constater la haute place conquise par Lyon dans le monde de la pensée et de l’art, c’est encore justice, plus encore que courtoisie, de lever mon verre à la gloire, à la grandeur de Lyon, et après la petite patrie, à la France, notre patrie commune.
Cette magnifique improvisation, que nous ne pouvons reproduire ici que d’une manière trop imparfaite, a été applaudie avec enthousiasme par tous les assistants.
Puis au banquet a succédé un brillant concert, où l’on a entendu l’Harmonie Lyonnaise, qui a exécuté avec un grand succès une très belle cantate de circonstance: Lugdunum, beau poème de M. Gabriel Bleton, mis en musique par M. Amédée Reuchsel, ancien lauréat de l’Académie.
Tels furent, dans leur ensemble, les deux jours de fête du deuxième centenaire de l’Académie de Lyon. Leur succès surprit non seulement leurs organisateurs eux-mêmes, mais encore les membres de l’Institut, auxquels il inspira une plus haute idée de notre Compagnie.
Pourquoi faut-il qu’au moment où nous en retraçons le récit, un sentiment douloureux vienne se mêler aux souvenirs de réjouissance de cette solennité ?
Six mois plus tard, le 25 novembre, la mort frappait brusquement, au milieu des siens et dans toute la plénitude de ses facultés, celui qui, après l’avoir préparée avec tant de zèle, l’avait présidée avec un si grand éclat.
Les funérailles de M. Ollier, présidées par Son Éminence le cardinal Coullié, membre associé de l’Académie, eurent le caractère d’un vrai deuil public, et l’imposante manifestation de la foule immense qui suivit son cercueil, témoigna, au grand jour, de la grande place qu’il occupait dans notre cité.
Ce jour-là, il parut à tous que les fêtes du Centenaire avaient été comme le couronnement de sa brillante carrière, et l’apothéose de sa haute renommée.
Et ce qui le confirme, c’est que, par une coïncidence touchante, il avait, de sa propre main, inscrit au-dessus de sa signature, la date du 28 mai 1900, c’est-à-dire de la veille même des fêtes du Centenaire, sur le portrait qu’il a laissé à l’Académie, et qui, par un hommage pieux rendu à sa mémoire, a été reproduit en tête de ce volume, pour rappeler, plus tard, à ceux qui ne l’auront pas connu, les traits de l’un des plus grands chirurgiens du XIXe siècle.
A. VACHEZ,
Secrétaire général de la classe des Lettres.