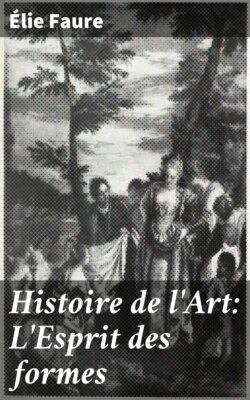Читать книгу Histoire de l'Art: L'Esprit des formes - Elie 1873-1937 Faure - Страница 11
VI
ОглавлениеJe sais pourtant des exceptions — dans le monde hellénolatin et dans la France même — au phénomène d’alternance rythmique qui marque l’évolution de l’art, par conséquent de l’esprit, par conséquent de l’histoire: l’architecture utilitaire des Romains, l’architecture civile française des XVIIe et XVIIIe siècles, toutes deux apparues sur un terrain social bouleversé alors même que le mythe ayant quitté les cœurs, l’individu se cherchait dans le désert de sa puissance. Quand apparaît la grande architecture romaine, la religion primitive a entraîné dans sa ruine l’aristocratie, et, pour contenir la plèbe à tout moment accrue, brassée, renouvelée par le reflux dans Rome des races, des cultes, des systèmes, des intérêts antagonistes, une tyrannie convulsive a remplacé le moule granitique où la constitution républicaine enfermait l’individu. Or, dans l’histoire entière de la construction, rien n’est plus pur, rien n’est plus fort, rien n’est plus catégorique que ces murs dépouillés qui suspendent dans l’espace les gradins, les arches, les voûtes, et répandent, jusqu’aux confins de la terre connue, l’esprit légalitaire et ordonnateur des Latins. Mais là, précisément, est la clé du mystère. Le mythe romain mort, tous les mondes anciens à faire entrer à la fois dans la cité latine à l’heure où leurs mythes propres agonisaient aussi ou s’ébauchaient confusément au sein d’une anarchie morale immense, un puissant organisme politique se constituait tant bien que mal, seul connaissant son but dans le chaos unanime et seul doué d’une science organisatrice capable de remédier à l’absence du lien social. L’administration, partout, a remplacé la religion. La loi morale, en s’effondrant, laisse le champ libre à la loi civile. Une ère d’attente s’ouvre, où l’armature artificielle imposée par le conquérant va souder les lambeaux spirituels d’un grand corps amorphe et, en lui révélant les besoins communs, préparer l’éclosion d’une confession commune. C’est sous les Antonins que le statut des provinces romaines atteint son organisation la plus robuste et que le Droit revêt le caractère du monument civil le plus solide de l’antiquité. Or, c’est sous les Antonins que les plus achevées et les plus imposantes constructions de Rome surgissent un peu partout, masses augustes, courbes continues, murailles géantes, matière dense, poids verticaux permettant des légèretés et des audaces de structure que seul le fer a pu depuis atteindre, ordre imposé par la formule intransigeante du légiste et de l’ingénieur . Constructions utilitaires, répondant à des besoins vulgaires, comme répond à des besoins vulgaires la loi écrite que la force, à défaut de la foi, impose. Mais parce qu’y répondant étroitement, sans une erreur, sans un oubli, sans une négligence, satisfaisant du même coup à des besoins spirituels qui rejoignent, par l’intermédiaire du nombre, les harmonies les plus émouvantes que le mythe ait inspirées.
C’était un système d’attente, une arche jetée entre deux mondes, sûre et hardie comme seule une arche peut l’être, parce qu’elle n’a pas le choix, ayant un fleuve à franchir, entre plusieurs solutions. Et peut-être assistons-nous, à notre époque qui rappelle à tant d’égards celle-là, — dissolution, interpénétration des mythes, reflux des races et des peuples les uns sur les autres, montée unanime des pauvres, vagues linéaments d’une mystique nouvelle — à un phénomène analogue. Peut-être, dans l’anarchie universelle, alors qu’a disparu l’architecture religieuse et que l’architecture civile divague, l’architecture industrielle est-elle aussi l’arche lancée entre deux mondes, substituant l’action du tuteur scientifique à l’action du mythe social effondré, comme le tuteur administratif et-juridique a jadis édifié, sur les ruines de ce mythe, son armature impitoyable. Peut-être ce tuteur moderne a-t-il été imaginé non seulement pour suppléer le mythe social dans la mesure où il assure les besoins matériels de l’homme, mais aussi pour satisfaire, comme jadis le tuteur romain, des besoins et des intérêts communs susceptibles d’acheminer l’homme à des croyances communes. Nous nous doutons à peine de ce que doit l’édifice catholique à l’esprit ordonnateur et régulateur des Romains. Savons-nous ce que l’organisme spirituel dont nous pressentons l’approche, devra aux enseignements continus de l’usine et de la machine, de l’avion, du vaisseau, de l’automobile, seuls monuments modernes qui ressemblent, par leur adaptation étroite aux fins nettes qu’on attend d’eux, leur précision tranchante, la beauté de leurs proportions, leur puissante l’gèreté, leur aspect de monstres vivants, aux constructions des ingénieurs de Rome? Comme elles utilitaires et seulement utilitaires, ne nous offrent-ils pas comme elles l’abri géométrique où nous pouvons goûter l’ivresse d’une réalité — et peut-être d’une croyance — en devenir?
Ce n’est pas tout à fait aux mêmes causes que l’architecture française classique a dû son apparition. Si le mythe social, ébranlé par la Renaissance, avait perdu l’ingénuité ardente d’où sortit l’art ogival, la monarchie réalisme maintenait dans les institutions politiques et religieuses un équilibre suffisant pour empêcher l’individu d’échapper à leur emprise. Le génie de la France est d’abord architectural. Elle tend à le transporter aussi bien dans sa peinture, sa philosophie, sa littérature, que dans ses édifices et ses jardins. Elle l’introduit dans la politique par son souci constant de réaliser l’État. Elle a tenté, par sa résistance au protestantisme, de le maintenir dans la religion. En même temps que Descartes, et à l’heure où la polyphonie plastique vénitienne prenait son droit de cité en Europe par Rubens, par Rembrandt, par Velazquez, Poussin négligeait un peu ses ressources pour transporter dans la peinture des rythmes monumentaux. Depuis cent cinquante ans, la France, égarée par la brusque entrée de l’Italie, était à la recherche de cette faculté puissante qui lui avait permis d’écrire, durant près de quatre siècles, le poème de pierre le plus soutenu de l’Occidènt. Elle avait essayé d’une architecture hybride, où l’anémie profuse du décor gothique noyait le profil italien déjà bien compromis lui-même par la poussée d’individualisme qui substituait dans la péninsule à la même époque la grande peinture symphonique à la simplicité tranchante de la construction. Elle n’avait pas encore assimilé, ni même vraiment regardé cette grande peinture, gardant par ses corporations et ses luttes religieuses assez d’élan et de passion sociale pour conserver le désir angoissé de l’architecture, mais possédant déjà des individus assez définis pour l’empêcher d’aboutir.
.
Cl. Anderson.
ARCHITECTURE UTILITAIRE (Rome.)
La double action de la monarchie et du cartésianisme vint combattre à temps cette individuation progressive par la centralisation sur le terrain politique et la méthode sur le terrain spéculatif. Elle allait retarder la dissociation définitive en substituant à la mystique collective abolie une construction intellectuelle ingénieuse mais peu durable, la raison devant trop vite aboutir au rationalisme, comme la foi, en d’autres temps, aboutit au dogmatisme. Malgré tout, le frein fonctionna avec une puissance unique dans l’histoire de l’esprit. Après le roman, après le gothique, vint un troisième ordre complet . Les pilastres nus alternant régulièrement avec les fenêtres rectangulaires, les verticales et les horizontales ramenant, par leur jeu rythmique et mesuré, l’édifice civil à l’échelle de l’intelligence, substituèrent pendant près de deux siècles, pour la joie de la raison pratique, les déductions rectilignes de la plus haute culture aux axiomes symétriques de la plus haute théologie et aux intuitions rayonnantes du plus haut équilibre qui fut jamais entre la ferveur populaire et le système social. Les jardins, les routes, les ponts, la tragédie, la comédie, la musique, la morale, la sculpture, la peinture, tout obéit en même temps à ce besoin de subordination des sensibilités et des passions aux cadences de la volonté. Je ne sais quel demi-anonymat y règne, pour donner à ce temps un peu du caractère de ceux où l’individu est complètement effacé. Les statues des allées, des bassins de Versailles, les colonnades, les arbres, les architectures d’eau paraissent, au premier abord, être de la même main. Une unité froide, mais sévère et magnanime, et dont les éléments manquent de saillies et d’accents, contraint à ne pas distinguer ces éléments de l’ensemble, à ne pas songer qu’ils puissent exprimer les aspirations, les inquiétudes, les tourments d’un seul esprit. On retrouve dans l’alexandrin, les trois unités, l’organisation bureaucratique entière, les académies, l’école de Rome, la même impersonnalité. Si l’architecture ecclésiastique repousse le calvinisme, le jansénisme représente, au sein de l’Eglise, une réaction morale constructive contre la dissociation psychologique que le jésuite poursuit. Nul, en ce temps, ne prend au sérieux La Fontaine. Pascal choque. On ignore les Le Nain. Tout cet ordre mène la France, et le monde derrière elle, en titubant quelque peu, en amincissant de jour en jour les murs, les supports, la matière, l’idée, le verbe, et par la pente naturelle d’une logique impitoyable, jusqu’à la Révolution. Mais quand le sentimentalisme de Rousseau a brisé le cartésianisme, quand l’individualisme de Voltaire a brisé la corporation, il n’y a plus une seule force, ni sociale ni spirituelle, qui soit capable de contraindre et de contenir l’individu. Il se rue à la découverte intégrale de lui-même, avec une fureur d’autant moins dissimulée que, malgré Watteau , à demi Flamand, il retarde de près de trois cents ans sur les peintres de Venise, de près de deux cents ans sur les peintres des Pays-Bas ou d’Espagne, de près de cent ans sur les musiciens allemands. La peinture romantique réalise en France, avec une ivresse splendide et des éléments nouveaux de drame, de pittoresque, d’émotion, la symphonie individuelle d’un seul coup . Mais c’est au détriment de l’architecture, gloire et soutien de ce pays depuis huit siècles, qui s’effondre aussi d’un seul coup.
.
Limousin et Cie (Freyssinet, ing.).
ARCHITECTURE INDUSTRIELLE (France, Saint-Pierre-du-Vauvray.)
.
Cl. M. H.
ARCHITECTURE RATIONALISTE (France XVIIe s.)
Catastrophe double, et grandiose, amenant, par une marche inverse, le corps social tout au fond de l’abîme, l’individu d’élite au sommet de l’esprit. On saisit ici sur le fait l’écartèlement que l’émancipation de l’homme inflige à la société en brisant l’organisme qu’exprime l’architecture, et aussi l’oppression qu’inflige cet organisme à l’homme en lui interdisant l’accès de l’unité miraculeuse que la polyphonie seule peut lui conquérir... Je ne sais pas de plus saisissant témoignage de la puissance et de la cruauté du mythe, et en même temps de la grandeur solitaire et de l’impuissance du héros.