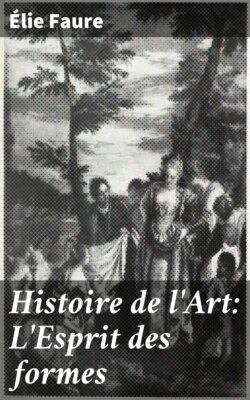Читать книгу Histoire de l'Art: L'Esprit des formes - Elie 1873-1937 Faure - Страница 7
II
ОглавлениеSi cette ébauche vous semble un peu trop schématique, imaginez l’évolution d’une statue grecque qui serait née vers le milieu du VIIe siècle pour arriver au terme de sa croissance vers le milieu du IIIe, soit pendant quatre cents ans. Et suivez du même regard la marche du corps politique qui vous livrera, si les formes ont quelque logique, la signification du rythme auquel elle doit obéir.
.
Cl. Alinari.
GRÈCE (Seconde moitié VIe s.)
FIG. 9.
Cl. Houvet.
FRANCE (Seconde moitié XIIe s.)
Dans la société hellénique telle que nous la connaissons, vers le VIIIe siècle de l’ère ancienne, par exemple, le mythe règne sans conteste. Il atteint même sa phase de pleine cristallisation. Il est, pour les hommes de la tribu, l’unique raison de naître, d’aimer, de souffrir, de mourir. Commune, universellement admise, du moins dans la même tribu, la croyance ne laisse au doute aucune prise. Certes, Dieu n’est pas un. Il est au contraire multiple. Mais la croyance est une. Et c’est cela qui est divin. C’est sur cette croyance seule que repose le principe moral unitaire sans qui ni la cité ni la famille ne seraient. Le mariage est saint, donc indissoluble. Le célibat interdit. Moralement, l’enfant n’existe qu’en fonction du père, qui lui-même n’existe qu’en fonction des ancêtres morts dont les sépultures sanctifient — et même légitiment — la propriété. Non seulement l’individu n’existe pas, mais son existence serait contraire à la conception même du foyer qui est peut-être le noyau, peut-être la contraction de la cité , en tout cas fait avec elle un organisme indissoluble dont rien, sans ruiner l’une ou l’autre, ne saurait être retranché. La liberté de l’être humain n’est ni conçue, ni concevable hors le groupement familial qui ne conçoit pas non plus la sienne hors de son enclos et de ses dieux, le groupement familial voisin la limitant de toute part. La société humaine entière plonge dans la divinité diffuse de la nature personnifiée par les dieux qui la rattachent à elle par les mille liens du rite où la loi prend son appui. La sainteté du sol est une réalité d’autant plus inexorable qu’elle représente un style spirituel plus menacé par la tribu rivale, et plus difficile à maintenir. L’univers moral est un bloc.
Or, à ce moment-là, la Xoana, l’idole primitive taillée dans du bois d’olivier, n’est qu’un embryon presque informe, une poupée pauvrement équarrie où les formes sont indiquées par le procédé symbolique de l’enfant qui dessine sans regarder et fait un grand rectangle pour le corps, un rectangle plus petit pour la tête, deux rectangles plus étroits et plus allongés pour les bras . Elle est, aux statues du siècle suivant, ce que sont aux plus vieux sanctuaires de marbre ces maisons de paysan qu’on voit encore de nos jours dans certaines campagnes grecques: quatre poteaux verticaux qui deviendront le péristyle, quatre poteaux horizontaux qui deviendront l’architrave . Elle satisfait au plus fruste des besoins spirituels, comme cette cabane au plus fruste des besoins matériels. Presque aucune différenciation n’existe encore, dans l’esprit de qui les a faites, entre les éléments naturels que l’une et l’autre utilisent pour la croyance ou l’abri et le sens de cette croyance et le confort de cet abri. La gangue qui l’étreint, c’est la croyance commune. Les membres en sont prisonniers, comme l’individu du principe social dont il n’ose, et ne peut, et ne veut pas s’affranchir, dont il ne songe même pas à s’affranchir, parce que cet affranchissement prématuré entraînerait tout de suite sa perte. Il ignore les rapports qui le rivent à ce principe, le régime des castes les lui imposant pour son bien. La société, comme l’idole, est impersonnelle, figée, pour ainsi dire symétrique. Les écrivains du temps sont des légistes que l’esprit des dieux inspire quand ils psalmodient, en prose rythmée, les versets de la sainte loi.
Un demi-siècle. Grâce aux frictions des familles entre elles, la famille, encore aussi ferme, est pourtant devenue moins rigide que la cité. Elle lui infuse une vie de plus en plus organique. La multiplication des cellules sociales élargit leur horizon, cependaut qu’une aristocratie étayée sur une morale intacte, et croyante dans l’intérêt de sa propre conservation, rappelle le ciseau qui tranche dans le marbre les plans les plus sommaires et les plus rigides profils. L’idole est devenue plus dense. Elle tend vaguement à la forme circulaire, comme pour assouvir un besoin primitif de continuité et d’unité. Un instinct architectonique aussi confus qu’essentiel s’affirme dans les bras pendants, les jambes parallèles, les épaules horizontales, le torse presque conique où les têtes des os et les masses musculaires ondulent déjà faiblement, tout un ensemble raide et dur dont les éléments symétriques accusent le souci d’un rythme élémentaire comme de deux pieds frappant en cadence le sol ou de deux mains se heurtant l’une l’autre à intervalles réguliers . Aucune individualité. Bien qu’on la dise tel athlète, elle est un monument impersonnel qui représente n’importe quel athlète, m’importe quel homme nu. Elle n’offre avec la statue ionienne, qui vient des îles de l’Egée à sa rencontre vers le même temps, qu’une différence de qualité ethnique, l’esprit restant le même et dégageant des rapports identiques des mêmes éléments interrogés. Les statues doriques sont des hommes, les statues ioniques sont des femmes, celles-là dures, tout d’une pièce, celles-ci sensuelles, équivoques, soumises à des plans plus furtifs, avec une tendance à la sphéricité plus insinuante, des membres plus emprisonnés . Mais, ici comme là, c’est toujours de l’architecture: rien ne sort, rien ne peut sortir de ce cylindre vertical où tous les mouvements et toutes les saillies se perdent, comme les nœuds de l’arbre, avant la naissance des branches, dans la masse du tronc rugueux. Serrée, tendue, gonflée dans cette gaine, la vie profonde y prend un caractère engourdi, somnolent encore, mais d’une impressionnante et irréductible unité.
FIG. 10.
Cl. Alinari.
GRÈCE (Première moitié Ve s.)
Un demi - siècle. L’antagonisme croissant des intérêts, les abus de l’aristocratie créent dans les masses populaires des courants sourds, qui secouent l’édifice faiblement d’abord, mais assez pour y éveiller des besoins nouveaux, des idées nouvelles. Si la solidité des castes semble encore inébranlée et peut paraître même accrue, car elles sentent menacée leur intégrité première, leur hermétisme est moins complet. Voici les héros, les chevaux de Delphes, les Cariatides de Cnide, les Orantes du vieux Parthénon. Dans ces statues émouvantes, où le mâle dorien et la femelle ionienne s’observent, mais refusent de s’unir, le plan s’affirme, dès l’abord, comme une idée plus définie, un peu moins noyée dans l’ensemble, parcouru d’un large frisson. Il s’efforce de sortir d’une formule architectonique anonyme pour édifier, dans l’argile qu’il sculpte, une idole autonome bougeant un peu, un étrange sourire aux lèvres, un pied ou un bras en avant. Le passage, encore rugueux, anime un peu les profils, fait onduler sourdement les surfaces. L’équilibre des masses s’ébauche, succédant à leur symétrie, et c’est au mouvement des puissances profondes parcourant la forme en dedans que les plans doivent leur vigueur . Le cylindre est vivant, les nœuds et les bourgeons affleurent, les branches vont pousser du tronc. Les écrivains du temps sont des poètes philosophes qui créent un système du monde, un appareil monumental à peine ébauché, mais grandiose et circulaire, qui émerge péniblement du mythe sans vouloir ni pouvoir se séparer de lui. En pensée, en politique, comme dans l’idole elle-même, l’individu s’esquisse dans quelques cerveaux monstrueux.
.
Cl. Houvet.
FRANCE (Première moitié
du XIIIe s.)
Un demi-siècle. Par tribus, par partis, par classes, des groupes ardents s’organisent, encore raides, presque mécaniques, où, si l’instinct des intérêts et des besoins antagonistes s’affirme déjà puissant, les consciences individuelles de chacun de leurs éléments ne savent pas encore se définir. Le drame naît sur le théâtre parce qu’il naît dans le corps social. Si Eschyle fait peser sur l’homme les lois impitoyables de la coutume et du destin, une lueur grandit en lui, dont Prométhée a pris à Dieu l’étincelle animatrice. C’est elle, désormais, qui constitue le centre unique autour duquel, dans l’idole de ce temps-là, les masses gravitent, comme s’il s’agissait pour l’homme qui tente de se définir, de ne pas quitter encore le cercle profondément creusé autour de son action par les ancêtres, afin qu’il puisse approfondir et unifier cette action. Rude encore, mais moins tendu, le plan recueille la lumière qui l’unit aux plans voisins par des passages saccadés, mais continus, et de toutes parts orientés à construire, ou plutôt à suggérer la même surface tournante. On voit l’Aurige et les guerriers d’Egine émerger du moule uniforme dont la rondeur presque absolue enfermait leurs mouvements . Dégagée de l’architecture, monument complet elle-même, pleine, définie, circulaire, la statue trouve ses rapports avec la vie universelle et reconnaît sa place au milieu de tout ce qui est. Le mythe est presque intact encore, mais son sens symbolique affleure aux cimes de l’esprit.
.
Cl. Giraudon.
GRÈCE (Première moitié Ve s.)
FIG. 13.
Cl. Houvet.
FRANCE (Première moitié XIIIe s.)
Un demi-siècle. Et nous touchons au point d’oscillation suprême où, dans un instant imperceptible et peut-être irréalisé, à mi-chemin de la sculpture qui raconte, aux frontons d’Olympie, la lutte antithétique entre les puissances de l’âme et les puissances de l’instinct, et des frontons déjà moins poignants de Phidias, l’hellénisme va définir le drame moral essentiel qui justifie l’existence de l’homme. Le choix s’impose à lui, un choix décisif. L’enivrement d’appartenir à un corps social cohérent qui oriente tous ses gestes, à une croyance commune qui lui indique sûrement ceux qui plaisent aux dieux et ceux qui ne leur plaisent pas, de provoquer, par tous ses actes, l’approbation unanime des morts, et d’autre part le désir d’explorer les nouvelles régions morales que la curiosité, l’intérêt, un désir vague mais ardent allume et développe dans son âme, son âme à lui, cet être personnel et sans doute unique dont les exigences s’accroissent, sont en présence dans son cœur. Entre les partis politiques à peu près d’égale force, une lutte incertaine et furieuse commence, marquée par des victoires, des défaites alternatives, parfois un accord d’une heure qu’impose un puissant esprit. La famille, solide encore, est devenue le foyer d’une autre lutte, plus sourde, où la personnalité des enfants, des femmes, qui grandit en conscience, en appétits, en dignité, ne trouvera plus ses limites que si la dignité, et la conscience, et les appétits de son chef demeurent dans le cadre de ses devoirs et de ses droits. La poursuite de la richesse, des jouissances et des honneurs publics qui s’y attachent, développent le caractère, l’audace, l’adresse, la fourberie de l’homme qui la veut. Le pouvoir de résoudre ces conflits universels qui appartient dans la famille au père, et au maître dans la cité, trouve son expression dans la fermeté héroïque qui permet à Sophocle d’introduire, face à l’ivresse confuse de la vieille unité morale représentée par le chœur, la volonté de l’homme noble où l’intelligence s’éveille pour combattre l’univers fatidique tout entier ligué contre lui, comme elle permet au sculpteur de la même époque d’établir, entre les masses contrastées et les gestes antagonistes, un équilibre victorieux du désordre et du chaos qui les force à rentrer dans un même ensemble et à les lancer du même élan dans un mouvement continu. La statue, où le mâle dorien et la femme d’Ionie se pénètrent dans une étreinte que la souplesse de Myron et la vigueur de Polyclète nouent et dénouent tour à tour, agit, marche, combat, repose dans une auguste liberté. Elle n’est plus seulement architecture par elle-même. Elle entre, avec ses voisines, dans un organisme plus complexe, ondulations monumentales combinées où les formes, pourtant séparées, réalisent, par leur succession, une mélodie plastique dont les courbes se balancent . C’est comme les rameaux déployés du même arbre — hier l’Aurige — qui se tordent et s’enchevêtrent, mais que la sève parcourt jusqu’à leur extrémité. On retrouve, dans la statue, toute l’harmonie de l’ensemble qui lui-même emprunte à la statue la loi de son autonomie. Ce sont des plans larges et nus dont toute la surface vibre, de longs passages silencieux qui les unissent et les animent dans un bercement sans fin. La poursuite ininterrompue des grandes houles expressives s’exerce avec l’énergie même qui lance le sang dans les veines et bande les aponévroses et les muscles sous la peau. La flamme spirituelle court dans les intervalles de silence, pour solidariser les formes d’un bout à l’autre du fronton.
.
Cl. Buloz.
GRÈCE (Milieu Ve s.)
A cet instant, et de haut et de loin, si on se refuse à voir les accidents de la route, une harmonie puissante règne. Les partis sont animés d’une vie telle que leur nécessité respective s’engendre réciproquement. L’homme est face à face avec l’homme. Il appartient avec lui à une société dont le principe est accepté de tous si ses antagonismes et ses contradictions se vivent. Le plan, dans la technique sculpturale, n’est que la persistance nécessaire des lois religieuses et sociales que l’éveil décisif de la conscience individuelle unit au plan voisin par l’ondulation du passage et la ligne du profil. La tragédie et la sculpture vivent dans la forme harmonique de leurs éléments contrastés parce que, si l’homme s’affirme, le dieu n’a pas quitté l’homme et se confronte à lui par l’instinct et la conscience, par la sensualité et la raison, par l’idée et la réalité dans le cœur même du héros.
Un demi-siècle encore. Et voici l’homme libre, tout au moins de se définir. Il l’a voulu. Il n’a pas le droit de se plaindre si progressivement le doute, l’inquiétude, l’angoisse l’envahissent à mesure que la famille se disloque, que la loi fléchit ou change, que la cité devient tantôt trop indulgente, tantôt trop exigeante à son égard, que les mythes sont discutés et que le besoin de jouir grandit avec l’oisiveté, le célibat, la fortune, l’introduction au foyer de femmes étrangères, l’introduction sur l’agora d’esclaves affranchis, de métèques naturalisés, l’introduction dans l’esprit, qui s’effémine et se complique, d’idées, d’images inconnues inventées par les philosophes, importées par les voyageurs. Les grandes synthèses cosmiques sont oubliées ou négligées, l’homme étant rentré en lui-même et y entraînant avec lui le dieu diffus qui hier peuplait le monde et vivait sous tous ses visages où le poète primitif les cherchait ingénument. Au légiste a succédé le moraliste, au théologien le psychologue, au philosophe le sophiste. Euripide, sur le théâtre, oublie ou provoque les dieux, fouille l’être réel pour lui ravir son secret. Socrate prétend apprendre à l’homme à se connaître et n’aperçoit rien dans le monde, hors de cette connaissance, qui le puisse intéresser. Aristophane a beau livrer Socrate et Euripide aux rires de la foule, il marche du même pas qu’eux, puisque la critique sociale monte sur les planches avec lui. La dialectique de Platon ramène à l’intérieur de l’être le principe de l’unité. Ce n’est pas par hasard que la démocratie triomphe à cause du besoin croissant d’égalité politique dont le citoyen émancipé réclame l’assouvissement. Voici que devient tyrannique l’arme qu’il a réclamée — pénétration des projets et des intérêts d’autrui, ruse pour les déjouer, attention toujours en éveil pour profiter des circonstances, pour provoquer le drame ou en tirer parti, esprit critique grandissant aux dépens de l’intelligence constructive — et qu’elle isole de l’ensemble l’objet poursuivi et traqué avec une attention trop méticuleuse et le souci trop mesquin du détail. L’enquête d’Aristote disperse à l’infini l’observation la connaissance, le caractère de cet objet. Ce n’est pas non plus par hasard qu’il est le contemporain de Lysippe et que la science anatomique, qu’il fonde, apparaît à l’heure même où le modelé musculaire se substitue peu à peu au plan architectural.
.
Cl. Houvet.
FRANCE (Milieu XIIIe s.)
.
Cl. Anderson.
GRÈCE (Fin_Ve s.)
Non seulement, en ce temps-là, la statue est dégagée de la gangue originelle, mais elle oublie que cette gangue fut. L’inquiétude obstinée, la sensualité l’environnent. Considérée, puis caressée avec un amour insistant, elle laisse tomber les voiles qui faisaient couler sur elle des transparences et des méandres de ruisseaux . La forme gagne en sensibilité ce qu’elle perd en énergie. En outre, la statue qui, un siècle plus tôt, ayant ramassé sa puissance, aspirait à se plonger dans les groupes décoratifs, aspire à s’en isoler de nouveau et n’y reste qu’à contre-cœur. Individualisée, elle s’essaie aux gestes inédits, aux attitudes pensives. Au risque de la disloquer, ses éléments constitutifs étudient leur propre structure. Elle ne tardera pas à rencontrer Praxitèle qui éveillera tendrement en elle les centres de la volupté. Après lui le passage psychologique va profiter de l’hésitation du plan et du flottement du profil pour empiéter sur leur domaine, brouiller, dans un confusionisme grandissant, les rapports essentiels et simples qu’ils révélèrent dans l’objet, et par là s’éloigner des contacts vivifiants de cet objet avec le monde. L’individu n’est plus fonction du monde. C’est le monde qui devient fonction de l’individu. Et comme l’individu n’est pas forcément un démiurge, il ne va plus réinventer le monde qu’au hasard de ses impulsions.
FIG. 17.
Cl. Giraudon
FRANCE (Fin XIIIe s.)
.
Cl. Alinari.
GRÈCE (Première moitié IVe s.)
Un demi-siècle plus tard, on saisira facilement les causes sociales profondes de la dernière étape de l’esprit. Les mythes, effondrés, ne soulèvent plus guère, hors les tout à fait humbles gens, que des révoltes, ou des risées. Les stoïciens et les cyniques poussent logiquement, en sens opposé, les tendances morales de l’homme jusqu’aux impasses spirituelles d’où il ne pourra s’évader qu’en renouvelant sa mystique. Tantôt sensuels, tantôt abstraits, les cultes de l’Est s’insinuent pour se substituer partout à la religion locale, écartelant chaque jour un peu plus l’ancienne unité de l’esprit. La croyance en l’égalité que tous proclament, en le disant ou sans le dire, puisque l’homme est l’égal de l’homme dès qu’il se considère comme gravitant exclusivement autour de l’un de ses deux pôles, — soit ses instincts dans leur bestialité la plus intransigeante, soit son esprit dans sa pureté idéale dégagée de tout lien charnel —, s’exaspère en raison directe de l’inégalité croissante des conditions. L’individu veut avoir raison contre la cité, contre la famille, bientôt contre l’individu. Son propre individualisme le désagrège peu à peu. L’idole est maintenant une image fantaisiste que le génie d’un isolé peut rendre fréquemment vivante, mais que la diffusion du métier et la vulgarisation de la culture condamnent le plus souvent à n’exprimer que les soucis médiocres de l’anecdote et de la mode aimés des âmes «libérées » cherchant à y tromper leur inquiétude, à y satisfaire leur niaiserie, à y frotter leur suffisance, à y guérir leur ennui.
FIG. 19.
Cl. Giraudon.
FRANCE (Première moitié XIVe s.)
La statue jouit désormais d’une indépendance égoïste qui vient accroître son tourment. Trop isolée, maintenant, elle appelle à son secours les éléments pittoresques. Son geste commence à briser le cercle idéal dans lequel elle s’inscrivait naguère presque machinalement. Le passage inonde le plan qui s’aveulit, hésite, contient mal la vie intérieure éparpillée dans le détail. L’étoffe drapée en tous sens en masque l’insuffisance . Le pinceau de l’ombre joue sur lui, l’efface, le rend équivoque ou menteur. Une ondulation imprécise enveloppe, comme une brume, la structure intérieure qui se dissimule et fléchit. Des parallélismes trop étroits, ou bien des mouvements trop excentriques raidissent ou désorbitent l’ensemble monumental. L’unité divague, ou se brise. Trop chargées, les branches cassent. Les rapports flottent et commencent à se nouer au hasard.
Quand règnent Rhodes et Pergame, un demi-siècle plus tard, l’organisme est décomposé. Dans l’anarchie sociale et politique grandissante, le brassage constant, sur tous les rivages d’Orient, des mystiques qui se confrontent, des sophistiques qui s’énervent, des intérêts privés qui se détruisent, des appels à la tyrannie bienfaisante et au barbare purificateur, les frontières plastiques sont forcées de toute part. L’architecture de l’idole n’est même plus un souvenir. Le modelé, ayant perdu le plan, tente de suivre pas à pas les incidents anatomiques qui brisent les profils et peuplent le silence naguère expressif des surfaces au profit de l’historiette pittoresque et du sentiment le plus banal. La gesticulation hagarde, complètement désorbitée, exprime un désordre moral d’où toute continuité de raisonnement et d’action, toute logique structurale, tout équilibre ont disparu. L’esprit qui, disloquant le plan, puis jouant avec le passage, avait quitté depuis un siècle les régions intérieures de la statue, se disperse aujourd’hui dans les mains qui se tordent, les jambes qui se tendent, les muscles qui se tétanisent, les visages qui se convulsent, les attributs envahissants et les cheveux éparpillés . Le centre d’attraction des masses n’est pas seulement perdu. Le sculpteur ne sait plus que ce centre existait jadis et qu’il déterminait la forme entière dont les mouvements et les surfaces gravitaient autour de lui. Dispersées à tous les incidents, à toutes les saillies de la statue, la petite sensibilité et la sensation médiocre tentent de substituer leurs cris et leur emphase au puissant sentiment global qui unissait, dans la forme monumentale, la connaissance et l’amour de l’objet à la croyance que l’objet fait partie d’un ensemble saint dont la religion, la cité, la famille, la guerre, la paix, l’aliment, la naissance et la mort sont des manifestations solidaires. On dirait que les gesticulations et les grimaces de l’idole clament son unité perdue. Ce n’est d’ailleurs plus une idole. C’est un article de bazar.