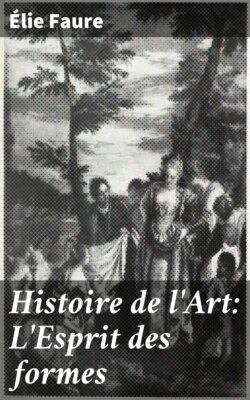Читать книгу Histoire de l'Art: L'Esprit des formes - Elie 1873-1937 Faure - Страница 4
INTRODUCTION
ОглавлениеFaut-il s’en réjouir? Faut-il le regretter? Nous voici parvenus à un point critique de l’Histoire où il nous devient impossible de penser en profondeur — et de créer, j’imagine — si nous nous isolons dans l’aventure de notre race et refusons de demander aux expressions verbales ou figurées que les autres races ont donné d’elles, une confirmation de nos propres pressentiments. Je dis «une confirmation», bien qu’au premier abord ce soient les contradictions, ou du moins les différences qui nous frappent. En apparence, un abîme sépare de l’idole nègre ou polynésienne, par exemple, la sculpture grecque à son apogée ou la grande peinture européenne dont l’école de Venise nous a révélé les moyens et les possibilités. Cependant, l’un des miracles de ce temps est qu’un nombre croissant d’esprits soient devenus capables non seulement de goûter, avec une égale ivresse, la délicate ou violente saveur de ces œuvres réputées antinomiques, mais même de saisir dans les caractères opposés qu’elles paraissent offrir, des accords intérieurs qui nous conduisent à l’homme et nous le montrent partout animé de passions dont toutes les idoles, en accusant l’accent, révèlent les analogies.
Je n’ignore pas le danger de ces reconnaissances-là. A certaines époques — l’époque classique grecque ou française, par exemple, — il était bon que le poète ignorât qu’il représentait seulement un aspect de l’âme divine, et qu’il poussât toutes les puissances diffuses déposées en lui par la culture, ses intuitions et ses besoins dans le sens unilatéral d’une perfection étroite et très arrêté à atteindre pour exprimer le moment pathétique où sa race prétendait enfermer ces puissances dans les cadres de la raison. Cependant, nous n’en sommes plus là. Une attitude pareille, aujourd’hui, risque de rendre impuissants ceux qui l’adoptent. Pour le moment, du moins, limiter son effort à l’idéal historique d’une race, ou d’un peuple — idéal d’ailleurs transformé, ou déplacé, — refuser d’apercevoir le visage unique de l’homme sous les masques qui le couvrent, n’est plus un signe de force, mais bien de sénilité. Il est arrivé plusieurs fois dans l’Histoire à l’esprit critique, vers la fin du vieux monde par exemple, ou après l’efflorescence chrétienne du moyen âge occidental, de se trouver devant un tel amoncellement d’inconnu après avoir inventorié ses prodigieuses connaissances, qu’il a dû faire appel à tous les groupes d’hommes sollicités par les mêmes problèmes, pour en chercher avec eux la solution. De nos jours, toutefois, ce n’est plus seulement autour du bassin de la Méditerranée orientale ou dans l’Europe de l’Ouest que nous devons rassembler les éléments d’une mystique seule capable de mettre fin, du moins momentanément, à l’espèce de désarroi enivrant qui nous transporte. L’esprit critique est devenu un poète universel. Il faut élargir démesurément, et sans cesse, le cercle de son horizon.
Je ne dis pas que nous touchions à l’unification spirituelle du monde. Nous en sommes encore loin, si toutefois nous la réalisons jamais, et si même il est désirable que nous la réalisions. Mais si l’architecture industrielle, par exemple, qui cherche, avant de plaire, à poursuivre ses fins, ce qui est peut-être, après tout, le moyen de ne pas déplaire, ébauche déjà devant nous un langage universel, je ne crois pas qu’elle puisse jamais imprimer un accent uniforme à ce langage, et je ne le lui souhaite pas. La mobilité de l’esprit, favorisée par les exigences des milieux et le brassage des espèces, doit à mon sens continuer à accepter toutes les variétés vivantes de ses expressions figurées se prêtant d’ailleurs, par une intelligence grandissante des conditions universelles de sa propre conservation, à être comprises d’un nombre d’hommes de plus en plus étendu. Il ne faut pas que le désir d’unité spirituelle qui croît au sein des élites, devienne, dans les multitudes, un besoin d’uniformité. Ceux qui ne sont pas capables de saisir les balbutiements de cette unité dans les idoles innombrables dont toutes les races de la terre ont jalonné leur chemin, sont aussi les moins capables d’apporter à leur propre race une contribution assez puissante pour lui permettre de marquer encore l’avenir.
Quand vous avez compris les mobiles profonds d’une tendance opposée à la vôtre — ou paraissant opposée à la vôtre — vous êtes pris pour elle d’une tendresse étrange, qui vient de ce que vous y retrouvez vos doutes et vos combats. Vous choisissez dès lors la route qui était instinctivement et devient logiquement la vôtre, avec d’autant plus de décision et d’allégresse que vous vous savez moins compris des hommes qui ont traversé les mêmes luttes que vous. Le jour où ceux qui aiment la paix comprendront la grandeur que peut revêtir la guerre, peut-être seront-ils plus près de la paix universelle dont ils veulent nous doter. Le jour où telle religion pénétrera les symboles ésotériques de telle autre, elle ne sera pas loin d’admettre les rites les plus éloignés des siens. L’académicien que révolte une idole hindoue sera plus près de Raphaël le jour où il sentira la puissance spirituelle que l’idole hindoue représente. Qu’on le sente ou non, qu’on le veuille ou non, une solidarité universelle unit tous les gestes et toutes les images des hommes, non seulement dans l’espace, mais aussi et surtout dans le temps. La notion intuitive, intime, toujours vivante et présente du temps, est d’ailleurs le meilleur moyen dont nous disposions pour saisir le sens intérieur de toutes les figures de l’espace, qu’il a déposées sur sa route comme un fleuve ses alluvions. On comprend tout, dès qu’on remonte aux sources. Un bois nègre et un marbre grec ne sont pas si loin qu’on le pense. Qu’on regarde une œuvre pure du moyen empire égyptien si l’on tient à saisir, dans l’équilibre rythmique de ses surfaces ondulantes, le passage des plans ingénus et frustes du premier aux mouvements libres, mais concentriques du second.
En fait, l’affirmation de cette solidarité n’est point le fruit d’une intuition mystique. Cette solidarité existe réellement. Elle appartient au développement de l’histoire universelle dont elle fut l’un des ressorts, peut-être le plus dense et le plus souple de tous. L’art de tout temps, l’art de tout lieu se pénètre de proche en proche. Sans doute est-ce l’art nègre immémorial qui, par la vallée du Nil, s’est répandu sur les deux mondes alors que l’art polynésien, l’un de ses rameaux peut-être, heurtait l’Amérique pour s’y épanouir, ou rencontrait dans les îles malaises les courants qui portaient, par le Gange et l’Iraouaddi, l’esprit de la Grèce et de l’Egypte transformés au passage en Assyrie, en Perse, aux Indes, en Indo-Chine, celle-ci imprégnée de l’âme chinoise d’ailleurs fécondée par l’Inde et la Perse grâce aux trouées du Brahmapoutre et du Tarim. Que la Perse, d’autre part, répande en Asie l’art arabe sorti de l’art romain et de l’art byzantin, eux-mêmes rameaux de l’art grec. que la chevauchée de l’Islam rencontre en Italie, en Espagne, en France, les formes abâtardies de cet art grec jetées par les navigateurs sur les rivages méditerranéens en remontant le Danube et le Rhône pour s’y confronter dans la cathédrale avec l’esprit musical descendu par la vallée de l’Oise des plaines du Nord, le cercle de l’art universel achève de se fermer. D’autant plus que même quand ses grandes expressions s’ignorent et que leurs sources communes se perdent dans la nuit, l’évolution de l’intelligence semble passer partout par des phases presque pareilles d’intégration organique, d’équilibre harmonique et de dissolution critique qui donnent à ses apparences des analogies surprenantes de structure, de rythme et d’accent. Qu’en suive, si l’on en doute, la marche parallèle des statues grecque et française, là des Orantes de l’Acropole aux athlètes de Lysippe et au mausolée de Scopas, ici des vierges et des saints des porches de Chartres à aux des porches de Bourges en passant là par les frontons du Parthénon et d’Olympie, ici par les rois d’Amiens et les prophètes de Reims. Ou, si l’on préfère puiser au hasard dans le répertoire des formes, sans s’inquiéter des écoles et des techniques, des dates, du prétexte mythique, du caractère local, qu’on compare telle terre cuite grecque trouvée dans les tombes de Tanagra à telle terre cuite chinoise trouvée dans les tombes des Tang, tel bas-relief de Moissac ou d’Arles à tel bas-relief d’Angkor- Vat, tel rinceau d’une église d’Ile-de-France à tel rinceau d’une stupa de l’Inde, telle peinture japonaise du XVe siècle à telle peinture siennoise, et les fresques des chasseurs de rennes aux fresques des Boshimens. On y retrouvera de ces parentés émouvantes qui évoquent l’identité des origines, et font comprendre que des haches de silex ou des ossements humains ne se puissent qu’à peine distinguer les uns des autres, qu’on les découvre sous les alluvions du Missouri ou du Niger ou roulant parmi les galets d’une rivière de France ou d’un torrent de l’Alaska.
Il est dès lors naturel que l’intelligence, après avoir, par la grâce des archéologues, classé rigoureusement les formes figurées qui l’expriment en tous lieux et depuis toujours, tende à retrouver sous leurs divergences une sorte d’unité de plan, suivant un travail analogue à celui qu’effectua Lamarck vis-à-vis des formes naturelles différenciées par ses prédécesseurs. L’esprit des formes est un. Il circule au dedans d’elles comme le feu central qui roule au centre des planètes et détermine la hauteur et le profil de leurs montagnes selon le degré de résistance et la constitution du sol. Les images des dieux sont aussi instables que possible, même s’il s’agit des dieux d’un même peuple, précisément parce qu’elles représentent, dans le monde des apparences, la circulation invisible d’une force permanente, et décidée à briser ou à dé former les obstacles, qui parcourt ses artères, anime ses nerfs, soude et sale ses os depuis l’origine de l’homme. C’est la permanence de cette force qu’il s’agit de retrouver et de mettre en lumière sous la diversité et la variabilité des symboles qui la dissimulent. Je ne demande pas mieux qu’on la qualifie de Dieu, à condition qu’elle reste insaisissable en son essence et ne laisse apercevoir de temps à autre qu’un aspect plus ou moins essentiel, plus ou moins profond de son être, que la tâche du poète est précisément de révéler avant qu’il s’évanouisse pour toujours. Un mythe fort émouvant de la cosmogénie polynésienne nous apprend qu’un dieu ne devient dieu qu’au moment où il devient forme. C’est vrai. Mais il est vrai, aussi, qu’au moment où il devient forme, il commence de mourir.
Ainsi, l’œuvre exprimant l’unanime drame Plastique est pour nous d’autant plus poignante qu’elle s’efforce de donner plus de stabilité et d’imposer des lois statiques plus durables à une image de la vie qu’elle sent plus instable et plus entraînée dans le devenir par un dynamisme plus impérieux. Toute l’histoire d’un artiste, toute l’histoire d’une école, toute l’histoire de l’art est dominée et conditionnée par ce drame, — par l’impérissable désir de retenir la vie universelle qui nous échappe à tout instant, dans l’image capable de la définir pour toujours. Si l’on ne conçoit pas cela, aucune forme d’art n’est intelligible en dehors du naturalisme le plus étroit. Si l’on conçoit cela, les formes les plus éloignées des apparences de la vie, — l’art aztéque, par exemple, qui est à peu près illisible au premier coup d’œil et réunit, dans ses équilibres de masses, les objets et les organes les plus hétéroclites et souvent les moins définis, — deviennent immédiatement et pleinement intelligibles. Elles conquièrent cette vertu de viabilité surnaturelle où communient les plus hautes expressions du lyrisme, ivresse de la vie montante prenant conscience de son ascension. Le modeleur de dieux, au fond, c’est l’univers spirituel courant sans cesse à la poursuite de son centre de gravité qui s’offre et se dérobe tour à tour à son étreinte. Il n’est que l’humble et merveilleuse image de l’ordre cosmique lui-même, cet état d’équilibre provisoire entre deux chaos. Ceux qui nient que l’art soit utile voudront bien se représenter ce qu’il adviendrait de l’homme, si la force qui maintient les planètes dans leur orbite cessait tout d’un coup d’agir.
Ce sont là de bien grands mots peut-être, si l’on songe à telle fable de La Fontaine, à telle figurine béotienne, à telle enluminure persane, à telle folle jeune femme de Fragonard offrant entre deux doigts la fraise de son sein. Cependant pourrions-nous saisir la grâce la plus furtive, goûter l’accord discret des tons les plus délicats, pénétrer l’angoisse ou la douceur de ces yeux qui nous regardent, si des antennes subtiles, parties des centres secrets de notre sensibilité, ne l’unissaient infailliblement à leurs attractions mystérieuses, si impondérables soient-elles, par des lignes de force assurant la solidarité physique, et biologique, et spirituelle de leur structure et de la nôtre, et affirmant la présence, en elles comme en nous, de deux besoins d’harmonie analogues que leur accord inattendu enivre de sécurité ? Il n’y a rien d’incompatible entre cette certitude mathématique que nous cherchons confusément dans l’œuvre d’art et sa vie toujours fuyante et toujours attirante que nous ne pouvons y surprendre que par éclairs. Nous goûtons, bien au contraire, dans cette fuite perpétuelle, une obscure consolation, sitôt du moins que nous savons qu’elle tourne sans lassitude autour d’un centre qui existe en nous comme en elle, bien que nous soyons incapables de le situer et de le fixer pour toujours. Ainsi le drame reste ouvert, et cette angoisse indéfinie de l’homme qui lui offre, jusqu’à ce que l’univers ait cessé d’exister pour lui d’abord, pour son espèce ensuite, un champ sans limite visible d’émotion et d’activité. Je pense que c’est le caractère à la fois logique et flottant, tragique et consolant de l’art qui veut que toutes les définitions qu’on en a données et en donnera soient restées et doivent rester incomplètes. L’art, qui est notre raison d’être, ne périra qu’avec nous. C’est lui qui nourrit et maintient notre énergie spirituelle. C’est lui qui nous livre le secret de l’effort sans espoir mais nécessaire de Sisyphe. L’homme sort des cendres de l’homme et revoit la face divine dès qu’il surprend des germes dans les cendres de l’autel qu’il a renversé.
Je crains de ne pas être parvenu à maintenir, entre les pages de ce livre, cette circulation grandiose d’énergie qui rend aussi sûrement solidaire la moindre image d’oiseau trouvée dans les sables d’Egypte d’un aéroplane actuel, que la plus effacée des silhouettes de mammouth gravée sur les parois du Fond de Gaume de la pagode de Sriringam ou dit Parthénon de Périclès. J’aurais aussi voulu montrer comment la statue arrachée d’un temple quelconque reproduit les profils mêmes de ce temple entre ses plans dont les ondes mouvantes vont saisir dans l’espace, pour les incorporer à elles, les passages et les reflets qui déterminent la peinture et font naître de la peinture, par leurs rythmes enchevêtrés, des harmonies invisibles d’où la musique jaillira. J’aurais voulu, enfin, réduire à quelques rapports évidents l’innombrable complexité des relations révélées par la variété innombrable des images, et la profondeur des abîmes que leur étude creuse en nous. Il me semble en effet probable que les rapports exprimés par Phidias, par exemple, bien qu’ils nous paraissent simples, n’en restent pas moins essentiels, et que si l’ébranlement qu’inflige une cathédrale ou une symphonie de Beethoven à notre sensibilité est plus nombreux et plus intense, c’est que les éléments analytiques exprimés par elles ne font pas encore aussi intimement partie de nous que les idées où l’esprit de Phidias reconnut autrefois ses sources. Ce que nous appelons «profondeur» est peut-être au commencement de chacune de nos enquêtes. On retrouve, chez les penseurs d’avant la venue de Phidias, des intuitions aussi complexes que celles des philosophes de l’Inde ou de l’Allemagne, intuitions qui contribuent toutes à former l’harmonie intellectuelle en apparence très épurée de Platon. Une courbe unique exprime un jour ce qu’évoquaient confusément jusqu’alors cent courbes enchevêtrées. La simplicité est une incessante conquête que des embûches attendent à tous les tournants de la route et qu’il n’appartient qu’aux poètes d’arracher à la somme immense et toujours renouvelée de l’inconnu.
Je n’ai donc pas pu, je n’ai pas su être plus simple. Et peut-être, après tout, n’est-ce point là ma fonction. Je regarde danser, hélas! je ne suis point un danseur. L’être le plus candide peut sentir, ou même exprimer le plus admirable poème que l’être le plus compliqué se montrera toujours incapable de comprendre et d’expliquer. Tant qui créent ou agissent avec leur puissance directe alors que moi je souffre et doute de saisir une solution qui ne cesse de me fuir. On peut trouver dans le moindre croquis d’un maître — ou peut-être bien d’un petit garçon qui dessine en tirant la langue — de quoi ruiner l’édifice que j’ai tenté de bâtir et qui représente trente années de méditation. Dieu est un enfant qui s’amuse, passe du rire aux larmes sans motifs et invente chaque jour le monde pour le tourment des abstracteurs de quintessence, des cuistres et des prédicants qui prétendent lui apprendre son métier de créateur.
(Daumier.)
.