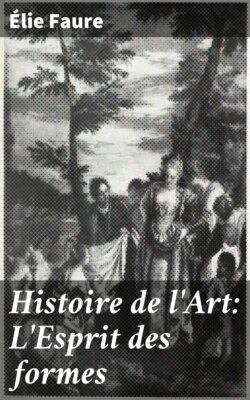Читать книгу Histoire de l'Art: L'Esprit des formes - Elie 1873-1937 Faure - Страница 12
VII
ОглавлениеMaintenant, hors du monde européen antique, hors de la civilisation chrétienne, les choses se passent-elles ainsi? Voit-on partout, comme on l’a vu en Grèce, en France, en Italie, dans l’Europe occidentale en général, l’homme-statue sortir de la société-architecture pour se définir par la peinture et tendre, à travers l’ivresse musicale, à recréer l’esprit social et l’édifice destiné à abriter cet esprit?
Les civilisations orientales sont peu pénétrables pour nous. Le bloc, au premier abord, est fermé. Quand nous nous y glissons, l’immense réseau du polythéisme populaire et du panthéisme philosophique nous interdit d’y avancer. Une atmosphère trouble les entoure, enivrante pour elles, comme l’haleine des marais fleuris d’où monte la fièvre. Presque irrespirable pour nous, qui aimons les contours nets, l’air léger, les eaux claires. L’évolution rapide des civilisations d’Europe, naissant, mûrissant, déclinant au cours d’une période qui ne dépasse pas quatre ou cinq siècles — parfois un ou deux, comme en Espagne ou en Hollande — nous a mal préparés à comprendre ces monuments métaphysiques immobiles à qui la légende accorde parfois dix mille ans d’existence, à qui l’Histoire n’a pas pu fixer un commencement. Au premier abord, par exemple, si l’on se place un peu loin pour en embrasser l’ensemble, ni la religion, ni la philosophie, ni l’organisation sociale de l’Egypte, de la Chine, de l’Inde ne paraissent avoir sensiblement changé depuis des temps immémoriaux. On ne connaît qu’une religion, d’ailleurs ésotérique, à l’Égypte pendant cinq mille ans. L’Inde revient au brahmanisme après avoir créé, puis absorbé le bouddhisme, dans la marée mystique qui monte sans arrêt des profondeurs sensuelles de son imagination. La Chine, qui d’abord accueille le bouddhisme, emploie sa longue patience somnolente et rechignée à le recouvrir peu à peu des mille petites pratiques de son fétichisme utilitaire. L’Islam supprime presque brusquement les manifestations de son activité spirituelle plutôt que de changer une pièce de son système social. Il faut accepter ou rejeter en bloc ces constructions gigantesques.
C’est leur caractère massif qui nous introduit d’emblée dans la réalité intime de leur génie créateur. L’esprit d’architecture le domine. Ou plutôt, la forme n’y est guère conçue en dehors de la construction. Même si la construction est dépourvue d’une valeur plastique capitale, comme aux Indes, la sculpture et la peinture n’en paraissent que des débris détachés . Même si la construction est nue, comme en Chine, la sculpture, isolée, montre ses rapports avec elle en conservant ses apparences architectoniques jusque dans les monstres héraldiques les plus hérissés. Même si, comme en Islam, il n’y a hors la construction ni sculpture, ni peinture, on voit l’ornement aboutir à une formule géométrique qui ne permet aucune incursion dans la vie au décorateur . Si le grand rythme alternatif existe dans ces organismes amorphes, il ne sera qu’ébauché, montant et descendant de siècle en siècle ou même de millénaire en millénaire comme une marée qui ne change pas sensiblement l’aspect général de la mer et n’en altère en rien la masse. Même quand on ne peut l’y découvrir nettement, un fait subsiste: la religion, la morale, le lien social restant intacts, rien ne sort complètement de la sphère architectonique à l’intérieur de laquelle l’esprit consent à se mouvoir.
Nous connaissons trop mal l’histoire de l’Égypte pour en dégager ces alternances. Nous croyons parfois les saisir. Mais la chronologie nous détrompe. Telle statue que nous nous imaginions postérieure à telle autre plus archaïque d’aspect, lui est au contraire antérieure, et de mille ou deux mille ans. L’uniformité de la statuaire égyptienne n’est qu’apparente. Une série de flux et de reflux en ravine la surface. Mais leur profondeur nous échappe, et leur signification. Car nous ignorons à peu près les variations de la doctrine, les mouvements sociaux à qui ces variations répondent, leurs échos dans la littérature, la morale, les mœurs. Cependant, quelques phénomènes identiques à ceux qui marquent ailleurs la décomposition du corps social apparaissent vers le déclin de la culture égyptienne. Et ils sont significatifs. Ainsi dès l’époque saïte, quand le portrait individuel se multiplie — la statue gardant toutefois son allure architectonique — on ne bâtit plus aucun temple. Ainsi, l’époque gréco-romaine voit se disloquer dans la statue et le portrait même l’esprit de masse et de cohésion où l’Égypte s’est définie pendant cinquante siècles, au point que les sphinx et les dieux contemporains des Ptolémées ont complètement oublié leur caractère religieux ou symbolique et constituent une industrie d’ameublement de la plus pauvre qualité. Ainsi l’époque chrétienne assiste à l’apparition de ces portraits peints où la vie intérieure éclate, hallucinante, musicale, rayonnante et en même temps concentrée, immense afflux des âmes simples que l’espoir envahit. Le passage de l’organisme égyptien à l’organisme chrétien éprouve la crise poignante subie par l’hellénisme entier à la même époque, au cours de laquelle on a pu croire le monde social ruiné pour toujours et l’individu abandonné à la dérive, la grande architecture et la grande sculpture n’étant plus même un souvenir.
.
Cl. Giraudou.
INDIVIDUATION DE L’ÉGYPTE (Époque grecque.)
Tant que l’édifice social égyptien dure, en tout cas, c’est-à-dire jusqu’à Ramsès III, l’art égyptien ne conçoit même pas l’individu comme indépendant de cet édifice, et si nous-mêmes essayons de concevoir sa statuaire comme indépendante de son architecture, nous ne la comprenons pas. Non qu’il prétende l’associer à la construction. Au contraire, il l’en sépare plus nettement que le Grec. Il laisse nus ses temples hermétiques, enfermant dans leur ombre la plus étroite quelque momie de crocodile, quelque statuette d’épervier. Mais durant quatre ou cinq mille ans, la statue ne sort pas du principe géométrique qui préside à l’aménagement des travaux hydrauliques, à l’édification des pyramides, des pylônes, des gigantesques colonnades imposant le génie de l’homme au monotone univers.
Ceci est plus impressionnant, plus significatif encore, que la sortie progressive de la statue hors du sanctuaire qui marque l’épopée plastique de l’Europe. La société égyptienne est si hiérarchisée, si étroitement imbriquée dans l’organisme politique dont la masse rappelle ces blocs de basalte que leur poids seul maintient dans ses salles hypostyles pour l’éternité, qu’elle laisse l’individu libre de rêver à sa guise dans les limites absolues qu’elle lui trace de toutes parts. Ainsi l’ingénieur du pays creuse les réservoirs et les canaux hors de qui l’eau du Nil ne pourra pas se répandre, ainsi la nature elle-même tranche, par la ligne de l’alluvion, une séparation implacable entre la terre nourricière que l’humidité pénètre et la terre altérée que stérilise le soleil. La statue égyptienne se meut à l’intérieur de ses propres frontières hors de qui commence le règne de l’espace en feu. Elle est une forme en soi, un microcosme. Elle n’a aucune raison d’être, si elle n’est conçue géométriquement, selon le plan de l’univers visible qui commence où elle finit. L’immutabilité millénaire des lois qui font pousser le pain explique ici de la façon la plus certaine l’immutabilité de l’âme. L’individu en dépend à tel point que son instinct profond lui interdit d’aller au delà de la forme géométrique que la régularité des phénomènes naturels inflige à ses rapports avec l’ordre politique et qui cadence, de sa monotonie grandiose, le rythme de son esprit. Si son énergie et sa curiosité fléchissent, la formule académique interviendra pour les maintenir quand même dans le cadre fixé par la nature et la loi. Si elles l’abandonnent tout à fait, il passera la parole aux hommes apportant du dehors dans cette immobilité absolue des berges de la vie, la mobilité révolutionnaire de leurs passions. Et, resté le même au fond, il laissera crouler ses temples pour continuer de semer, de voir lever et de cueillir le froment aux mêmes dates, depuis toujours et à jamais.
Voilà le mystère égyptien. L’individu y apparaît furtivement, il s’y ébauche avec une exquise et parfois narquoise finesse dans la peinture des tombeaux où toute la vie régulière, affairée, humble et saine du batelier, du berger, du cultivateur, du meunier se profile sur les murailles en traits subtils comme la poésie de l’aube à la campagne, frisson des eaux, battements d’ailes, ramages ininterrompus, calices s’ouvrant à la rosée, chant des rameurs, frémissement des herbes, pierres précieuses liquides et tremblant de toutes parts . Mais il ne sort jamais de lui, pas plus que l’univers astronomique même, pas plus que la caste qui en maintient, dans la loi et le mythe, la discipline et l’enseignement. Son évolution lente et limitée s’accomplit exclusivement au dedans du grand rythme architectonique. On voit, dans la masse elle-même du cube de basalte, de diorite ou de granit, les membres de la statue se délier un peu, s’arrondir, s’effiler, les traits du visage laisser filtrer la flamme emprisonnée, et son esprit demander aux plans ondulants qui le délimitent d’insister à peine ici, de se dérober furtivement là, de prolonger, par un miracle du sentiment plastique et poétique associés, leurs modulations ininterrompues jusqu’aux limites secrètes d’un espace intérieur que la lumière du dehors épouse à toutes les surfaces pour se solidariser avec lui . Puisque le statuaire ne peut sortir du mythe nécessaire et du monde visible, le monde invisible est à lui. Dans les limites infranchissables de l’image, il pourra subtiliser, caresser, moduler à l’infini sa masse pour la prolonger de partout sur l’onde continue d’une muette harmonie. Miracle unique. Les intentions de la peinture entrent dans les directions de la musique par les moyens de la sculpture restée de toute part bloquée dans les profils impeccables de la construction. La symphonie individuelle s’accomplit silencieusement dans la statue elle-même, alors que la peinture des tombeaux ne franchit nulle part les bornes de la mélodie. On dirait que l’Égypte veut signifier par là aux temps futurs que tout peut s’exprimer entre les frontières rigides du mythe le plus intransigeant, à condition de ne pas substituer le principe individualiste à la réalité individu, mais aussi de ne pas sacrifier au principe social cette même réalité. L’individualisme, il est vrai, prend momentanément sa revanche en apprenant à l’Égypte qu’un organisme, aussi logique et formidable qu’il puisse être, périt dans ses propres frontières s’il ne fait appel quelque jour aux passions individuelles pour y surprendre les éléments constitutifs et ainsi préparer leur combinaison future dans un ordre différent.
In Fechheimer. La plastique égyptienne.
(Cassirer. éd.).
.
LA SCULPTURE MUSICALE (Égypte.)
Aux Indes, le spectacle, au premier abord bien éloigné de celui-là, offre avec lui, si on le regarde de près, des analogies singulières. Rien n’est ici géométrie. Tout est organisme confus, bourgeonnement de plantes grasses inégales de hauteur, de forme, de distribution sur quelque marécage empoisonné. Et pourtant, rien non plus ne s’y dérobe à une conception sociale tyrannique, qui invoque pour durer la volupté spirituelle d’un mythe sinistre et grandiose représenté sur la terre par le régime implacable des castes, et se maintient depuis trente siècles sans bouger sensiblement. Ou plutôt, là aussi, en bougeant au dedans d’elle-même sans rien admettre du dehors, ou assimilant le dehors en quelques instants, comme un flot sombre, grouillant de monstres et couvert de fleurs éclatantes, qui ondulerait lourdement entre les rives envasées d’un sacerdoce aussi fertile, dans le renouvellement de ses symboles, que la naissance et la mort. Comme le milieu régulier et clément engendrait là l’optimisme et engageait l’individu à se fixer dans un système social immobile, ici le milieu chaotique, inclément, fiévreux, engendre le pessimisme et interdit à l’individu, même s’il veut s’évader d’un système mystique impitoyable, d’en franchir l’étendue d’ailleurs trop mouvante pour qu’il puisse en délimiter les contours. Ici, l’individu dé passe sans cesse le flot, du front, de la main, du genou. Mais le flot le reprend toujours. La sculpture hindoue fait songer à un homme enlisé dans la vase, et se débattant en vain pour en sortir. Le lyrisme et le désespoir se bousculent dans les âmes. L’esprit religieux et sensuel émerge d’une matière éternellement remuante qui le crée à chaque minute et l’engloutit l’instant d’après.
La sculpture hindoue est l’image de ce mouvement universel qui ne sort pas de ses frontières imprécises et dont l’imprécision même lui interdit de sortir. Comme, là-bas, l’esprit pictural ondulant avec subtilité dans la masse de la statue refusait de quitter l’édifice social, ici l’esprit pictural tente à tout instant de déborder la sculpture, pour y rentrer aussitôt avec une espèce de douleur. Ici, pas plus que les dieux, pas plus que les individus, pas plus que l’architecture elle-même, la sculpture n’est arrêtée. Un mouvement désordonné et tragique l’anime. Par grands coups de lumières, d’ombres, par contrastes puissants incessamment provoqués et rompus, il bouleverse le rocher nuancé à la façon d’une peinture, en fait sortir et rentrer les saillies comme des ondulations de reptiles, des soubresauts de fauves ou des spasmes amoureux. La sculpture reste noyée dans son atmosphère de pierre. L’âme enfiévrée se rue à des tentatives excentriques condamnées sans cesse à l’échec, mais infligeant à la matière sculptée l’esprit de la grande peinture. C’est le contraire de l’Égypte où la matière sculptée s’inflige incessamment l’esprit de l’architecture pour vivre concentriquement. Mais, ici comme là, tout le problème tourne autour de l’individu émergeant du moule social et se résout dans la sculpture qui là refuse de sortir du temple et ici ne peut en sortir. Et comme il fallut à l’Égypte, pour quitter son bloc hermétique, l’invasion gréco-romaine, ce n’est guère qu’à partir du Xe siècle, quand surviennent aux Indes le musulman, puis le chrétien, qu’un peu d’air étranger entre dans cette atmosphère enivrante, mais aussi que l’architecture, tout en se spiritualisant au début, s’amincit très vite, s’épuise, se vulgarise et que la sculpture, qui changeait autrefois la forme des montagnes, commence de se perdre dans l’anecdote, le pittoresque et l’ornement.
C’est d’ailleurs au moment de la grande époque bouddhique que la sculpture hindoue changea la forme des montagnes, comme elle la changea en Chine et eut la force d’élever, au Cambodge, à Java , les féeries monumentales où l’univers commun aux hommes, aux forêts, aux bêtes entra pour y tourbillonner, y danser, disparaître comme une apsara emportée par les mille voix réunies des violons, des cuivres, des tambourins, des voix humaines, des murmures indistincts et des parfums mélangés. Le bouddhisme devait traverser le pessimisme hindou et le positivisme chinois par le moyen de la sculpture, parce qu’il se développait autour d’un besoin d’idéalisme social qui conditionnait la découverte et la culture de l’individu. Mais, en Chine comme aux Indes, l’unité de l’édifice idéal était telle qu’on assista, durant quatre ou cinq siècles, comme on y assista en Égypte durant quatre ou cinq millénaires à ce formidable événement: cent hommes, mille hommes peut-être, taillant dans une même roche l’image du même dieu, sans que l’image de ce dieu sortît d’une unité si fortement liée à leur structure spirituelle qu’elle semblait jaillir d’un même cœur, être conçue par une même tête, réalisée par une même main . C’est un phénomène analogue qui se produit, quelques siècles plus tard, dans l’Occident chrétien et plus spécialement en France, si l’on rapproche du colosse ou de la grotte ouvragée la cathédrale aux mille voix. Et c’est un phénomène inverse qu’apporte, comme la décadence grecque, la Renaissance d’Occident: souvent mille individus anarchiques semblent avoir sculpté la plus fragile statuette, composé le plus petit tableau. L’unité symphonique a quitté la multitude et ses éléments dispersés pour se réfugier tout entière dans le cœur, la tête, la main du héros.
En Chine, aux Indes, comme au Mexique ou en Islam; comme en Égypte, comme dans la Grèce dorienne et l’Europe médiévale, le héros est presque inconnu. La légende de Rama apparaît avec le bouddhisme et c’est bien son histoire qui fleurit le palais d’Angkor. Mais c’est le seul instant et le seul lieu d’Orient qu’on puisse comparer au Parthénon et à la cathédrale pour l’équilibre qu’ils cherchent entre l’aventure de l’homme et l’immobilité du dieu. En Orient, le héros, c’est la multitude. On voit, dans le désert chinois, marcher des statues colossales, guerriers, éléphants, dromadaires, chevaux liés comme des édifices à la plaine et pareils, dans la solitude, à ces accidents naturels qui en marquent le caractère comme le squelette géologique affleurant, et çà et là perçant le sol. La terre monte en eux, elle les accompagne, comme elle accompagne partout le cultivateur chinois tout imprégné d’elle, et à qui ses divinités familières révèlent le grain de l’humus, la direction du vent, la phase de la lune ou le temps propice aux labours. Si l’individu s’ébauche, et bien timidement, c’est, comme aux Indes, à partir du moment où l’Européen arrive et désagrège l’édifice commun où l’individu s’abritait. La multiplicité des cultes, fragmentés dans le fétichisme, n’est qu’une mousse à la surface du rocher moral immobile que les ancêtres ont dressé. Et si une peinture émouvante comme des voix mêlées de flûtes, de hautbois, de harpes, profonde, discrète, émanant d’un espace abstrait comme une condensation moléculaire, apparaît dans les convents bouddhiques précisément à l’heure où le bouddhisme, entre le VIIIe et le XIIe siècle, tend à rentrer peu à peu dans le monument social qui ne change que d’écorce, elle ne quitte pas des thèmes harmoniques où la grande symphonie individuelle ne songe même pas à s’ébaucher. C’est comme une tentative effacée de dégager du corps social quelques rares mélodies. Elle n’interprète l’univers qu’étayée à ses voisines, causant à voix basse avec elles, murmurant à leurs côtés, brodant comme un tissu de soie le voile subtil que l’anachorète pose doucement sur son âme afin que la multitude innombrable des âmes disciplinées ne puisse saisir par quels insensibles détours il déserte parfois ses chemins. Prise en bloc, la Chine, sa sculpture, sa céramique et ses bronzes veinés comme des viscères, est enfermée dans une forme hermétique et circulaire dont on ne peut sortir. Il faut passer chez le Japonais, son élève, pour trouver un rythme analogue à ceux qui ont caractérisé l’Occident. Quand la sculpture, ici, a rompu les profils bouddhiques pour gesticuler dans le siècle loin de l’organisme religieux, la peinture est vite apparue, puis le bibelot, l’article de bazar, la gravure d’ameublement, prodromes d’un individualisme en croissance qui finit par forcer l’armure médiévale mais s’y brise du même coup.
.
Cl. Goloubew.
LA SCULPTURE PICTURALE (Indes.)
C. Glaser. Plastique de l’Asie Orientale
(Cassirer, (d.).
.
L’UNITÉ COLLECTIVE (Chine.)
Le Japon fait tache en Asie. Nous connaissons les noms de tous ses peintres, les noms de tous ses graveurs, presque tous ceux de ses sculpteurs après l’époque bouddhique, même ceux de ses céramistes, de ses forgerons, de ses charpentiers, de ses jardiniers. Phénomène profond, qui toujours dénote une analyse sociale effectuée ou en devenir. Si on le retrouve en Chine seulement à propos de la peinture, c’est-à-dire de la tentative ébauchée par l’individu pour se différencier un peu, sinon sortir du corps social, il est tout à fait inconnu dans l’Inde où pas une seule des vagues de l’océan confus des formes ne porte un nom. Tout à fait en Égypte, où la rigueur géométrique de la masse à édifier conditionne une impersonnalité égale à celle de la science. Presque tout à fait chez les Arabes, presque tout à fait chez les Persans, sauf au XVIe siècle, dès que, dans la peinture, tend à percer l’individu. Il est le signe essentiel qui apparaît en Italie dès l’époque médiévale et s’y répète et s’y multiplie avec une incroyable profusion alors qu’en France il ne survient qu’au XVe siècle , quand l’ouvrier quitte le chantier de l’église pour l’antichambre du château, et dès lors s’accentue de siècle en siècle jusqu’à la démence, comme dans tout l’Occident. Il marque également le passage de l’organisme social hellénique aux tout premiers symptômes de sa dissociation, les noms des sculpteurs grecs n’apparaissant qu’entre Solon et Pisistrate, quand sa gaine architectonique commence à gêner la statue. Et son absence frappe d’autant plus à Byzance qu’on y assiste, pour quatre ou cinq siècles, à l’anéantissement de l’individualisme grec absorbé pêle-mêle par le panthéisme d’Asie avec la sculpture et la peinture rentrées dans la basilique, comme l’individu est rentré dans l’Église pour s’y refaire un prétexte et un centre de communion.
.
E. Grosse. (Cassirer, éd.).
LA MÉLODIE INTÉRIEURE (Chine.)
Rien ne démontre mieux que ces silences périodiques la vivante réalité du grand rythme alternant qui chemine à l’intérieur même des arts. Quand l’architecture domine, l’anonymat est la règle. Quand la sculpture apparaît, quelques noms, d’abord légendaires, émergent. Dès que la peinture se montre, on connaît tous les noms des peintres auxquels tous les sculpteurs se joignent, souvent même les constructeurs. La musique, par les cortèges qu’elle règle, par la danse qu’elle réveille, tend à faire rentrer l’individu dans la foule et le nom dans le secret. Tout ceci est très émouvant. Si la communion l’emporte, l’humilité est la loi, puisque l’homme croît avec l’homme et qu’un lien intérieur les identifie profondément. Si la critique désagrège, la communion mystique habite l’homme isolé qui a, espère avoir, ou croit avoir la force de la maintenir parmi nous et dont l’épée se nomme, suivant la qualité de cette force, vanité, suffisance, orgueil, conscience d’une destinée et d’une mission supérieures. Le nom, l’anonymat sont les signes d’une époque. Selon que l’un ou l’autre règne, on sait par quoi se définissent les rapports de chacun des hommes avec le corps social ou avec l’individu: ici par le roman, la psychologie, la peinture; là par l’architecture, la métaphysique, la loi.