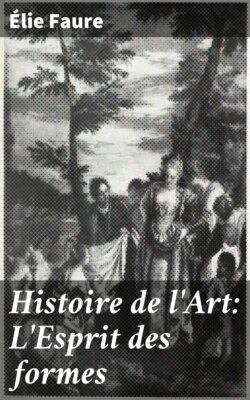Читать книгу Histoire de l'Art: L'Esprit des formes - Elie 1873-1937 Faure - Страница 6
I
ОглавлениеPlus j’avance, plus j’observe, plus je me regarde vivre, moins je conçois qu’il soit possible de considérer l’histoire des peuples et l’histoire de l’esprit autrement que comme une série d’alternances tantôt rapides et tantôt précipitées, de désintégrations par la connaissance et d’intégrations par l’amour. C’est le rythme que Laplace, Lamarck, Spencer surprennent dans l’évolution du drame universel même, partant de la phase originelle où la nébuleuse se forme, pour aboutir à la phase terminale où les soleils brisés et les planètes mortes rentrent dans la poussière des cieux, en passant par les étapes successives qui vont de la matière à la vie, de la vie à l’esprit, de l’esprit à la matière où il se perd et se retrempe, après qu’il l’a conçue et ordonnée un moment. C’est le rythme du drame chimique où la synthèse et l’analyse s’engendrent alternativement. C’est le rythme du drame physiologique où la systole et la diastole tour à tour lancent la vie à la périphérie et l’y reprennent, empoisonnée et engourdie, pour la refaire. C’est le rythme du drame biologique où, de la cellule sexuelle, surgit l’aventure de l’organisme supérieur que la faim et l’amour portent à recréer la cellule sexuelle pour se précipiter, par elle, dans un organisme nouveau.
Cl. Giraudon.
.
GRÈCE (VIIe s.)
Ce que nous savons de l’Histoire est encore et sera probablement toujours peu de chose. Peut-être, et sans doute, ne fait-elle que commencer. Mais il faut se résigner à ne rien apprendre d’elle si l’on ne se décide à chercher dans son déroulement une action, confuse à coup sûr, dont on puisse saisir l’aspect quand on la regarde de loin et qu’au lieu de la considérer selon ses soi-disant progrès, ses soi-disant reculs, ses prétendues intentions ou nos prétendus intérêts, on y cherche résolument ce rythme où l’esprit tantôt déterminé par ses événements, tantôt réagissant pour les organiser, ne joue qu’un rôle de régulateur, mais de régulateur unique. Déjà, dans ce qui reste d’elle, ce résidu d’intelligence qui persiste à la surface de ses mouvements intérieurs et y persiste seul quand tout a disparu de ces mouvements mêmes — le poème verbal qui s’inscrit dans le livre, le poème plastique qui s’inscrit dans le monument, le poème scientifique qui s’inscrit dans la formule, — il semble qu’une courbe assez nette apparaisse, dont les ascensions représentent des périodes d’association, et les descentes des périodes de dissociation morale entre les hommes, avec un maximum de cohésion aux sommets de la courbe, un maximum d’anarchie à ses points les moins élevés. Les saint-simoniens qualifiaient d’ «organique» et de «critique» ces périodes alternantes. Mais ils n’ont pas cherché à en saisir le témoignage, à mon sens irréfutable, dans les idoles, les temples, les habitations, les tombeaux. Si l’on parvient à découvrir ce caractère dans ces formes, je crois qu’on est autorisé à l’étendre à l’Histoire entière dont elles constituent pour ainsi dire la cristallisation spirituelle, la vie la plus haute de l’âme arrêtée en lettres de pierre au moment où elle se contredit et se déchire dans le drame des événements.
A coup sûr, dans les faits étudiés de trop près, ce rythme n’apparaît pas aussi simple. Il y a des brisures, des bavures, des empiétements. Il y a, dans le bronze, une paille. Une fissure zèbre l’architrave. Un sentiment nouveau s’éveille, qui fait trembler la pyramide ou trébucher le danseur. Il arrive, par exemple, que chez un peuple en pleine et régulière évolution, une invasion pacifique ou guerrière rompe, disloque, ou simplement dévie la courbe de cette évolution. Sur les thèmes essentiels de la symphonie historique, qui sont tantôt l’accord de tous les éléments spirituels introduits par la multitude dans le monument, tantôt la définition, dans les œuvres individuelles, de ces éléments dispersés à la recherche d’une communion nouvelle, d’autres thèmes s’enchevêtrent, des synthèses provisoires, des recherches d’équilibre embryonnaire aussitôt brisées, des essais qui s’ébauchent, ou avortent, ou ne durent pas. Au sein de l’analyse intellectuelle qui caractérise l’esprit hellénique décidément en dissolution à partir de Socrate, la synthèse morale qui définira le christianisme balbutie déjà, même dans la forme plastique, groupes gesticulants, yeux qui s’enfoncent sous l’orbite, jeux équivoques de lumière à la surface des statues. Au sein de l’analyse occidentale, d’autre part, quand la cathédrale se disloque en France, quand le palais florentin ou siennois lui-même perd la pureté de ses profils et s’encombre d’ornements, l’organisme moral du protestantisme tente, sur les débris de l’organisme esthétique du catholicisme, d’édifier un monument nouveau. Cependant, malgré ces accidents, ces sursauts, ces reculs, ces contradictions apparentes, l’alternance grandiose de l’illusion religieuse qui dresse les temples dans une fureur d’amour et de la connaissance critique qui les renverse pour ouvrir, par une enquête minutieuse, d’autres chemins à l’esprit, reste une réalité permanente, et décisive à mon sens.
Cl. Giraudon.
.
FRANCE (XIe s.)
.
Cl. Mansell.
GRÈCE (Commencement VIe s.)
Voici l’affirmation dorique, l’unité architecturale coïncidant partout avec une unité mythique indiscutée, le monument austère où la piété unanime des foules inscrit, sur les frontons et les métopes, la danse immobile des formes, la certitude rude et saine que trahit la pureté des profils. Voici les chapiteaux ornés, la colonne frêle et cannelée, la statue isolée et de plus en plus remuante, l’artiste hors du chantier commun, dans l’atelier privé et dans le monde, le drame arraché aux conventions collectives du théâtre pour entrer dans les méandres individuels de la sophistique et du roman, la religion rongée par l’analyse, la sensualité tournant à l’érotisme pour corrompre le sentiment, l’intelligence instituant l’expérience pour substituer une vérité fragmentaire à une vérité universelle. Voici, après Eschyle, Aristote. Voici l’affirmation chrétienne, le dogme catholique bloqué dans le temple roman dont l’épaisseur et la continuité expriment sa cohérence, le rythme rigoureux des figures étirées qui peuplent ses chapiteaux et ses tympans, plus tard l’essor des piliers, le planement des voûtes, l’élan du peuple entier vers l’espoir invincible que l’univers n’est que le symbole sensible d’un monde merveilleux promis à l’unanimité, à l’ingénuité de la foi. Voici, dans les arêtes mêmes de ces voûtes, dans ces figures qui s’amenuisent et se compliquent peu à peu, une curiosité qui naît, grandit, s’affirme conquérante et tyrannique, et le symbole disparu et l’objet scruté pour lui-même, la fleur naissant du germe, l’amoureuse étudiée dans la vierge-mère, l’homme jaillissant du dieu. Voici le caractère d’imprimerie remplaçant la pierre ouvragée, l’esprit rué à la conquête du bonheur terrestre, devenant cruel pour l’atteindre et découvrant, derrière le seuil paradisiaque de la connaissance où il entrait tout ébloui, l’enfer du doute et du remords. Voici Montaigne, puis Pascal, après Dante et saint Thomas. Hier, ici comme là, l’homme allait au-devant du monde, cherchant à s’y incorporer en une vaste unité religieuse où son panthéisme intuitif s’affirmait dans son instinct à concevoir le monument selon le plan universel. Aujourd’hui, ici comme là, il rétrécit le monde jusqu’à lui, cherchant à l’incorporer à son être dans une étroite unité personnelle où son anthropocentrisme raisonné s’affirme dans son application à exprimer ses sentiments. Socrate songeant, vers la fin de ses jours, à réapprendre la musique, est le symbole conscient de cette oscillation géante qui balance sans arrêt notre histoire spirituelle des cimes de l’ivresse mystique aux cimes de la raison. Quand on a parcouru en tous sens le territoire clair, mais limité de l’intelligence, on se retrouve un jour ou l’autre au bord du gouffre de l’inconnaissable où le besoin enivrant d’une illusion nouvelle reparaît.
FIG. 7.
Cl. Giraudon.
FRANCE (Première moitié XIIe s.)