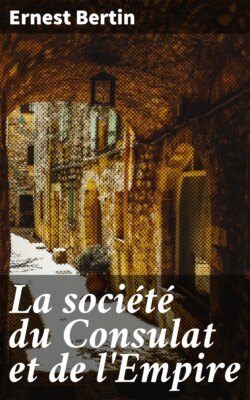Читать книгу La société du Consulat et de l'Empire - Ernest Bertin - Страница 15
I
ОглавлениеBonaparte, en s’entourant d’une cour, obéissait avant tout à une pensée politique: il voulait séduire en éblouissant; rallier la vanité française en la repaissant de distinctions idéales; ajouter à son jeune empire le prestige des vieilles monarchies. Mais ce qui servait ses intérêts ne laissait pas de flatter son orgueil: avec le plus beau génie du monde, on se surprend parfois à goûter les puériles satisfactions du parvenu. «Allons, petite créole, avait-il dit à Joséphine en s’établissant aux Tuileries, venez vous mettre dans le lit de vos maîtres.» Qui sait si le petit gentilhomme corse ne s’émerveillait pas de cet emménagement inouï presque autant que la petite créole? Malheureusement, il est plus facile de changer d’appartement que d’habitudes, et, par sa naissance, par son éducation, par son tempérament, Bonaparte n’était nullement préparé à s’acquitter de cette partie délicate du métier de souverain qu’on appelle la représentation. Ce n’était pas à la guerre, ni dans la vie de garnison qu’il avait pu trouver le temps et l’occasion de se polir; et le bon ton d’ailleurs, même en dehors des camps, était le dernier des soucis de la société nouvelle. Jamais personnage couronné ne s’éloigna davantage de ce type classique du souverain qui s’est comme incarné dans Louis XIV. Qu’on se rappelle le prince tant de fois décrit par Saint-Simon, la grâce majestueuse de sa démarche, de son geste, de son langage, sa politesse attentive et mesurée au rang, au sexe, à l’âge, la dignité sensible qu’il portait dans ses moindres actions, et qu’on rapproche de ce modèle de toutes les royales bienséances le César décrit par Mme de Rémusat, quels frappants et plaisants contrastes! Il a des ignorances, des distractions, des brusqueries, des violences mortelles au décorum. Il ne sait comment on entre dans un salon, comment on en sort; comment on s’assoit, comment on se lève, bien moins encore quelle main il faut offrir aux dames. A table, il saisit le premier plat à sa portée et commence souvent son dîner par la crème ou par les confitures. Quand il s’habille, il maltraite et bouscule les valets qui l’assistent, et si le vêtement qu’on lui offre lui déplaît, il le met sous ses pieds ou le jette au feu. Il se laisse aller à des attitudes qui n’ont rien d’auguste, soit qu’il tisonne avec ses bottes, soit qu’il se mette à cheval sur une chaise, le menton appuyé sur le dossier, pour causer plus à l’aise. L’un de ses gestes familiers est de tirer l’oreille aux gens, quel que soit leur rang ou leur sexe, et l’oreille de Mme de Rémusat jouit souvent de cette distinction. Imaginez Louis XIV usant de cette privauté avec l’une des dames de la reine, par exemple avec l’arbitre suprême de toutes les hautes convenances, la duchesse de Richelieu: la noble dame eût tremblé pour la raison de Sa Majesté, et Saint-Simon éperdu n’eût fait qu’un saut chez Fagon. Si quelque flatteur mal inspiré lui adresse, avec la meilleure intention du monde, un souhait qui contrarie ses vues secrètes, il devient subitement furieux, met le poing sous le menton du maladroit, ce maladroit fût-il maréchal de France, et il le pousse jusqu’à la muraille en le traitant tout crûment d’imbécile. Comparez ce ton, ce. geste au beau mouvement du grand roi jetant sa canne par la fenêtre pour n’être pas tenté d’en frapper ce petit insolent de Lauzun qui venait de lui reprocher un manque de parole et de briser son épée sous son talon, en jurant de ne le servir de sa vie.
Il est juste de remarquer que la cour n’en sait guère plus long que le souverain sur le chapitre des convenances. La tourmente révolutionnaire avait emporté, avec beaucoup d’autres choses, les vieilles traditions de la politesse française. Cette fine culture mondaine qui de Versailles, comme de son centre, se répandait jusque dans les plus lointaines provinces, s’était effacée en moins d’une génération. La nation réputée pour l’aisance supérieure de ses façons avait désappris ces attitudes, ces gestes, ces mouvements où elle triomphait par sa grâce savante et légère; la France, qui le croirait? ne savait plus faire la révérence. Les dames de Joséphine, se sentant si novices, se regardèrent avec effroi; mais il n’y avait pas moyen de se dérober ou de se défendre; le maître avait parlé ; leur amour-propre ne parlait guère moins haut; elles n’hésitèrent pas, et, pour acquérir les talents de leur charge, elles se remirent bravement à l’école.
Heureusement, la Révolution avait épargné un célèbre maître de danse, Despréaux; on s’empresse autour de ce personnage tombé en désuétude, on se le dispute comme le code vivant des convenances, on apprend en toute hâte à devenir grande dame. Restait aussi Mme Campan, la première femme de chambre de Marie-Antoinette: on la presse de questions, on lui fait raconter par le menu les habitudes intimes de la reine de France. Mme de Rémusat reçoit la mission officielle de tenir la plume sous sa dictée, et il en résulte un énorme cahier qui va grossir la liasse des Mémoires remis de tous les côtés à Bonaparte. On eût dit un concours d’érudits étudiant, approfondissant une question de haute antiquité ; et l’objet de ces recherches, j’allais dire de ces fouilles, était les grâces de cour mortes quinze ans en deçà ! M. de Talleyrand présidait avec un sang-froid ironique à ces graves efforts, et, de son fin sourire, mieux informé que beaucoup de lourds Mémoires, fixait le point discuté des convenances.
Non seulement on ressuscite les anciens usages de la cour de France, mais on en importe de nouveaux des cours étrangères. Le piquant, c’est que l’auteur de l’importation est Bonaparte lui-même. Eût-on jamais attendu de sa part cette ferveur de cérémonial? Il est vrai qu’il fut le premier à s’en mordre les doigts. Il avait vu à Munich toutes les personnes de la cour défiler en s’inclinant devant le roi et la reine de Bavière; il veut, lui aussi, recevoir ce solennel hommage; il se place gravement sur le trône avec l’impératrice à sa gauche; les princesses et les dames d’honneur sur des tabourets, les grands-officiers debout des deux côtés. Le défilé commence et d’abord ravit son imagination, agrée à son orgueil; mais bientôt son impassible majesté lui pèse; il s’impatiente, il s’agite sur son siège; bref, il s’ennuie, et l’on a toutes les peines du monde à le retenir à sa place jusqu’à ce qu’il ait subi les dernières révérences, pressées et brusquées par son ordre.
Rétif à toute espèce de contrainte, il ne peut supporter même celle de l’étiquette qu’il vient de créer; dès qu’elle le gêne, il s’en dégage et s’en rit. Aussi bien répugne-t-elle à l’habituelle impétuosité de son allure. Observez-le dans son naturel: il ne marche pas, il se précipite; il ne monte pas sur le trône, il s’y élance, et vous venez de voir comment il s’y tient. Cet invincible élan trouble l’ordre pompeux de ces cérémonies où il s’agit moins d’arriver que d’aller, où les grâces de la démarche, les splendeurs du costume cherchent et captivent les regards. Lors du mariage de Stéphanie de Beauharnais avec le prince de Bade, l’empereur, qui donne la main à la mariée, l’entraîne à l’autel plutôt qu’il ne l’y conduit; derrière lui se hâtent les dames du palais pressées par des chambellans impitoyables qui courent comme des aides de camp sur les flancs du cortège, en s’écriant avec une émulation peu galante: «Allons, allons, mesdames, avancez donc!» La vanité et la coquetterie féminines prennent le pas accéléré, sans plus songer à ravir les cœurs au passage; on relève et on ramasse sur son bras ces magnifiques traînes faites pour ondoyer sur les parvis et les degrés du palais, et on se console à la française, en riant de l’embarras et du dépit des retardataires. Telle comtesse d’origine étrangère, accoutumée aux lentes évolutions des cours du Nord, maugrée contre ce train de postillons, et demande la jupe courte pour les dames du palais, afin de mettre le costume en rapport avec l’emploi. Plus loin, à la tête du cortège, M. de Talleyrand, qui, comme premier chambellan, doit ouvrir la marche, sue, peine, s’évertue de ses jambes grêles et inégales; mais, toujours maître de ses impressions, il déguise sous un flegme imperturbable l’irritation qu’il éprouve de sentir sur ses talons le pas impatient du maître et les sourires moqueurs des aides de camp.