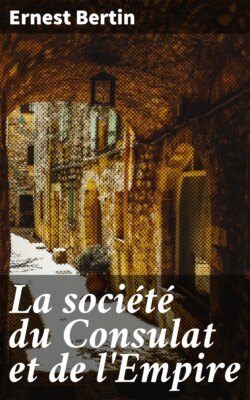Читать книгу La société du Consulat et de l'Empire - Ernest Bertin - Страница 8
IV
ОглавлениеIl est un événement de son séjour à Saint-Maximin qu’omet l’auteur des Mémoires avec un excès de discrétion heureusement corrigé par les compléments et les éclaircissements de M. Iung. Il n’a pas seulement péroré, joué et fait jouer la comédie: il s’est marié, et marié avec une fille charmante, mais de si modeste condition qu’il semble avoir rougi de confesser son idylle. Christine Boyer avait la taille élégante et souple, les grâces naturelles aux femmes du Midi, des yeux qui reflétaient la douceur de son âme. Son seul défaut était d’être la sœur de l’aubergiste chez lequel Lucien prenait sa pension; et encore, en ce temps-là, était-ce bien un défaut aux yeux du jeune garde-magasin dont on venait de supprimer l’emploi comme inutile? Femme aimable et hôtelier discret, la perspective était tentante. Lucien se moqua de ce qu’en penseraient ses ancêtres, qui n’en étaient pas avec lui à leur première surprise: il se laissa aimer, épouser et, par surcroît, héberger. De sa parenté vivante il n’y eut guère que Bonaparte qui protesta. Les temps étaient si durs, l’argent si rare et les distinctions de classes si mal portées! Non seulement Joseph s’abstint de protester, mais il acquiesça au mariage, en homme qui n’avait plus le droit de faire le dédaigneux. Il courtisait déjà et trois mois après il épousait, à Cuges, près Marseille, la fille d’un ancien marchand de savon, Mlle Clary, dotée, comme il l’avouait plus tard, au delà de ses espérances; l’un des témoins du futur roi d’Espagne signait dans l’acte Joseph Roux, perruquier. L’acte de Lucien contenait une singularité plus grave: le marié, encore mineur, s’y émancipait par un tour hardi, en prenant l’âge de Joseph; peut-être le jeune président de la Société révolutionnaire avait-il tonné la veille contre l’infâme régime du bon plaisir.
La figure de Christine Boyer, qu’on entrevoit dans la suite des Mémoires, a un charme doux et triste. Les rigueurs que lui témoigne Bonaparte ne l’irritent ni ne l’aigrissent; elle essaye de le fléchir à force d’affectueuse soumission, de caressante bonté, et n’emploie pour cela d’autres armes que sa pauvreté, sa faiblesse, sa maternité féconde et qui reçut, une fois, de la dureté de celui qu’elle suppliait en vain, une cruelle blessure.
Permettez-moi de vous appeler du nom de frère, lui écrivait-elle en août 1797 à l’occasion de ses prochaines couches. Mon premier enfant est né dans une époque où vous étiez irrité contre nous. Je désire bien qu’elle puisse vous caresser bientôt, afin de vous indemniser des peines que mon mariage vous a causées. Mon second enfant n’est pas venu au jour. Fuyant Paris d’après votre ordre, j’ai avorté en Allemagne. Dans un mois j’espère vous donner un neveu. Une grossesse heureuse et bien d’autres circonstances me font espérer que ce sera un neveu. Je vous promets d’en faire un militaire; mais je désire qu’il porte votre nom et soit votre filleul. J’espère que vous ne refuserez pas à votre sœur.... Parce que nous sommes pauvres, vous ne nous dédaignerez pas, car, après tout, vous êtes notre frère: mes enfants sont vos seuls neveux, et nous vous aimons plus que la fortune. Puissé-je un jour vous témoigner toute la tendresse que j’ai pour vous!
Nous vous aimons plus que la fortune quelle simplicité et quelle vérité de sentiments dans ces paroles, et arriva-t-il souvent à Bonaparte d’en entendre de semblables? Un peu de coquetterie féminine perce dans le post-scriptum, mais sous une forme si délicate et d’un ton de si doux reproche!
Je vous prie de ne pas m’oublier auprès de votre épouse, que je désirerais bien connaître. A Paris, on me disait que je lui ressemblais beaucoup. Si vous vous rappelez ma physionomie, vous devez pouvoir en juger.
Si courte que fut sa vie, elle eut le temps de voir son mari président du Conseil des Cinq-Cents, puis ministre de l’intérieur, et elle ne parut ni étonnée, ni embarrassée dans le monde nouveau qui devenait le sien. Elle ne portait aucune parure qui ne sortît des mains des premières faiseuses, mais, de plus, elle les portait à ravir, avec une grâce qu’on ne trouve qu’en soi. Quoiqu’elle ne fût pas éblouie par l’éclat du monde, c’était surtout le calme des champs qui attirait son âme égale et tendre. Lucien acquit et embellit à son intention le domaine de Plessis-Chamant, mais la mort la prit sur le seuil du bonheur rêvé : ses restes devaient seuls franchir la grille du Plessis pour y dormir sous le marbre et Les fleurs dans une partie solitaire du parc jusqu’au jour où l’église se rouvrit et la reçut. Lucien, malgré sa nature légère et changeante, la pleura de bonne foi, et Bonaparte, que sa grâce avait fini par désarmer, honora d’un regret sa douce mémoire. L’attrait de cette aimable figure nous a fait devancer l’ordre des événements: revenons au temps où Lucien n’était pas encore devenu ce qu’il voulait être à tout prix, un personnage.