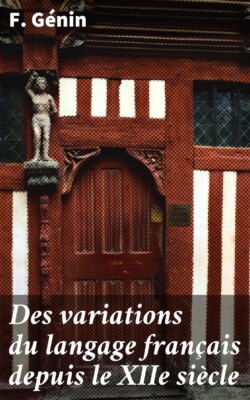Читать книгу Des variations du langage français depuis le XIIe siècle - F. Génin - Страница 23
M et N.
ОглавлениеMon, ton, son, bon, réservaient leur n à la voyelle subséquente, et sonnaient mo, to, so, bo. La prononciation miraculeusement conservée du mot monsieur en est la preuve irrécusable: mo-sieu; bo-jou, mosieu.
Mont (montagne) se prononçait aussi mo. Ménage nous avertit qu'il faut prononcer Mô-rever le nom de l'assassin de Mouy et de Coligny, quoiqu'il s'écrive correctement Mont-revel; et il cite à l'appui ce passage du Clovis de Desmarets:
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Et sur le mont Revel, qui s'élève en la Bresse:
La race de la Baume en tire sa noblesse18.
(Obs. de Mén., p. 246.)
[18] Ainsi la vraie orthographe de ce nom n'est pas douteuse, mais la prononciation a été une cause d'erreur. On a écrit Maurevel, et c'est ainsi qu'on lit partout dans la Confession de Sancy: «La pluspart de ceux cy estoient braves soldats, bons petardiers du seminaire de Maureuel.» (T. II, p. 420.) Mézeray écrit Morevel.
On prononce encore traditionnellement Momorency, et l'on écrit Montmorency. Le dictionnaire de Trévoux recommande expressément de prononcer Momorency.
On prononçait mo-nami,—bo-nenfant. La prononciation actuelle suppose deux n: mon-nami,—bon-nenfant,—ton-nâme,—son-népée. On dit de même, et à tort, un nenfant. La prononciation légitime, et conforme à l'ancien usage, est u-nenfant.
Soit au commencement, au milieu, ou à la fin des mots, m ou n, précédées de l'e, sonnaient invariablement an. Examen, que nous prononçons examin, eût sonné essaman.
Vienne, Ardenne, Guienne, Gien, Agen, sont mal prononcés par ain, à la moderne; c'est Viane, Guiane, Ajan, Gian, comme Sens, Caen et Rouen. Dans Gérard de Viane:
Vous cuidiez bien que je fusse endormis
Dedans Viane, ou de vin estordis.
(V. 3538.)
Vianne escrie: Deus, aidiez S. Moris.
(V. 1497.)
Vers Vianne est Oliviers retourné.
(V. 552.)
Renaud de Montauban, après avoir tué Bertoulet, neveu de Charlemagne, s'enfuit de la cour, et le poëte raconte
Comment grant povreté lui convint endurer
Ens es forests d'Ardane.
(Les quatre fils Aymon, v. 30.)
Partout dans le roman d'Ogier on lit Ardane: Ogier d'Ardane, Tierri d'Ardane, Geufroy d'Ardane.
Loherene ont et Ardane escillie.
(Ogier, v. 10784.)
«Les Sarrasins ont dévasté la Lorraine et l'Ardenne.»
Au XVIe siècle, la vraie prononciation était encore en vigueur. Marguerite, sœur de François Ier, dans ses lettres autographes, écrit toujours Gyan, la ville de Gyan.
Le nom propre Vivien sonnait Vivian:
Ils sont entré en Espagne la grant,
La terre guastent as Turs et as Persans,
Tuent les fames19, ocient les enfans.
Par tote l'ost fait crier Vivians…
(Gérard de Viane.)
[19] Sur cette orthographe du mot femme, voyez plus haut, pages 20 et 21.
La célèbre fée Viviane, élève et maîtresse de l'enchanteur Merlin, était la fée Vivienne.
Carême, gemme, crême, sont écrits, dans Saint-Bernard, quaramme, jamme, cramme:
—«De l'encommencement de quaramme.—Nous entrons hui, chier frere, el tens del saint quarammme.» (P. 561.)
—«Cuidiez vous, cher frere, ke li cramme faillist el baptisme de Crist?» (Ibid., p. 563.)
—«… C'est des jammes et des pierres precieuses.» (Ibid., p. 572.)
Le nom de Bethléem se prononçait Belléan, comme Jérusalem, Jerusalan; et c'est ainsi qu'on les trouve écrits la moitié du temps dans les manuscrits les plus anciens. MM. Ampère et Fallot ont pris à tort cette orthographe pour l'indication d'un cas oblique.
Dans le mystère de la Passion, représenté à Paris en 1507, lorsqu'il est question d'aller au temple présenter Marie, alors âgée de trois ans, la femme de chambre de sa mère suppose que cette jeune enfant ne pourra pas faire à pied la route de Jérusalem:
LA CHAMBRIÈRE.
Vous porterai-je?
MARIE.
Je suis forte
Assez pour cheminer un an;
Mais que soye en Hierusalem,
Humblement me reposeray,
Le sainct temple visiteray,
S'il plaist à Dieu, tout à mon aise.
( Hist. du Th. fr., par les frères Parfaict, I, 102.)
Les noms propres latins Arrianus, Cassianus, Spartianus, Gratianus, Gordianus, et autres terminés de même, se traduisaient Arrien, Cassien, Gratien, etc., afin de les rapprocher, par cette orthographe, le plus près possible de la forme latine; car, écrits ainsi, ils se prononçaient Arrian, Cassian, Gratian.
Cette prononciation de en nous était particulière; les autres peuples le font sonner ain. En Angleterre, Ruthwen, Owen; en Italie, Marengo; en Espagne, Notre-Dame del Carmen, Baylen, etc. Lorsque, par suite des relations politiques, l'habitude étrangère eut corrompu la nôtre, beaucoup d'écrivains, pour conserver l'ancienne prononciation, voulurent écrire par un a les finales en en. Mais les savants, chose étrange, aimèrent mieux retenir l'ancienne orthographe, et y appliquer la prononciation nouvelle; tant ils tiennent à la forme écrite! Ménage, entre autres, décida qu'il ne fallait pas prononcer Appian, mais Appi-in. Cette décision introduisait une inconséquence dans le langage, puisque l'on continuait à dire Caen, Rouen, et engager; elle choquait l'ancienne règle, le bon sens et l'étymologie: elle fut adoptée sans difficulté, et s'est toujours maintenue depuis.
D'après la règle qui fait l'objet de ce chapitre, rien, bien, tiens, etc., ont dû se prononcer rian, bian, tians; aussi les poëtes comiques, lorsqu'ils font parler des paysans, Molière, Regnard, Dufresny, Dancourt, n'y manquent-ils pas.—«Ça n'y fait rian, Piarrot!—J'en avons vu bian d'autres!» (Le Festin de Pierre.)