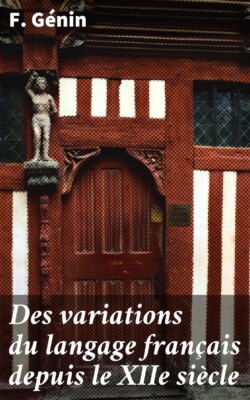Читать книгу Des variations du langage français depuis le XIIe siècle - F. Génin - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
R.
ОглавлениеR finale était muette.
Le pauvre bûcheron du Dit de Mellin-Mellot lamente sa misère:
Certes, vilain sui je gateis comme un ours.
De tous les tens du mont sui je nez en decours,
Ma femme et mes enfans aront povre secours
Quant m'en irai sans busche duel aront et courous.
(Jubinal, Nouv. fabl., I, 129.)
Il est évident que l'r des trois premières rimes s'éteignait, puisque ces mots ours, decours, secours, riment avec courroux.
Cette prononciation du mot ours le rendait parfaitement homonyme d'oue (oie). C'est pourquoi la rue aux Oues, peuplée jadis de rôtisseurs, est aujourd'hui la rue aux Ours. Pour accomplir cette métamorphose des oies en ours, il n'a fallu que la main de l'ouvrier chargé d'écrire l'inscription à l'angle de cette rue, que le peuple continue d'appeler sagement rue aux Oues.
R, comme liquide, avait sur les voyelles a et o la même influence que l'autre liquide l.—Nous avons vu que al, ol, sonnaient isolément au, ou; l'r partageait ce privilége, qui se combinait en outre avec l'usage du grasseyement.
Par exemple, cors, de corpus ou de curtus; cort, de chors, la cour, sonnaient également cou, l'o prenant le son ou, et l'r tombant par le grasseyement et par la règle de la consonne finale muette. Ainsi cours rime avec genoux:
Avant retaste et puis arriere,
Tant qu'il rencontre les genoux;
Si cuide avoir trové os cors (os breve)
C'on i ait mis por le sechier.
(Le Fabel d'Aloul.)
Por sonnait pou, comme le prononce encore le peuple: c'est pou rire.
Tor, jor; tour, jour; de là vient que Bordeaux était anciennement prononcé Bourdeaux. Bordeaux a prévalu dans l'usage, et, au contraire, la forme primitive Bologne a cédé la place à Boulogne.
Le for l'évêque était le lieu où l'évêque exerçait sa juridiction, forum episcopi, comme le for intérieur est le tribunal intérieur, la conscience. Le peuple ne manquait pas de dire le four l'évêque (le mot for intérieur n'ayant jamais été à son usage, est demeuré for intérieur): On l'a mis au four-l'évêque. Là-dessus, Ménage s'imagine que, dans cette forme populaire, four signifie un four à cuire le pain. «Il reste à décider, dit-il, qui est le meilleur de for-l'évesque ou de four-l'évesque; c'est sans doute for-l'évesque.» Et il ajoute sa grande raison, après laquelle il ne reste plus qu'à s'incliner: «C'est ainsi que parlent les honnêtes gens.» (Obs., pag. 431.) Les honnêtes gens, selon Ménage, sont ceux qui savent lire; ceux à qui on ne l'a pas appris, et qui ne suivent que la tradition orale, ne peuvent pas être honnêtes. Cela n'empêche pas qu'ils ne puissent quelquefois avoir raison contre les autres, par exemple, dans le cas de four l'évêque.
Estula avoit nom li chiens;
Mes de tant lor avint il biens
Que la nuit n'est mie en la cort.
Et li vallés prenoit escout.
(Estula, v. 45.)
«Le chien s'appelait Estula; mais ils (les voleurs) eurent cette fortune qu'il n'était pas cette nuit-là dans la cour. Et le jeune homme écoutait.»
Les noms propres Gérard, Girard, Évrard, étaient prononcés Géraud, Giraut, Évraud. Fontevrault est la fontaine-Évrard.
Cependant ce son de diphthongue n'avait pas toujours lieu. Quelquefois l'r tombait tout simplement en allongeant l'a ou l'o qui la précédait. Ainsi lard, gars, char, sonnaient lâ, gâ, châ, très-long. Lard rimait ainsi avec gras. Voyez plus haut l'article du grasseyement.
L'r finale précédée de l'e, ne lui communiquait pas le son eu, mais seulement le son de l'é fermé; propriété qu'elle a conservée dans notre système; par exemple: Roger, bûcher, et les infinitifs de la première conjugaison.
Dans toute la Normandie on prononce encore la mé pour la mer, du fé pour du fer. Le ca d'Antifé est le cap d'Antifer.
Considérez quel bénéfice nous a produit la confusion de la mer (mare) avec la mère (mater): il est devenu impossible de faire rimer la mer avec aimer, ou bien il faut alors rimer exclusivement pour l'œil, ce qui est absurde, et va directement contre le but de la versification.
La même difficulté se représente pour fer et étouffer, et pour une quantité d'autres: il faut opter entre l'œil et l'oreille. Le poëte, qui trouve avec raison son vocabulaire déjà bien assez pauvre, se décide pour l'œil, et de là ces rimes indigentes qui n'existent que sur le papier. Nos pères avaient bien plus de bon sens, qui se préoccupaient d'abord et avant tout du son, et de charmer l'oreille. J'aime bien mieux qu'on me fasse rimer l'hivé avec planter, que de me faire rimer l'hivere avec trouver. Et encore, c'est que le poëte moderne, qui me blesse l'oreille, tournera en ridicule le poëte du moyen âge, et me contraindra, Richelet en main, d'avouer que la rime de l'autre est fausse, et que la sienne est une rime riche! En vérité, l'habitude fait passer d'étranges choses!
On conviendra qu'il est très-fâcheux de trouver dans la Fontaine des rimes qui n'en sont pas, telles que celles-ci:
La belle étoit pour les gens fiers.
Fille se coiffe volontiers
D'amoureux à longue crinière.
Cette rime était excellente dans le temps qu'on prononçait fiés et non fières.
Sous le règne de Louis XV et même de Louis XVI, la vieille cour maintenait la véritable prononciation de l'r finale dans les substantifs en eur. Elle disait des porteux, des passeux, des précheux, etc.; ce qui n'est qu'une application particulière de la règle générale.
En termes de chasse, on ne prononce jamais autrement que des piqueux. Sur quoi je ferai observer combien les vocabulaires techniques sont d'excellents témoins du vieil usage, et combien il serait à désirer qu'on eût des dictionnaires sûrs et complets des termes de droit, de ceux de marine, de chasse, de pêche, etc., etc. Ces termes, aujourd'hui sortis de la langue usuelle, en faisaient partie quand l'art ou le métier auquel ils appartiennent a commencé d'être connu chez nous. Ils se sont conservés et transmis par la routine, chose meilleure qu'on ne croit, et sont des témoins infaillibles.