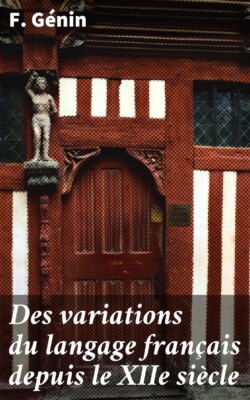Читать книгу Des variations du langage français depuis le XIIe siècle - F. Génin - Страница 21
K.
ОглавлениеIl n'y a rien à dire du k comme finale, puisqu'il ne paraît jamais à la fin d'un mot.
Mais il est fréquent comme initiale, et beaucoup plus fréquent qu'on ne le croirait si l'on s'en fiait au rapport des yeux. En effet, la notation par ch était pour le langage identique à celle du k. On employait indistinctement l'une ou l'autre: le même manuscrit écrit carles, kalles; karlemaine, challemaine; charlon, carlun, kallon.—C'est ainsi que le nom propre Callot est le même que nous voyons écrit Charlot.
Nous prononçons aujourd'hui chaud, qui vient de calidus; nos pères écrivaient chalt, et prononçaient caud.
Chambre, de camera, est aussi souvent écrit cambre;—chanson, canson;—charn, carn (carnem), aujourd'hui chair;—chaîne, de catena; chastier, de castigare; chien, de canis; chaïr, de cadere; chaste, de castus; chanoine, de canonicus; charbon, de carbo; chanut, aujourd'hui chenu, de canutus; chape ou cape, de caput; tous ces mots, et une multitude de semblables, se rencontrent figurés par ch, c ou k, et les trois formes, je le répète, dans le même manuscrit. En rapporter des exemples serait chose infinie; il suffit d'ouvrir la chanson de Roland, ou le Livre des Rois, ou le premier texte venu du moyen âge. Les plus anciens sont toujours les meilleurs.
La valeur attachée actuellement à cette notation ch est moderne, on peut en être sûr.
Rien ne l'autorise que l'imitation des étrangers, puisque l'étymologie prescrit partout le son rude du k.
Car pourquoi prononcez-vous de même le cœur d'un homme et le chœur d'une église? Comment n'êtes-vous pas choqués de prononcer un choriste? d'avoir l'adjectif charnel et le substantif carnage, qu'on écrivait charnage autrefois? On emploie aujourd'hui des charpentiers; on ne connaissait jadis que des carpentiers, comme vous l'atteste le nom propre, témoin irrécusable. Avouez qu'un char fuyant dans la carrière est une inconséquence; les Picards n'ont point à se la reprocher, qui disent un kar et une karette. On se croit dans le bon chemin, parce qu'on suit la mode; ce sont les Picards qui sont dans le bon kemin (caminus, Du Cange), parce qu'ils suivent l'étymologie et les coutumes de nos pères.
Les notations cu, qu, équivalaient au signe k. Queux, cuider, cuisine ou quisine, étaient prononcés keux, kider, kisine, et le plus souvent même figurés ainsi. La distinction du son de l'u dans ce groupe, date du milieu du XVIe siècle seulement. Elle fut introduite par les ecclésiastiques, non sans résistance; car on cite un bénéficier qui fut dépouillé de ses bénéfices pour s'être obstiné à garder l'ancienne mode, et à prononcer kiskis et kankan, pour quisquis et quanquam. On sait la part que prit dans cette ridicule affaire le malheureux Ramus: il tenait aussi pour kiskis. Bien que ses adversaires aient triomphé, grâce à l'adresse qu'ils eurent de mettre le roi et le parlement de leur côté, l'on prononce encore aujourd'hui ki, kelle, et un kidan (quidam). Quem sonnait kem, ou plutôt kan. Nous nous en souviendrons plus tard, quand nous rechercherons l'étymologie de péquin.