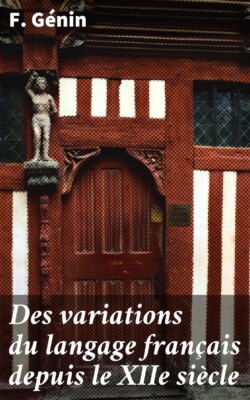Читать книгу Des variations du langage français depuis le XIIe siècle - F. Génin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SECTION PREMIÈRE.
INITIALES.
ОглавлениеIl faut appuyer par des exemples ce que nous venons de dire sur les doubles consonnes.
Au chapitre IX de Gargantua, Rabelais dit que les faiseurs de rébus, abusant de l'homophonie de certains mots, faisaient peindre une sphère pour signifier espoir. Donc la prononciation confondait ou du moins rapprochait beaucoup ces deux mots. Je suis convaincu qu'on prononçait de l'épouère.
Observez tous les mots tirés du latin, et commençant dans cette langue par deux consonnes st, sp, sc, etc.: vous les verrez tous commencer en français par un e euphonique. Spongium, esponge;—strangulare, estrangler;—stannum, estain;—spiritus, esprit;—spatium, espace;—scandalum, esclandre, etc., etc. De même pour les mots empruntés à l'italien: spada, espée;—strano, estrange;—snello, isnel, en allemand schnell (celui-ci a reçu l'i au lieu de l'e initial); sparmiare, espargner.—Vous n'en trouverez pas un seul qui échappe à cette loi, ou bien ceux que vous trouverez, vous pouvez conclure sûrement qu'ils sont de formation moderne. C'est un indice de l'âge des mots. Spectre, squelette, spectacle, sont tard venus dans la langue. Espace, estomach, sont anciens; les adjectifs spacieux, stomachal, sont modernes. Quand on les a faits, depuis longtemps était oubliée la règle qui doit présider à la formation des mots, et par laquelle nos pères obviaient à la dureté des doubles voyelles initiales.
Et qui peut affirmer que cette prononciation ne fût pas transmise par les Latins?
Les dialectes méridionaux, bien plus voisins que notre français du langage romain, affectent toujours cet e euphonique. Les Gascons parlent mal, selon nous, en disant un esquelette, un espectacle; mais les Espagnols parlent très-correctement leur langue lorsqu'ils disent espectaculo, espectro, esqueleto, espejo (de speculum), etc.
Outre la ressource de l'e préposé, il y en avait une autre plus rare, et réservée spécialement pour les mots commençant par un p, suivi d'une consonne dure: c'était d'abattre tout uniment le p initial dans la prononciation. On écrivait ptisane, du latin ptisanum, et l'on prononçait tisane. Ce p étymologique s'est conservé sur le papier jusqu'à la fin du XVIIe siècle: les grammaires avertissaient de le supprimer en parlant.
Marot écrit encore psalme, de psalmus; on prononçait saume. Les sept saumes de la penitence. Ménage remarque que les ecclésiastiques de son temps affectaient de prononcer psaumes, en faisant sentir le p. Le peuple a toujours dit saume, sautier, comme au moyen âge:
Tant qu'il jurerent sor lor vie,
Seur la crois et seur le sautier,
Et seur toz les sains du moustier…
(De Constant Duhamel.)
Et ele sot tot son sautier.
(De frere Denise, v. 152.)
«Et elle sut tout son psautier.»
La psallette, qui est l'école annexée à l'église et où l'on instruit les enfants de chœur, se prononce la sallette, au témoignage de Ménage (Obs. sur la langue française, p. 93). Il observe qu'on dit cependant toujours le psalmiste et psalmodier. C'est à cause de la formation relativement récente de ces mots. Saume, sautier, ont été faits par le peuple et bien faits; psalmiste, psalmodier, ont été introduits par les savants enfarinés de grec et de latin. Or, les premiers seuls parlent français.