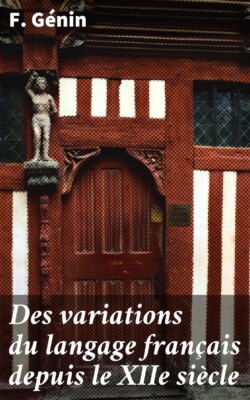Читать книгу Des variations du langage français depuis le XIIe siècle - F. Génin - Страница 10
§ II.
L, M ET N REDOUBLÉES.
ОглавлениеL redoublée, ll, avait toujours, comme en espagnol, la valeur des deux l mouillées de bouilli, caillou. L'orthographe moderne veut toujours un i au moins avant les deux ll mouillées. Dans l'origine, il suffisait que les ll fussent entre deux voyelles. L'i se mettait ou s'omettait sans conséquence. Paillard s'écrivait sans i, pallars.
Quand li pallars le vit entrer.
(R. du chast. de Coucy, v. 4054.)
Coucy reçoit une assignation amoureuse: Sire, lui dit Gobert, son confident:
Sire, bien plaire
Vous doit ce mandement, sans falle,
Et vous irez vaille que valle.
(Ibid., v. 6535.)
Sans faille, sans faute.—La double orthographe du mot vaille, dans le dernier vers, ne laisse pas même la ressource de supposer qu'on prononçât alors autrement qu'aujourd'hui.
Mellor, mervelle, conselle, aparelle, sonnaient avec les ll mouillées.
Car cis aime miols les mellors,
Et tient bas sos piez les piors.
(Partonop., v. 4330.)
«Car celui-ci préfère les meilleurs (les braves), et tient les pires (pejores) bas sous ses pieds.»
Et li conselle et loe et prie.
(Ibid., v. 4455.)
Une lanterne atant li baille;
La candelle qui art dedans
N'estaint por orez ne por vens…
Il apparelle son aler.
(Ibid., 4465.)
«A ces mots, il lui remet une lanterne. La chandeille7 qui brûle dedans ne s'éteint ni pour orages ni pour vents. Partonopeus s'apprête à partir.»
[7] C'est l'ancienne prononciation, conservée avec soin dans toute la Picardie.
Partonopeus le voit el vis
N'est mervelle s'il est permis.
(Partonop., v. 7410.)
La chanson de Roland écrit consell, amirall; c'est conseil, amirail, quand suit une voyelle; autrement, conseu, amirau, comme on le rencontre souvent figuré.
C'est la marque d'un manuscrit relativement récent lorsqu'on y trouve le féminin elle par deux l, comme aujourd'hui. Les textes les plus anciens écrivent toujours ele; elle, dans l'origine, aurait sonné eille.
La règle actuellement encore en vigueur, par laquelle une consonne redoublée rend brève et ouverte la voyelle précédente, cette règle n'était pas connue au XIIe siècle. Doubler les consonnes eût semblé une superfluité, hormis le cas où il s'agissait de rappeler une syncope. Le plus ancien manuscrit français, le Livre des Rois, écrit toujours femme par deux m, feminam, fem-ne, fem-me. La règle était de répartir la consonne doublée entre les deux syllabes adjacentes, et de prononcer fan-me.
D'animam on fit d'abord aneme, comme d'imaginem, multitudinem, imagene, multitudine, formes constantes dans saint Bernard et dans les Rois. Les Rois écrivent souvent aussi anme; c'est la prononciation la plus voisine d'aneme. La chanson de Roland n'emploie jamais d'autre forme:
Guaris de mei l'anme de tuz périls…
Morz est Rolans: Deus en ad l'anme es cels!…
(St. 173.)
Abélard, dans l'histoire de sa vie:
«Et moy qui estois son filz ainsnés, de tant qu'il m'avoit plus chiers, de tant mist il plus grant cure que je fusse plus diligenment (diligen-ment) aprins, Et je, de tant come je proufitay plus et plus legierement (facilement) en l'estude des lettres, de tant m'y enhardige plus ardanmant.»
(Trad. inéd. de Jean de Meung.)
D'après cela, et pour voir comme l'on prononce mal aujourd'hui, considérez ce passage des Femmes savantes:
PHILAMINTE.
Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire?
MARTINE.
Qui parle d'offenser grand-père ni grand'mère?
Le jeu de mots est exact suivant la bonne prononciation d'autrefois; il ne l'est pas suivant la méthode aujourd'hui en usage, de jeter les deux m dans la seconde syllabe, et de prononcer la gra-mmaire. De ces deux m, l'une appartient à la première syllabe, l'autre à la seconde, ce qui confond tout à fait la gram-maire avec la grand'mère.
Le nom propre Grammont se prononce aussi mal gra-mmont. C'est gram-mont qu'il faut dire. Jadis on écrivait le plus souvent grandmont, en latin grandimons. Le d est tombé d'abord, parce qu'il ne servait qu'à noter l'étymologie, et disparaissait dans la prononciation; ensuite on a mal à propos réuni les deux m en une seule, et voilà comment le nom a fini par se trouver défiguré en Gramont.
Le mot nenni, autrefois si usité dans certaines provinces, et même à Paris sous François Ier, lorsqu'on le rencontre dans Marot ou ailleurs, on ne sait plus le prononcer. Le plus grand nombre dit né-ni; c'est ainsi qu'il est estropié au théâtre. D'autres, en petit nombre, na-ni. Allez donc en Lorraine apprendre à prononcer nan-ni, en traînant sur la première syllabe.
Je préviens ici une objection qu'on ne manquerait pas de me faire, en trouvant plus loin, dans des citations, femme, âme, figurés fame, ame. La contradiction n'est qu'apparente, et se concilie par l'âge des manuscrits, où les copistes introduisaient l'orthographe de leur temps. Tout ce qu'on en peut conclure, c'est que la prononciation actuelle des mots femme, âme, remonte très-haut; mais l'autre l'avait certainement précédée, et la règle générale se maintint encore longtemps après que les mots fame et ame y faisaient exception. Nous serions trop heureux d'avoir les manuscrits originaux, ou seulement contemporains des auteurs! C'est déjà un grand bonheur, et dont il faut remercier le hasard, que les plus anciens textes nous soient parvenus dans les plus anciennes copies.
Il y a encore des provinces où l'on prononce malhon-nête. Je ne prétends pas que ces sons du fond de la gorge, fan-me, malhon-nête, très-fréquents dans notre vieille langue, fussent plus agréables que ceux du bout des lèvres par lesquels on les a remplacés. D'ailleurs, nous ne pouvons guère juger ces questions impartialement, étant séduits par l'habitude. Mon unique but est de montrer que ces inconséquences apparentes, si multipliées dans notre langage, ne tiennent pas au fond de la langue, mais sont des déviations résultant de l'oubli des règles primitives.