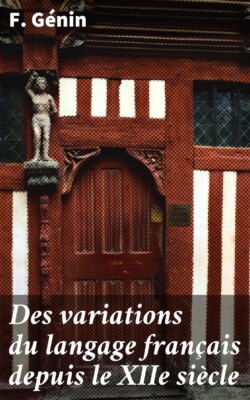Читать книгу Des variations du langage français depuis le XIIe siècle - F. Génin - Страница 9
§ Ier. QUE GN SONNAIT SIMPLEMENT N.
ОглавлениеMontagne, Champagne, formés de montana, campana (sub. terra), se sont prononcés montane, campane. Le g y était muet, la preuve en est qu'on le rencontre dans les mêmes textes avec ou sans le g:
—«… Cum des sicomors ki creissent en la Champagne.»
(Rois, III, p. 275.)
—«Li reis Sedecias s'enfuid par la campaigne del desert.»
(Rois, IV, p. 435.)
L'ancien nom de renard est goupil, dérivé de vulpes, voulpil ou goupil, d'où nous gardons encore goupillon, parce que cet instrument était fait de poil de renard, ou parce qu'on se servit d'abord d'une queue de renard pour goupillon.
Ce mot renard ne remonte pas plus haut que le XIIe siècle, époque où parut le fameux roman de Perrot de Saint-Cloud. Chaque animal qui y joue un rôle porte, outre son nom générique, une espèce de nom de baptême ou de sobriquet. Le loup s'appelle Isengrin; l'ours, dom Bruyn; le coq, Chanteclair; le goupil, Regnard; ainsi des autres. Le prodigieux succès de cette composition, qui était la grande comédie de mœurs de l'époque, fit entrer dans la langue le nom du héros comme substantif commun, ce qui s'est depuis renouvelé pour Tartufe, et peu à peu Regnard a supplanté Goupil. Le mot tartufe n'a pas fait disparaître le mot hypocrite. Apparemment on a trouvé que, pour désigner le renard, c'était assez d'un substantif, mais que pour les hypocrites, ce n'était pas trop de deux.
Regnard vient par syncope de Reginaldus. C'était, dit la tradition, un grand seigneur de la cour d'Austrasie, de qui le caractère servit de type à celui du Goupil de Perrot de Saint-Cloud.
Reginaldus a fait reginald ou reginard, qui, par les règles qu'on verra tout à l'heure concernant les finales, ont donné l'un regnault, renaud, reynaud; l'autre, regnard, renard, reynard.
Il faut dire le roman DE Renard, et non DU renard, puisque, dans ce titre, Renard est un nom propre.
Le nom de notre second poëte comique doit se prononcer Renard, quoiqu'il s'écrive Regnard, parce que ce g étymologique n'a jamais sonné.
On rencontre, dans le roman de Renart et ailleurs, le mot borgne ainsi figuré, borne. Renart, toujours défiant, ne veut pas s'approcher du cheval pour lire le nom écrit sous le pied de cet inconnu. Pour s'en dispenser, il allègue sa mauvaise vue:
Lors renart a les yeux couvers,
Le borne fait, et le travers.
(Renart contrefait.)
Les ennemis d'Abélard, déterminés à ne lui laisser aucun repos, même après l'avoir forcé de fuir Paris et de se réfugier avec ses disciples dans la solitude, lui imputèrent à hérésie d'avoir appelé son église et son monastère le Paraclet:—«Et disoient que nulle esglise ne devoit pas estre assinée especialement au Saint-Esprit plus que a Dieu le Pere, ou a son Fils, ou a toute la Trinité ensemble.» (Trad. inéd. de Jean de Meung.)
Beaumarchais, dans ses mémoires étincelants de verve, s'égaye aux dépens de ce pauvre Lejay, qui, au bas d'un acte controuvé, avait écrit de sa main, siné Lejay, pour signé Lejay. C'était l'antique prononciation. Dans la chronique arbitrairement et à tort baptisée Chronique de Rains: «La roine se sina de la main diestre;» et le dictionnaire de l'Académie, en 1835, nous prévient encore que dans signet d'un livre le g ne se prononce pas, et qu'il faut dire sinet.
Le nom de Lusignan, dans la même chronique, est toujours écrit Lusinan.
Le XVIe siècle retenait la vraie prononciation. Voyez, pour preuve, les rimes de ce rondeau, adressé à Marot par Étienne Clavier:
Pour bien louer une chose tant digne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dont de despit souvent me paye et disne,
Car je connoy que le fond et racine
De ses escriz ont prins leur origine.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Donc, orateurs, chascun de vous consigne
Termes dorés puisés en la piscine
Palladiane, etc.
(Œuvres de Marot, t. III, p. 26.)
Les relations que le mariage de Louis XIII établit entre la France et l'Espagne, introduisirent chez nous la langue et les usages espagnols; la prononciation usitée par delà les Pyrénées pour l'n con la tilde, s'attacha dès lors à cette notation gn, et le XVIIe siècle n'en connut plus d'autre.
«Tous les Parisiens généralement, dit Ménage, prononcent anneau au lieu d'agneau: une moitié d'anneau, un quartier d'anneau; qui est une prononciation très-vicieuse à la considérer en elle-même, à cause de l'équivoque d'anneau en la signification d'agnus, avec anneau en la signification d'annulus.»
Cette raison serait très-mauvaise, car il n'y aurait point là d'équivoque possible. Admettons un moment qu'on prononce anneau. Si l'on dit: J'ai mangé un morceau d'anneau, ou qu'on parle d'un rôti d'anneau, personne ne sera stupide au point de comprendre qu'on a mis en broche et avalé une bague. La langue est pleine de mots qui sonnent identiquement, à l'oreille sans aucun danger de confusion pour l'intelligence. Mais les grammairiens de profession, dès qu'ils sont en face d'une différence d'orthographe, recourent d'abord à cette explication: C'est pour distinguer. Ils croient toujours qu'on lit, et ne pensent jamais qu'on parle.
Ce qu'il y a de plus étrange, c'est que Ménage, tout en blâmant cette prononciation, prescrit de la suivre: «Mais comme ces messieurs (les Parisiens) sont les maîtres du langage, il faut parler comme eux, quand même ils parlent mal. Il faut donc dire avec eux un anneau, un cartier d'anneau, et non pas, comme nous disons dans nos provinces, un agneau, un quartier d'agneau. Quelques-uns croient qu'il faut dire l'agneau pascal.» (Observ. sur la lang. fr., p. 347.)
Il est suivi par l'auteur des Réflexions sur l'usage de la langue, et voici la docte règle qu'ils ont établie à frais communs: «Il faut prononcer de l'anneau en parlant de l'animal cuit, un anneau rôti; et s'il est vivant, de l'agneau, comme voici l'agneau de Dieu, l'agneau pascal5.»
[5] Voyez l'Art de bien parler françois, t. I, p. 20.
Et quand il n'est plus vivant et n'est pas encore cuit, comment doit-on l'appeler?
La première édition du dictionnaire de l'Académie autorise encore agneau et anneau, au choix. La seconde prescrit agneau.
Racine avait, comme la Fontaine, quelques prétentions confuses à la noblesse; mais eux-mêmes n'en savaient pas bien le conte. J'ai trouvé, sur des états manuscrits de la maison de François Ier, un Jehan Racine et un Jehan de la Fontaine, inscrits parmi les escuyers d'écurie. Ce sont probablement des aïeux de nos deux poëtes, qui eux-mêmes ignoraient cette belle généalogie. La Fontaine prenait le titre d'écuyer jusqu'à l'époque d'un procès qu'on lui fit, et qu'il perdit pour n'avoir pu fournir la preuve de son droit. Racine avait des armes, et qui plus est des armes parlantes, c'est-à-dire qui traduisaient son nom en rébus. C'était un rat et un cygne, qui, suivant la prononciation primitive, faisaient ra-cine. Dans une lettre à sa sœur madame de Rivière, l'auteur d'Athalie parle de sa noblesse généalogique: «Vous savez, lui dit-il, qu'il y a un édit qui oblige tous ceux qui ont ou qui veulent avoir des armoiries sur leurs vaisselles ou ailleurs, de donner pour cela une somme qui va tout au plus à 25 francs, et de déclarer quelles sont leurs armoiries. Je sais que celles de notre famille sont un rat et un cygne, dont j'avois seulement gardé le cygne, parce que le rat me choquoit; mais je ne sais point quelles sont les couleurs du chevron sur lequel grimpe le rat, ni les couleurs aussi de tout le fond de l'écusson. Vous me ferez un grand plaisir de m'en instruire. Je crois que vous trouverez nos armes peintes aux vitres de la maison que mon grand-père fit bâtir, et qu'il vendit à M. de la Clef. J'ai ouï dire aussi à mon oncle Racine qu'elles étoient peintes aux vitres de quelque église… J'ai aussi quelque souvenir d'avoir ouï dire que feu notre grand-père fit un procès au peintre qui avoit peint les vitres de sa maison, à cause que ce peintre, au lieu d'un rat, avoit peint un sanglier. Je voudrois bien en effet que ce fût un sanglier, ou la hure d'un sanglier, qui fût à la place de ce vilain rat!» (16 janvier 1697.)
L'élégant et délicat Racine était trop absorbé par sa juste douleur pour s'apercevoir qu'un sanglier et un cygne n'eussent pas fait Racine, et qu'après tout le vilain rat remplissait mieux son office que n'eût fait le noble sanglier. Le grand-père Racine paraît avoir porté dans cette affaire moins d'imagination que son petit-fils, mais un sens plus judicieux6.
[6] Au bas du portrait gravé par Edelinck, sont placées les armes de Racine; on n'y voit figurer que le cygne. L'auteur d'Athalie avait décidément expulsé le rat de son blason.
Mais si Racine, lié avec les courtisans de Louis XIV, ignorait la prononciation du XVIe siècle, la Fontaine, habitué à fréquenter chez nos vieux auteurs, la connaissait parfaitement; et quand tout le monde l'oubliait autour de lui, il a montré qu'il s'en souvenait.
Dans la fable de l'Autour, l'Alouette et l'Oiseleur:
Un manant au miroir prenoit des oisillons.
Le fantôme brillant attire une alouette;
Aussitôt un autour planant sur les sillons
Descend des airs, fond et se jette
Sur celle qui chantoit, quoique près du tombeau.
Elle avait évité la perfide machine,
Lorsque, se rencontrant sous la main de l'oiseau,
Elle sent son ongle maline.
(Liv. VI, fab. 15.)
Plus loin, parlant de la Discorde chassée du ciel, et que Jupiter ne savait où envoyer:
Comme il n'étoit alors aucun couvent de filles,
On y trouva difficulté.
L'auberge enfin de l'hyménée
Lui fut pour maison assinée.
(Liv. VI, fab. 20.)