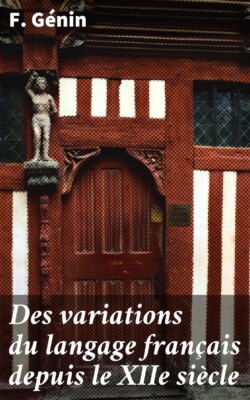Читать книгу Des variations du langage français depuis le XIIe siècle - F. Génin - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ IV.
LIQUIDE TRANSFORMÉE OU TRANSPOSÉE.
ОглавлениеTRANSFORMATION.—Le grasseyement conduisit à transformer l'r sur le papier, lorsque cette consonne était suivie d'une l; car alors l'r se changeait elle-même en l. Ainsi en avaient usé les Latins dans pellucidus, pellego, etc.
On écrivait donc parler, merle, ou, comme l'on prononçait, paller, melle.
Le héros du fabliau d'Auberée la vielle maquerelle, était célèbre dans le pays de Compiègne et même au delà:
De sa valor, de sa largesse
Palloit l'en jusqu'en Beauvoisin.
Palloit l'en, parlait on, on parlait.
Notre jaloux, dit Auberée au jeune amant, garde bien sa femme; mais
Ja ne la saura si garder
Que ne vos face lui paller.
Le nom propre Charles se prononçait Châ-les, qu'on a plus tard écrit Chasles. Charlemagne est souvent écrit Challemagne, Challes, Challon, Challot, pour Charlon, Charlot: l'écriture usait indifféremment des deux orthographes:
Challot, Challot, biauz doulz amis…
Challoz en est venuz au bois…
Charlot, se Diex me doint sa grace…
Hom n'en auroit pas, samedi,
Fait Charlos autant au marchié.
(Rutebœuf, De Charlot le Juif.)
Merlin se prononçait Mellin;—Merlot, diminutif de Merlin, Mellot.—«Le dit de Merlin-Mellot.» Prononcez de Mellin-Mellot.
Il y a, en Normandie, un château de Chantemelle; c'est Chante-Merle. La prononciation induisit à écrire Chantemesle. C'est mal à propos.
Orsignot, melle ne mauvis,
. . . . . . . . . . . . . . . . .
N'estoit si plaisans a entendre.
(Le lai de l'oiselet, v. 85.)
«Rossignol, merle ni alouette, n'était si agréable à entendre.»
Un merlan se prononçait un mellan. Dans le fabliau de saint Pierre et du Jongleur, saint Pierre, en l'absence du diable, descend en enfer, proposer une partie de dés au jongleur commis à la garde des chaudières: Hélas! je n'ai point d'argent, dit le jongleur.—Mets des âmes au jeu, répond saint Pierre, qui avait fait son plan de tricher pour tirer d'affaire les pauvres damnés, comme de fait il y réussit:
Dist li jougleres: C'est a droit.
Lors jete deseur le berlenc.
—Cis cops ne vaut pas un mellenc,
Dist saint Pierre; perdu l'avez.
(Barbaz., II, 195.)
L'auteur de ce joli fabliau était Picard. Le peuple d'Amiens prononce encore un mélan.
De même le verbe hurler sonnait huller.
Dans le Renart contrefait, par Jacquemars Gielée, Renart, voyant sa propre image reflétée dans l'eau d'un puits, croit apercevoir sa commère Hersent:
Lors a hullé une grant foiz.
Roland, traversant une forêt, entend au loin la chasse du roi:
Les veneors du roy oï priser, corner,
Et les chiens d'altre part et glatir et usler.
(Gerard de Viane, v. 155.)
La rue du Grand-Hurleur est inscrite, dans le catalogue de l'abbaye Saint-Germain (1450), rue de Hulleu;—rue de Hurleur. Lebœuf a prétendu que le nom de cette rue devait s'écrire Hue-le, parce qu'il y avait probablement une maison de prostitution, et que probablement aussi le peuple huait tous ceux qu'il en voyait sortir. C'est une heureuse imagination!
Pourquoi écrivons-nous un chambellan, sinon par la tradition de la prononciation ancienne? Vous voyez dans les vieux auteurs chamberlan, ou chambrelan, cambrelanc, etc…
Antoine de la Salle, l'auteur de ce charmant livre du Petit Jehan de Saintré, le Télémaque du XVe siècle, nous apprend, au chapitre II, que la jeune dame des belles Cousines, depuis le trépas de feu monseigneur son mari, «ne se voult remarier pour quelque occasion que ce feust, pour ressembler aux autres vrayes vesves de jadis, dont les histoires romaines, qui sont les suppellatives de toutes, font tant de glorieuses mencions.»
Mellusine est pour Merlusine ou plutôt mère Lusine, mère des Lusignan, dont le nom se prononçait Lusinan, témoin ce passage et une foule d'autres de la chronique mal à propos intitulée Chronique de Rains: «Et eschei li roaumes a une siene sereur qui estoit en la terre de Surie, et estoit mariee à monsignor Guion de Lusinan.» (P. 18.)
Quant à la fée Mellusine, qui épousa Raymond de Lusignan et fut la tige d'une illustre et nombreuse famille, ce n'est pas ici le lieu de raconter sa merveilleuse histoire; il suffit de dire que lorsqu'un de ses descendants devait mourir, elle apparaissait la nuit sur les murs de son château, poussant des cris lamentables; d'où le peuple a dit, en commun proverbe: des cris de Mère Lusine. L'Académie prescrit de dire: cris de Mélusine. Madame de Sévigné écrit Mellusine par deux l.
TRANSPOSITION.—On usait souvent aussi de la seconde ressource quand l'r suivait une voyelle, étant suivie elle-même d'une consonne; c'était de la transposer en avant de la voyelle. On écrivait formage, à cause de forma, formago, formagium (Du Cange), mais on prononçait fromage;—ferpes (ferpatæ vestes, habits troués, effiloqués, guenilles), et on prononçait frepes, d'où freperie, friperie.
Apres ne doy oublier mie
Saint Seurin, pour la ferperie
Qui est achatée et vendue
En son carrefour.
(Le Dit des Moustiers.)
On dit encore en Picardie flepes, par la substitution d'une liquide à l'autre. Aller à flepes, c'est porter des guenilles. Un manteau efflepé.
Nos pères faisaient fourmi du masculin: li formiz. Le peuple dit toujours un fremi.
Pormener ou pourmener, sonnait proumener.
Quant la porcession fut hors du grant moustier,
Felix par la main destre a pris le chevalier.
(Le Dit des trois Moines.)
C'est la procession.
Furetière témoigne qu'on disait autrefois porfil (contour), au lieu de profil; c'est-à-dire qu'il a rencontré ce mot écrit porfil. Effectivement, je trouve dans un fabliau du XIIIe siècle:
Li surcoz fu toz a porfil
Forrez de menuz escureax.
(D'Auberée la vielle maquerelle.)
«Le surcot était tout autour garni d'une fourrure d'écureuil.»
Mais le changement a eu lieu dans l'orthographe et non dans la prononciation, qui a toujours été profil.
Fremer, défremer, pour fermer, défermer, se dit encore en Picardie:
En la grange le moine, si li a defremée…
L'ostesse s'emparti, à la clef frema l'huis.
(Le Dit du Buef.)
—«Que vous dirois jou? la pais fu faicte et confremée.» (Villehard., p. 185.)
Dexter a fait dextre, et sinister, senestre. On prononçait dêtre et senêtre, comme fenêtre. L et r étant deux liquides, ne comptent pas à la seconde place pour des consonnes entières; cependant le désir d'obtenir un mot plus coulant à l'oreille a déterminé quelquefois une transposition superflue en principe. Ainsi l'on a dit, au lieu de dêtre, drète. Ensuite, à cette forme féminine, on a créé le masculin dret, que l'on a écrit plus tard droit, droite; et voilà comment droit dérive de dexter, par métathèse ou transposition.
Faible vient de même de flebilis, et a existé sous la forme floible (flouèble). Dans le Livre des Rois, dans saint Bernard, dans les Moralités sur Job, on ne rencontre jamais que floibe, afloibir; floibeteit, pour faiblesse, de flebilitas. Jean de Meung, dans sa version d'Abélard, n'emploie jamais que floibe; le roman de Berte aus grans piés nous montre déjà ce mot avec deux l, dont la seconde seule a survécu:
Mais elle avoit el bois receu trop male rente
Que de plusieurs meschiefs ot eu plus de trente,
Si que ne pot mengier, tant fu et floible et lente8.
(Berte aus grans piés, p. 72.)
[8] Ce dernier exemple donne lieu à une observation que je ne veux pas différer, bien qu'elle soit anticipée et hors de la matière que nous traitons en ce moment.
La mesure de ces vers prouve qu'il faut prononcer dans le premier receu en deux syllabes, comme il est aujourd'hui; et dans le second, é-u, avec diérèse, c'est-à-dire séparation des voyelles.
J'espère faire voir plus loin que la langue française, dans l'origine, n'avait point de diphthongues; qu'on prononçait é-u, vé-u, bé-u, recé-u, etc., etc.
La difficulté gît bien moins à constater de pareils faits, qu'à en limiter l'étendue et la durée; d'autant qu'il y a toujours eu un moment plus ou moins long où les deux formes étaient en concurrence et subsistaient ensemble.
Observons donc, puisque l'occasion s'en présente, que Adenes, l'auteur de Berte aus grans piez, était contemporain de S. Louis; qu'ainsi, dès le XIIIe siècle, la diphthongue commençait à s'établir pour le participe passé en u. On la faisait ou on ne la faisait pas, selon le besoin.
Théodore de Bèze, en 1584, nous apprend que de son temps on conservait religieusement l'habitude de la diérèse dans le pays Chartrain et dans l'Orléanais, comme fait encore le peuple de Paris pour le seul participe eü.
Les Picards ont toujours affectionné la terminaison en u, et prononcé Diu, fiu, du fu, le liu, les yus. Or, l'influence picarde ayant été prédominante dans le français, à cause du nombre considérable de poëtes fournis par la Picardie, au moyen âge, il est vraisemblable qu'il faut attribuer à cette influence la forme qui a fini par prévaloir.
Remarquez aussi qu'Adenes, ménestrel du duc de Brabant, Henri III, vivait dans le voisinage de la Picardie: son langage devait s'en ressentir.
Saint Sulpice est appelé par le peuple saint Suplice, et c'est comme l'écrit l'auteur du Dit des Moustiers de Paris:
Apres, saint Pere du sablon
Et saint Souplis i assemblon.
Un brelan s'est d'abord écrit un berlan, un berlenc (le c euphonique):
Un berlenc aporte et trois dés
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lors jete dessus le berlenc:
—Cis cops ne vaut pas un mellenc!
(De S. Pierre et du Jongleur.)
On prononçait un bellan, comme un mellan, ou bien plutôt un brelan, parce qu'il était facile et doux de reporter l'r de berlan, ce qui ne se pouvait faire pour merlan.
Berbis, formé de vervex, est devenu brebis. Les anciens textes du XIIe siècle, saint Bernard, les Rois, écrivent toujours berbis. On n'a jamais prononcé que brebis.
Et bergier, par la même raison, se prononçait breger.
Hernaïs, le neveu de Garin, se rend à l'armée suivi de cent braves chevaliers:
Il n'i vint pas comme villain bregier,
Mais comme prou et vigoureux et fier.
(Garin, t. I, p. 133.)
Il existe un nom propre Bregé;—c'est Berger.
Héberger, hébreger:
Et sachiez bien que nul escamp
Ne querrons de vous hebregier,
Que ne semblez mie bregier.
(La Violette, p. 79.)
—«Cuens des blans dras, cuens des blans dras, te deust ore avoir nus essoigne tenu que tu… ne l'eusses hebregié et recueilli?» (Villehard., p. 196.)
Un des plus curieux exemples de la transposition de l'r se trouve dans la chanson de Roland, où le nom de la province de Frise est toujours écrit Fizer; mais on est averti par la rime:
Li reis serat as meillors pors de Fizer
S'arrere guarde aurat detres sei mise.
(St. 43.)
On voit ici l'r avancer de deux syllabes; c'est comme dans le mot Fontevrault (Fons Ebraldi), qu'on prononçait, du temps de Louis XIV, Frontevault. Ménage a grand soin de nous en avertir. Cependant il n'y avait pas ici nécessité absolue, l'r étant aussi bien liquide après le v qu'après l'f; mais comme l'f est plus forte, l'r s'y appuie mieux.
C'est le même motif qui a changé boucle en blouque:—«… La grant espée de parement du roy, dont le pommeau, la croix, la blouque… estoient couverts de veloux azuré.»
(Monstrelet, III, fol. 22, 1572.)
Lorsqu'il s'agit de transporter en français le mot spiritus, comme il n'y avait pas moyen de garder les deux consonnes consécutives, on usa de la ressource convenue en pareil cas, qui était de les faire précéder d'un e et d'éteindre ensuite l's dans la prononciation, en donnant à l'e le son fermé.—On supprimait la terminaison latine.
Cela produisit le mot espir, qui est la forme écrite la plus ancienne, la seule à peu près qu'on rencontre dans les textes du XIIe siècle, et qui se montre encore quelquefois dans les manuscrits du siècle suivant.
—«Cis filh vivent dedans par espir ki defors muerent par char.» (Job, 504.)
«Ces fils vivent au dedans par l'esprit, qui au dehors meurent par la chair.
—«La splendors del Saint Espirs.» (Ibid., 513.)
Mais on transposait l'r, et l'on prononçait comme bientôt on l'écrivit, esprit.
Amis, de part le Saint-Espir,
Tos tes voloirs veuil accomplir.
(De S. Pierre et du Jongleur.)
«De par le Saint Epri—tous tes vouloirs veuil accompli.»
Fierte vient de feretrum. D'après les règles précédentes, vous prononcerez fetre, ie valant é accentué, et l'r se transposant après le t:—La fetre de saint Romain. Ce mot se rapproche de feretrum bien plus que fiere-te.
Le peuple, fidèle à cette habitude de transposer l'r pour fuir deux consonnes consécutives, persiste à nommer un épervier, un éprevier. C'est l'antique prononciation. Turold nous apprend que Barbamouche, le cheval du Sarrasin Climborins, était plus rapide qu'épervier ni hirondelle:
Plus est isnels qu'eprever ne arunde.
(Chans. de Roland, st. 115, v. 10.)
L'ancien dictionnaire de l'Académie enregistre cette prononciation sans la blâmer ni l'approuver; mais Ménage, de son autorité privée, décide que épervier est la seule prononciation légitime. C'est dans ses Réflexions sur la langue françoise, dans ses Observations il s'était contenté de dire:
«Celui qui porte les épreuves (d'une imprimerie) s'appelle épervier, par corruption pour épreuvier, ou par allusion à un épervier, à cause qu'il doit voler et voler viste comme un épervier, en portant et rapportant les épreuves. Et à ce propos, il est à remarquer que nos anciens disoient éprevier, au lieu d'épervier.» (Obs., p. 336.)
Tout le génie étymologique de Ménage brille dans cette conjecture sur l'épreuvier, qui vole comme un épervier.
De verus on a fait voir, qu'on prononçait vouére, quand l'r finale était suivie d'une voyelle: voir est, verum est. Mais quand le second mot commençait par une consonne, on ne pouvait plus conserver l'r à la fin, ce qui eût ajouté un e muet et donné deux syllabes au lieu d'une. Que faisait-on alors? On transposait l'r en parlant, et, tout en écrivant voir, on prononçait vroi, vroué, et finalement vrai.
Enfans, ce dist Aymon, soyez bien retenans
Ce que vo mere dist, car elle est voir disans.
(Les quatre fils Aymon, v. 138.)
Car elle est vré disant, et non voire disant, qui romprait la mesure.
La broderie fut inventée pour orner le bord d'un vêtement. Border, broder, c'est le même mot; l'un est le mot écrit, l'autre le mot parlé.
On écrivait poverté à cause de paupertas, mais on prononçait povreté:
Ben a cinq ans qu'ai chi devant esté
Ne puis veoir riens de lor poverté.
(Ogier, v. 7590.)
Verté, contracté de vérité, prononcez vreté.
Quand l'empereur entendi la verté.
(Ogier, v. 424.)
La ferté est par syncope pour la fermeté; firmitas, dans la basse latinité, est une forteresse. La Ferté-Milon, la Ferté-sous-Jouarre, c'est la Forteresse-Milon, la Forteresse-sous-Jouarre. Mais en écrivant la Ferté par respect de l'étymologie, on ne prononçait pas, comme aujourd'hui, la Fereté en trois syllabes. A quoi aurait-il servi de syncoper Fermeté? On prononçait la Freté, et il est arrivé quelquefois aux copistes de l'écrire ainsi: l'auteur du Roman de Gaydon dit que Thibaut d'Apremont possédait, outre cette terre, la noble forteresse de Hautefeuille:
Suens fu Mont aspres, s'en tint les heritez,
Et Haute foille, celle noble Fretez.
(Intr. du Roland, p. 24.)
«Sien fut Montaspres, il en tint les héritages, et Hautefeuille, cette noble ferté.»
Liber, libre; libertas, libreté, quoiqu'on écrivît liberté.
Virtus, vertu, c'est-à-dire vretu.
Tremper vient de temperare, l'r transposée pour faciliter la syncope. Les vieux romans parlent souvent de tremper une harpe, c'est l'accorder. On accorde encore les pianos par tempérament, c'est-à-dire en tempérant les quintes, parce qu'il est impossible de les accorder avec une justesse mathématique.
Aussi les malheureux scribes finissaient-ils par ne plus s'y reconnaître, confondant la forme parlée avec la forme écrite, figurant er où il fallait re selon l'étymologie, et vice versa:
Li quens Rolians Gualter de luing apelet9:
Pernez mil Francs de France nostre tere.
(Chanson de Roland, st. 63.)
[9] t euphonique, muet.
«Le comte Roland de loin appelle Gautier: Prenez mille Français, etc.»
Il fallait écrire prenez, puisque la racine est prendere.
Je terminerai ce chapitre sur les consonnes consécutives, par une observation qui doit fortifier ce que j'en ai dit. Je la tire d'un grammairien latin, Priscien, qui écrivait au commencement du IVe siècle. Il nous apprend que la plus dure des consonnes, l's, perdait souvent sa force, et que les plus anciens poëtes latins, et maxime vetustissimi, la faisaient disparaître en certaines rencontres. Et il cite de Virgile, ponite Spes sibi quisque suas, que l'on prononçait ponite 'pes; sans quoi l'e de ponite fût devenu long.
Il est assurément curieux de rencontrer l'usage si complétement d'accord avec la logique, et de voir un principe appliqué ainsi jusque dans ses dernières conséquences.
Mais voici qui recule encore beaucoup l'origine de cette loi: c'est qu'on la retrouve dans Homère. Homère fait brève la voyelle suivie de st, sk, évidemment en ne tenant pas compte de l's dans la prononciation:
ΠολυσταφυΛΟΝ Θ' ἹΣΤΙαιαν
(Iliad., II, v. 537.)
ΟΥΔΕ ΣΚΑμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος, ἀλλ' ἐτὶ μᾶλλον…
(Ibid., XXI, v. 305.)
ἈΛΛΑ ΣΚΑμανδρος
(Ibid., v. 124.)
Et dans l'Odyssée:
Πέλεκυν μέγαν, ἨΔΕ ΣΚΕπαρνον10.
[10] Voyez Priscien, dans Putsch, p. 557-564, et 1320.
Comme les vers ont toujours été calculés pour l'oreille et non pour l'œil, il est manifeste qu'on prononçait, en retranchant le sigma: Ἱτίαιαν,—ἀλλὰ Κάμανδρος—ἠδὲ κέπαρνον
Catulle a dit de même, Undă Scamandri. Si l'on doute que l'assertion de Priscien soit exacte, il suffit d'ouvrir tout ce qui nous reste d'anciens poëtes latins cités dans Nonius Marcellus: Ennius, Lucrèce, les fragments de Lucile, Plaute, ce fidèle témoin des habitudes du langage. De leur temps, l's suivie d'une autre consonne s'effaçait non-seulement de la prononciation, mais encore de l'écriture:
Volito vivu' per ora vivum.
(Ennius.)
Quam semper fuvit stolidum genus Aiacidarum!
Bellipotentei' sunt magi quam sapientipotenteis!
(Id., Ex Annal., VI.)
Tum mare velivolum florebat navibu' pandis.
(Lucrèce, V.)
Majorem interea capiunt dulcedini' fructum.
(Ibidem.)
Nec molles opu' sunt motus uxoribus hilum.
(Id., IV.)
Lucrèce se procure ainsi sans façon quantité de dactyles que ses successeurs n'osaient plus avoir; car, chez les Romains aussi, la langue écrite devint la langue littéraire, au préjudice de la langue parlée; et le témoignage des yeux prévalut sur celui de l'oreille. A peine dans Horace et dans Virgile retrouve-t-on quelque vestige de l'ancien usage général11. L'archaïsme, comme chez nous, y passe pour une faute ou pour une licence.
[11] Le sæpe stylum d'Horace devait se prononcer sæpe 'tylum, et ce vers de Virgile,
Inter se coiisse viros et decernere ferro.
(Æneid., XII, 709.)
serait mieux écrit:
Inter se coiisse viro' et decernere ferro.
Quelques commentateurs et éditeurs ont imaginé de substituer cernere à decernere; rien ne les y autorisait, que leur embarras de comprendre la mesure. Servius indique positivement l'élision de viros sur et.
La question du sigmatisme, tant controversée par les érudits, est au fond bien simple: les exemples qu'on allègue pour et contre ne sont qu'une affaire d'orthographe.
Au Xe siècle, Abbon, bénédictin de l'abbaye de Fleury, écrit à ses disciples anglais que dans Deus summus la première s disparaît, afin d'éviter le sifflement: «Inter duas etiam partes cum s præcedit, ut Deus summus, ne nimius sibilus fiat, prior s sonum perdit.»
(Quæst. grammat., ap. Maio, Bibl. Vaticana, t. V, p. 337.)
Les habitudes de langage du temps d'Ennius, de Pacuvius et de Plaute, puisqu'elles avaient sous Auguste cédé à des habitudes opposées, comment se retrouvent-elles à l'origine de notre langue, et si fortes qu'elles en deviennent un caractère essentiel? La réponse est facile: Le latin s'est transmis dans les Gaules par l'armée, par les soldats. Le peuple de Rome, comme celui de Paris, ignorait les vicissitudes du parler littéraire, et conservait intacte la tradition orale. Notre prononciation française nous vint des contemporains d'Ennius.
Voilà donc une loi d'euphonie transmise sans altération depuis Homère jusqu'aux trouvères de la langue d'oui, en traversant toute la poésie latine. On conviendra qu'il y a quelque dommage de l'avoir laissée périr après trois mille ans d'existence et de bons services. Nous avons fait triompher sur l'harmonie grecque la barbarie du Nord. Voltaire, en nous appelant Athéniens, nous faisait trop d'honneur.