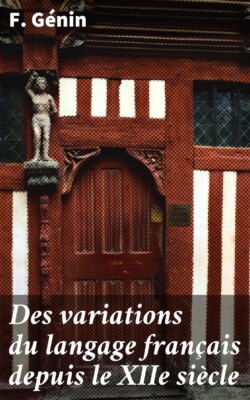Читать книгу Des variations du langage français depuis le XIIe siècle - F. Génin - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE PREMIER.
ОглавлениеTable des matières
De la prétendue barbarie de l'ancien langage français.—Opinion de Voltaire, accréditée par MM. Nodier et Rœderer.—Des consonnes consécutives.—INITIALES.—MÉDIANTES.—Que GN sonnait simplement N.—L, M et N redoublées.—Suppression de la liquide; grasseyement.—Liquide transformée ou transposée.—Conformité avec les Grecs et les Latins.
S'il est une opinion accréditée, c'est celle de la barbarie du vieux langage français; et, chose remarquable, cette opinion s'appuie surtout sur la multiplicité des consonnes dont se hérissait alors la prononciation. Écoutons Voltaire:
«C'est à force de politesse que notre langue est parvenue à faire disparaître les traces de son ancienne barbarie. Tout attesterait cette barbarie à qui voudrait y regarder de près. On verrait que le nombre vingt vient de viginti, et qu'on prononçait autrefois ce g et ce t avec une rudesse propre à toutes les nations septentrionales…
«De lupus on avait fait loup, et on prononçait le p avec une dureté insupportable. Toutes les lettres qu'on a retranchées depuis dans la prononciation, mais qu'on a conservées en écrivant, sont nos anciens habits de Sauvages.» (Dict. Phil., art. LANGUES.)
Il a répété ailleurs cette dernière phrase textuellement. Mais où Voltaire a-t-il pris qu'on prononçât ce p, ce g et ce t avec une dureté insupportable, ou d'une façon quelconque? Il l'a supposé, parce qu'il les a vus écrits. L'écriture est dans trop de cas un faux témoin; le même argument subsisterait contre la langue actuelle, car combien de consonnes écrivons-nous qui disparaissent dans la prononciation! Le nombre en était plus grand autrefois, voilà tout. Mais autrefois les consonnes faisaient partie essentielle d'un système complet, par où l'on suppléait à nos accents modernes. Celles qui sont demeurées ne servent à rien du tout: les unes étaient des conséquences, les autres sont des inconséquences.
M. Nodier est tombé dans la même erreur que Voltaire.
Je lis dans ses Éléments de Linguistique:
«Quand l'Académie française, peu éloignée encore de son origine, retrancha imprudemment des mots les lettres étymologiques qui ne se prononçaient plus, qu'aurait-elle répondu à l'homme qui lui eût parlé ainsi: Vous ne remarquez pas que ces caractères, devenus superflus dans la prononciation… etc.4»
[4] «Nodier, qui, dans tout ce qui tient à l'étude des langues, s'est fait remarquer par de bonnes intentions plutôt que par de bons ouvrages.» Revue de l'Instruction publique (du 4 octobre 1844).
Il y a deux erreurs dans ce peu de lignes: d'abord le retranchement des consonnes superflues ne s'est point fait par l'Académie, mais par l'hôtel de Rambouillet, par les précieuses; ensuite, je ne me lasserai pas de le répéter, ces consonnes, à aucune époque de la langue, n'avaient été prononcées. Leur rôle était de rappeler l'étymologie, et d'indiquer ou l'accent ou la quantité des voyelles. Elles ne sont devenues un embarras, une superfétation dans l'écriture, que lorsqu'on eut inventé de noter l'accent par un signe particulier, et qu'on perdit la clef de l'ancien mécanisme des lettres.
J'ajoute tout de suite que cette invention des accents n'est un perfectionnement qu'en apparence. Il limite à trois les nuances de l'accentuation, qui autrefois étaient bien plus nombreuses, ayant aussi pour se manifester une bien plus grande variété dans les formes de l'orthographe. Le système des accents est, dira-t-on, plus net et plus simple. Peut-être; mais, en tout cas, voyez ce que vous coûte cette netteté et cette simplicité: vous ne l'achetez qu'aux dépens de la délicatesse des inflexions et de la musique du langage. Il n'est pas malaisé de simplifier en supprimant.
Les précieuses, en retranchant les lettres muettes, ne se doutaient pas de ce qu'elles faisaient. Elles s'imaginaient aussi que ces consonnes ne se prononçaient plus, et par conséquent n'avaient plus de rôle dans les mots. On aurait bien surpris l'hôtel de Rambouillet, très-ignorant des origines de notre langue, si l'on était venu déclarer, en pleine chambre bleue, que ces lettres ne s'étaient prononcées dans aucun temps, non plus que dans le siècle d'Arténice. Les mères de ce concile grammatical n'avaient pour se guider dans la réforme de l'orthographe que cette fausse règle de l'écriture: elles travaillaient uniquement pour les yeux. Elles prenaient les mots les uns après les autres, les mettaient sur la sellette, et les renvoyaient estropiés dans la circulation. Elles défaisaient ainsi à coups d'épingle un système considérable, dont l'ensemble s'est toujours dérobé à leur vue; et c'est heureux, car elles en ont laissé échapper assez pour nous aider à le reconstruire, sinon intégralement, du moins en grande partie. La patience des observateurs, aidée par le temps, retrouvera ce qui manque aujourd'hui. Telle a été l'œuvre des précieuses sur le matériel des mots; si on l'examinait par rapport à la syntaxe, c'est encore bien pis! Et puis, que M. Rœderer et ses trop confiants imitateurs viennent encore nous vanter les services rendus à notre langue par la société polie!
Mon but et mon espoir dans ce travail, c'est de faire casser par l'opinion publique l'arrêt porté contre notre vieille langue par des juges mal instruits des faits de la cause. J'entreprends de faire voir que notre langue française a été constituée principalement sous l'influence de l'euphonie et d'une logique rigoureuse dans les procédés. Si je voulais soutenir à priori que ces deux qualités y étaient plus sensibles au XIIe siècle qu'aujourd'hui; qu'en empruntant aux habitudes des idiomes voisins, le Français a plus perdu que gagné, on ne manquerait pas de crier au paradoxe. Cette thèse choque l'opinion commune: nos pères étaient des barbares, des grossiers; l'oreille humaine s'est bien perfectionnée depuis le temps de saint Louis! Voilà ce qu'il faut dire pour être accueilli favorablement, et voir tout le monde se ranger d'avance à une proposition si flatteuse qu'elle en est évidente, et que, sur le simple énoncé, on vous quitte très-volontiers de la démonstration.
Ma conscience ne me permet pas de flatter à ce point la vanité des modernes. Toutefois, ce n'est pas une question de prééminence que je viens ici débattre: je ne veux faire que de l'histoire. Nos pères parlaient autrement que ne fait leur postérité; c'est un point accordé. Comment parlaient nos pères? C'est ce que je cherche. Quel langage est le meilleur, le leur ou le nôtre? C'est ce que je laisse à décider; je me contente de rassembler les observations qui pourront mettre sur la voie les curieux de philologie française.
RÈGLE.—Dans aucun cas l'on ne faisait sentir deux consonnes consécutives écrites, soit au commencement, soit au milieu, soit à la fin d'un mot; soit l'une à la fin d'un mot, et l'autre au commencement du mot suivant. Je regarde cette règle sans exception comme la clef de voûte de tout le système d'orthographe et de prononciation de nos ancêtres.
La consonne forte l'emportait sur la faible, et l'on pouvait ainsi sans inconvénient conserver les traces de l'étymologie des mots: en outre, la présence des consonnes notait l'inflexion des voyelles, et tenait lieu de notre système d'accents qui n'existait pas alors, et qui est bien moins sûr et moins exact. Un accent est sitôt mis ou effacé! Par les accents s'est modifiée la prononciation d'une foule de mots que l'orthographe étymologique aurait maintenus.