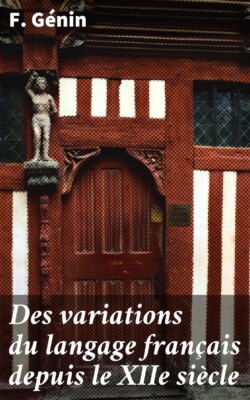Читать книгу Des variations du langage français depuis le XIIe siècle - F. Génin - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
H.
ОглавлениеL'h ne termine aucun mot dans notre langue; mais puisque l'occasion se présente d'en dire quelque chose, nous ne la laisserons pas échapper.
C'était, chez les Grecs, un signe d'aspiration; elle ne paraît pas avoir joué ce rôle chez les Latins, qui l'ont reproduite plutôt comme indication étymologique et par imitation. Les Italiens modernes, après l'avoir employée, l'ont bannie de leur langue.
L'emploi le plus clair de l'h dans notre vieille langue, c'est d'avoir marqué la diérèse. Elle servait à empêcher la fusion de deux voyelles en une diphtongue. Par exemple, Loherain; Loheraine.
Loherane ont et Ardane escillie.
(Ogier, v. 10784.)
Mes sires est li Loherains Garin.
(Garin, II, p. 270.)
Prononcez comme Laurain, comme dans Hohenlohe, l'au si long qu'il compte pour deux syllabes. C'est encore la prononciation actuelle en Lorraine.
Quant à l'h aspirée au commencement des mots, je crois qu'elle était inconnue, au moins pour les mots dérivés du latin. Aujourd'hui même, elle n'y tient qu'un emploi commémoratif: honnête, habile, homme, honneur, humble, habitude, héritier, etc., etc., se passeraient parfaitement de l'h initiale; la prononciation n'y perdrait rien. Elle a été transportée chez nous par imitation; et cette imitation aveugle l'a même attachée à des mots où elle est tout à fait intruse: huile, d'oleum;—hermite, d'eremita;—haut, de altus;—huit, d'octo, etc.
La valeur d'aspiration s'est aussi fixée au hasard. Pourquoi aspire-t-on l'h dans héros, et pas dans héroïque ni dans héroïne15? Pourquoi dans huit et pas dans dix-huit? Le Livre des Rois écrit partout uit, dise uit, comme nous prononçons encore aujourd'hui:
[15] Vaugelas donne pour motif le danger de confondre les héros avec les zéros et les hérauts d'armes. Ménage n'approuve que la moitié de cette excuse.
—«Uit ans out Josias quant il cumenchad a regner.» (Rois, IV, p. 422.)
—«Dise uit anz out Joachim quant il cumenchad a regner.» (P. 432.)
La chanson de Roland met oidme pour huitième. Benoît de Sainte-More, uitme:
En l'uitme, si cum nos lisum,
Le jor de s'expiation.
(Chron. des ducs de Normandie, v. 7022.)
«Dans le huitième jour, comme nous lisons.»
E si cum l'estoire remembre
Dreit à l'uitain jor de décembre.
(Ibid., v. 4281.)
Tant ont alé qu'a l'uitme nuit
Sont en Salence od grand deduit.
(Partonopeus, v. 6165.)
Et pres d'uit jor i sejournerent.
(Barbaz., I, p. 102.)
Nous disons le huit, le huitième; c'est du caprice, et ce caprice est encore bien plus frappant dans le mot onze, que nous aspirons, sans même qu'il y ait pour la vue le prétexte de l'h. Vers les onze heures, au onzième siècle, se prononcent comme s'il y avait les Honze heures, au Honzième siècle. Nos pères ne soupçonnaient pas ces étrangetés. Ils figuraient haut avec ou sans h; mais s'ils en écrivaient une, ils n'en tenaient pas compte dans le langage, comme le montre ce passage de Benoît de Sainte-More:
Dit li reis: Queu baronie,
Quel haute gent de Normandie.
(T. II, p. 143.)
Du temps de François Ier, on n'aspirait pas encore l'h de haut; notre prononciation paraît avoir été inconnue à la reine de Navarre:
Et qu'est cecy? Tout soudain en cette heure
Daigner tirer mon ame en telle haultesse,
Qu'elle se sent de mon corps la maistresse!
(Le Miroir de l'ame pecheresse, p. 22.)
Oyez qu'il dit: O invincible haultesse…
(Ibid., p. 68.)
O admirable hautesse,
Grace nous te rendons.
(La Nativité de J. C., p. 166.)
La reine de Navarre, qui s'exprimait ainsi, mourut en 1549. Trente-quatre ans après, c'était déjà une grosse faute de ne point aspirer l'h dans haut, hautesse. Théodore de Bèze, en 1583, signale «ce vice de prononciation, insupportable aux oreilles délicates (purgatis auribus). Cependant, ajoute-t-il, en Bourgogne, en Guyenne, à Bourges, dans le Lyonnais, tout le monde, à peu près, prononce en ault, l'autesse, l'aquenée, l'azard, les ouseaux.» (De Ling. fr. rect. pron., p. 25.) Et il fait suivre sa remarque d'une liste des mots où l'h est aspirée. Cela nous montre avec quelle rapidité les langues se modifient dans les sphères élevées.
Dans des mots d'origine autre que latine, peut-être y avait-il des raisons d'aspirer l'h; par exemple, dans haine16, honte, etc. Cependant on lit fréquemment, dans le Livre des Rois, jo l'haz,—je le hais.
[16] Ménage dérive haïr d'odire, «vieux mot inusité, pour lequel on a dit odisse.» (Observat., p. 185.) Cela paraît au moins douteux. L'Académie range haïr parmi les mots qui ne viennent pas du latin (voyez l'art. H); elle y joint hâbler, hasard, hâter, happer, etc., qui tous aspirent l'h et sont modernes.