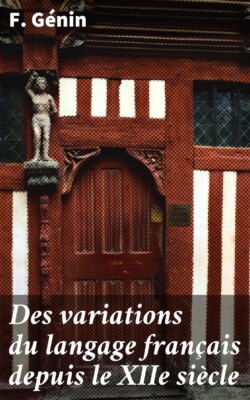Читать книгу Des variations du langage français depuis le XIIe siècle - F. Génin - Страница 19
G.
ОглавлениеOn le rencontre aux premières personnes de l'indicatif: Ving, tieng, etc.:
Contre-val rue de la Harpe
Ving en la rue S. Seuering.
(Guillot de Paris, le Dit des rues.)
Beau fils, ce tieng a grant savoir
Que faciez trestoz son vouloir.
(Partonopeus, v. 3913.)
G représente ici le pronom je: Vins-je? tiens-je?
Mais il est marqué souvent où il n'y a point d'élision, ni de pronom de la première personne: ainsi, à la fin de saint Sevring, et d'une foule d'autres mots, ung, loing, soing, besoing, tesmoing, etc., etc., où l'étymologie ne justifie pas sa présence. C'est un des nombreux abus d'un temps où il n'existait point de code pour la grammaire ni pour l'orthographe.
Il faut observer que le g final parasite ne se rencontre pas dans les manuscrits d'une très-haute antiquité. Il se montre au XIVe siècle, devient plus fréquent au XVe, et le XVIe l'a prodigué; car la pédanterie des consonnes inutiles a été le caractère de cette époque. On croyait, en surchargeant l'écriture, étaler une grande érudition d'étymologies.
Nos pères avaient grand soin d'appuyer fortement les terminaisons de leurs mots. Ils écrivaient sanc par un c, et nous disons encore du sanc humain, quoique nous écrivions sang avec un g, à cause de sanguis. Devant une liquide le g reparaissait: sanglant, sanglot.
Mais, suivi d'une consonne plus forte que lui, il la laisse prévaloir. Ainsi dans Magdelaine il s'efface devant le d.