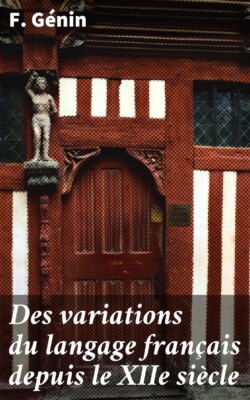Читать книгу Des variations du langage français depuis le XIIe siècle - F. Génin - Страница 16
C.
ОглавлениеBec. On ne disait pas le beque d'un oiseau, mais le bé; témoin le mot béjaune, si fréquent dans Molière, et que les anciennes éditions écrivent encore bec jaune. Laissez-moi lui montrer son béjaune, lui montrer qu'il est né d'hier, et manque de jugement et d'expérience autant que ces jeunes oiseaux qui ont encore le bec entouré de jaune.
Sec sonnait sé, aussi bien que sel, en sorte que siccus et salis se confondaient pour l'oreille. Aussi, dans le Dit des rues de Paris, la rue de l'Arbre-Sec est-elle inscrite rue de l'Arbre-Sel, absurdité qui s'explique tout de suite par la prononciation: c'était toujours la rue de l'Abre Sé. Le copiste, peu soucieux de l'étymologie, n'a vu qu'une chose, l'avantage de rimer plus richement à l'œil:
En la rue de l'Arbre-Sel,
Qui descent sur un beau ruissel.
Si l'abbé Lebœuf eût songé à la prononciation, il n'eût pas été forcé de recourir à cette conjecture, que l'Arbre-Sel était peut-être pour l'Arbrissel: rue de l'Arbrisseau.
On fait aujourd'hui sonner bien fort le c final de mameluc, comme s'il y avait Mameluque; cet abus date du XIXe siècle, car, du temps de Voltaire, on prononçait mamelus:
Contre les mamelus son courage l'appelle.
(Zaïre, III, sc. 1.)
Toutes les éditions imprimées du vivant de Voltaire, et l'édition de Kehl, portent mamelus; et la tradition de cette prononciation s'était conservée au Théâtre-Français, que la barbarie à la mode envahit déplorablement chaque jour.
Nous prononçons encore estomac sans faire sonner le c, non plus que dans porc, ni dans porc-épic. Porc-épique, comme quelques-uns affectent de dire, s'entendrait tout au plus du sanglier d'Érymanthe, ou du cochon rôti dont Ulysse fut régalé chez Eumée.
C au milieu d'un mot, devant une voyelle, s'adoucissait en g par la prononciation: segond, de secundus. Les Latins disaient de même quingenti pour quincenti. Au contraire, ago faisait actus, et non agtus, la dureté du t ne pouvant s'allier à la mollesse du g.
C se rencontrant dans un mot suivi d'un t, laisse dominer le t, ou plutôt se transforme pour renforcer ce t:
Belle dottrine met en lui
Qui se chastie par autrui13.
(L'Hostel de Cluny, p. 128.)
[13] S'instruit par l'exemple d'autrui.
On écrivait pacte, et l'on prononçait patte. Apactir (sens analogue à affermer), apatir, tenir en apatis:—«Laquelle cité un pauvre soudoyer Bourgognon, nommé Pernet Braset, tenoit en apatis, le roi estant dedans.»
(Olivier de la Marche, liv. I, ch. 3, p. 124, édit. de 1567; Gand.)
C'est pourquoi quelques scribes mettaient ct où l'étymologie demandait deux tt. Par exemple, dans les Mémoires de Jacques du Clercq, mettre, remettre, promettre, sont toujours écrits mectre, remectre, promectre. (Édit. Buchon). La différence n'existe que pour l'œil.