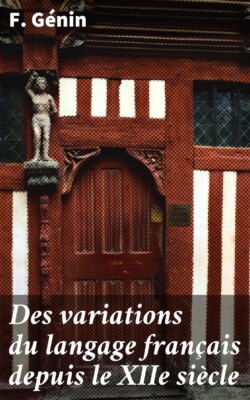Читать книгу Des variations du langage français depuis le XIIe siècle - F. Génin - Страница 8
SECTION II.
MÉDIANTES.
ОглавлениеThéodore de Bèze a publié, en 1584, un petit Traité latin de la bonne prononciation du français, qui, s'il fût venu plus tôt à ma connaissance, m'eût épargné du temps et de la peine; car une règle importante que j'ai tirée d'une longue étude et de la comparaison assidue des textes, je l'eusse trouvée là toute formulée. Peut-être aussi j'y aurais fait moins d'attention. Il en est des idées comme des plantes: celles que personne n'a semées, et qui viennent d'elles-mêmes, poussent et se développent bien plus vigoureusement que les plantes repiquées toutes grandes de la main du jardinier. Dans l'esprit comme dans le jardin, ce qui est adoptif n'égale jamais l'énergie de ce qui est natif.
Voici le passage où Théodore de Bèze pose en principe qu'on ne doit jamais faire sonner deux consonnes consécutives. J'aurai du moins l'avantage d'appuyer de son autorité le résultat de mes recherches.
«Les Français émettent toutes les lettres avec une sorte de mollesse et de négligence. Leur langue est si antipathique à toute rudesse de prononciation, que sauf le c, l'm, l'n et l'r redoublées, comme dans accès, somme, année, terre, ils ne font jamais sentir deux consonnes de suite…
«Leur prononciation, mobile et rapide comme leur génie, ne se heurte jamais au concours des consonnes, ni ne s'attarde guère sur des syllabes longues. Une consonne finit-elle un mot? elle se lie à la voyelle initiale du mot suivant; si bien qu'une phrase entière glisse comme un seul et unique mot.» (De Francicæ linguæ recta pron., p. 9 et 10.)
Voilà le caractère essentiel de notre langue; et lorsqu'il tend de jour en jour davantage à s'effacer et à disparaître dans l'oubli, il est heureux qu'un témoignage daté du XVIe siècle prévienne la perte complète de la tradition. Si, malgré ce témoignage, on ne veut ni revenir sur les abus accomplis, ni enrayer sur la pente qui nous mène dans le précipice, nous aurons du moins la satisfaction de perdre notre langue à plaisir et en pleine connaissance de cause.
On rit des gens du peuple qui prononcent il m'ostine; c'est un enfant ostiné; ne m'ostinez pas. Ils parlent comme on parlait à la cour de Henri III, et pourraient couvrir de confusion les pédants, en leur citant la règle tracée en latin par Théodore de Bèze. Après avoir prescrit de prononcer oscur, cet illustre savant ajoute: «B disparaît absolument devant st, comme dans ces mots obstiné, obstination, qu'on prononce ostiné, ostination (p. 64).» Il semble que le peuple des rues de Paris ait lu Théodore de Bèze, ou fréquenté le Louvre d'Henri III. Bèze recommande aussi de dire ovier, et non obvier; et il cite à ce propos un quolibet qui avait cours de son temps; c'est un hémistiche qui est tout à la fois latin et français:
Omnia malo viæ.
On y a mal obvié.
Debte, debteur, ont toujours été prononcé dette, detteur. Le XVIe siècle, très-pédant, avait rétabli le b sur le papier, pour rappeler l'étymologie debitum, debitor; mais souvent on l'oubliait, et dans Marot comme dans ses prédécesseurs du XVe siècle et dans ses successeurs du XVIIe. La Fontaine, par exemple, écrit detteur.
Dans les mots où il double une autre consonne, le b ne sonnait pas plus que ne fait sa dure, le p, dans temps et dans baptiste.
Dans sceptre, on éteignait le p et l'on prononçait scêtre long, comme ancêtre:
Loys aussi, son beau-pere et ancestre,
Qui prospera en couronne et en sceptre.
(Jean Bouchet, 38e épître familière.)
Écoutez Louis Maigret, un des premiers qui se soient avisés d'analyser le langage, et qui fut en cette matière l'oracle de son temps:
«Tenez pour règle générale que b et f ne se rencontrent jamés en la prononciation françoise avant v consonnante.» (L'Escriture françoise.)
Maigret, à l'appui de cette règle, allègue aussi le mot obvier. Les deux grammairiens n'ont d'autre tort que de restreindre le précepte à certains cas spéciaux; ils devaient dire que jamais deux consonnes de suite ne se font entendre; et la raison en est simple: c'est qu'on ne peut les articuler sans glisser entre deux un e muet, qui allonge le mot d'une syllabe.