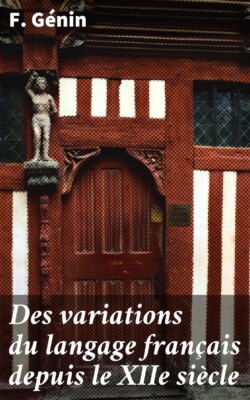Читать книгу Des variations du langage français depuis le XIIe siècle - F. Génin - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ II.
OBSERVATION SUR LA FINALE DES PLURIELS.
ОглавлениеIl est essentiel de noter ici comment on écrivait au pluriel les mots terminés au singulier par d ou t. Nos grammaires modernes prescrivent d'ajouter une s tout simplement: grand, grands; enfant, enfants; moment, moments.
Nos pères n'en usaient pas ainsi. Le t était la finale euphonique caractérisant le singulier; l's était celle du pluriel. On substituait l'une à l'autre, on ne les accumulait pas.
—«Amasa partid de curt pur faire le cumandemenT le rei.»
(Rois, II, p. 197.)
—«E ço fud encuntre li lei Deu e sun cumandemenT.»
(P. 285.)
—«E n'ad pas tenu mes veies e mes cumandemenZ.»
(P. 280.)
—«E si tu oz de quer mes cumandemenZ.»
(Ibid.)
—«Tantost cume li reis out oïd les dures paroles ki furent en cel livre de la lei, ses guarnemenZ de dol et de marremenT dessirad.»
(Rois, p. 424.)
«Il déchira ses habits, de deuil et de chagrin.»
La gent, et les vaillantes genz;—un tréud (tribut), les tréuz;—grant, granz;—païsant, païsanz, etc.—«Tuit li granz e li petiz…»
(Rois, passim.)
De même pour les substantifs en é et les participes passés passifs, qui alors prenaient le d final euphonique, ou le t.
—«… E humilieD te as devant lui, e tes riches guarnemenz as desrameZ, e devant lui as plureD…»
(Rois, p. 425.)
«Et tu t'es humilié… et tes habits as déchirés, et tu as pleuré…»
—«Mais ki est cil ke il ad ramposneD, e vers ki il ad mal parleD? E ki est cil vers ki il ad crieD, e les oils par orguil leveZ?»
(Rois, p. 414.)
—«E asist (brûla) la citeD de Jerusalem, e li reis Joachim eissid de la citeD.»
(Rois, p. 433.)
—«E fist assembler tuz les pruveires des citeZ de Juda.»
(P. 427.)
—«Tuz les temples ki esteint es citeZ de Samarie.»
(P. 429.)
—«E li reis meismes estud sur un degreD.»
(P. 426.)
—«E l'um muntad del un en l'autre tut par degreZ.»
(P. 251.)
PechieT, pechieZ;—aturneD, aturneZ;—costeD, costeZ;—etc., etc. (passim).
La même règle est observée partout. Je me bornerai à citer la chanson de Roland.
La bataille est e mervillose e granT…
La veissiez si grant dulor de genT…
(St. 123.)
Par tel paroles vus ressemblez enfanT…
(St. 132.)
Les oz sunt beles e les cumpaignes granZ.
(St. 242.)
De cels de France XX mille cumbatanZ…
(St. 230.)
Ensemble od els XV milie de Francs
De bachelers que Carles cleimet enfanS.
(Ibid.)
Allemant, Normant, font au pluriel Allemans, Normans.
Pour les mots terminés par é fermé, soit participes, adjectifs ou substantifs:
Dist Baligant: Que avez vos trovet?
U est Marsilie que jo aveie mandet?
Dist Clarien: Il est a mort naffret.
(St. 195.)
Trouvé; mandé; navré.
De cels de France XX milie adubez.
(St. 195.)
Asez i ad evesques et abez,
Moines, canoines, provoires coronez…
Gaillardement tuz les unt encensez
A grant honor, poi les unt enterrez.
(St. 209.)
Même règle pour les mots en i ou en u: faillit, failliz;—petit, petiz;—hait, haiz;—Arabit, Arabiz.
Thierry blessé par Pinabel lui fend la tête jusqu'au nez:
Jusqu'al nasel li a frait e fendut;
Del chef li a le cervel repandut;
Brandit son colp, si l'a mort abatut.
A icest cop est li esturs vencut.
Escrient Franc: Deus i a fait vertut!
Asez est dreit que Guenes soit pandut.
(Roland, st. 288.)
«A ce coup le combat est gagné. Les Français s'écrient: Dieu y a fait vertu! il est juste que Ganelon soit pendu.»
Pur Karlemagne fist Deus vertuZ mult granz.
(St. 176.)
Roland se sent frappé à mort:
Ço sent Rollans, de sun tens n'i ad plus.
Devers Espaigne est en un pui aguT;
A l'une main si ad sun pis batuD:
Deus! meie culpe vers les tues vertuZ
De mes pechez, des granz e des menuZ.
(St. 172.)
«Roland sent que son temps est fini, il est tourné vers l'Espagne sur un sommet aigu. D'une main il se frappe la poitrine: Mon Dieu, je m'accuse à tes vertus de tous mes péchés, grands et petits.»
Charlemagne demande conseil à ses preux sur ce qu'il fera des parents de Ganelon, livrés en otage:
Carles apelet ses cuntes e ses dux:
Que me loez de cels qu'ai retenuz?
Pur Ganelun erent a plait venuz,
Pur Pinabel en ostage renduz.
(St. 290.)
«Que me conseillez-vous de ceux que j'ai retenus qui sont venus plaider pour Ganelon, et se sont rendus otages pour Pinabel?»
Ces passages rapprochés démontrent clairement l'intention de la règle. A quoi est destinée la consonne finale? A pratiquer la liaison sur le mot suivant. Une seule y suffit. Le singulier se lie par le t, le pluriel par l's; ts forme un double emploi, et prouve l'ignorance complète des principes. Je demande que, dans tout ce qu'il existe de manuscrits du moyen âge, on me fasse voir un exemple, un seul, d'enfants écrit par ts, du mot corps ou du mot temps écrit avec un p. Au moyen de cette dernière orthographe, on peut aujourd'hui se procurer le spectacle de quatre consonnes consécutives:—temps couvert, et même de cinq:—temps pluvieux. Il faut laisser aux Allemands le plaisir de contempler sept consonnes de suite dans un de leurs mots les plus usuels, Geschichtschreiber (historien).
Quand Voltaire proposait de supprimer au pluriel le p et le t, d'écrire: enfans, mouvemens, il était remis dans le bon chemin par son instinct admirable de la langue française; il suivait l'inspiration secrète de ce génie dont furent animés à un si haut degré la Fontaine et Molière. Si Voltaire eût connu les monuments littéraires du XIIe siècle, il eût appuyé sa réforme sur des arguments victorieux.
L's caractéristique du pluriel souffre volontiers devant soi les liquides m, n, l, r: autels, bacheliers; et d'autres consonnes, c, f, qui ne sont pas dures comme le t, et n'ont pas comme lui le privilége spécial de marquer le singulier; en sorte qu'il n'y a pas antipathie. On a toujours écrit: les Francs,—les chefs; les caitifs,—tens, encens, etc.