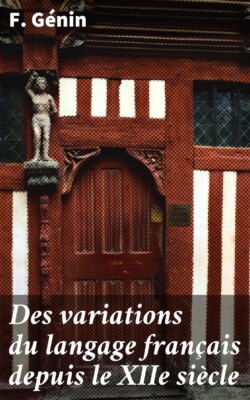Читать книгу Des variations du langage français depuis le XIIe siècle - F. Génin - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V.
ОглавлениеJusqu'au milieu du XVIe siècle, l'u consonne, que nous appelons v, n'eut pas de figure distincte de celle de l'u voyelle. Ce fut Ramus qui s'avisa de lui attribuer un signe particulier. Avant Ramus, l'usage de la prononciation apprenait seul à en faire la différence.
Le v ne termine aucun mot; il n'a pas assez de résistance. Quand l'étymologie en fournissait un, l'on y substituait sa forte f.
L'u final était, selon l'occurrence du mot suivant, ou voyelle ou consonne.
De Deus on fit deu, au féminin deuesse, c'est-à-dire devesse, et non déesse:
—«E ço li frai par ço que guerpid me as, e as aured Astarten, deuesse de Sydonie.» (Rois, III, p. 279.)
«Et ce lui ferai-je parce que tu m'as abandonné, et as adoré Astarté, déesse de Sidon.»
Tous les éditeurs de textes anciens ont pris sur eux de distinguer dans l'impression l'u voyelle et l'u consonne, qui sont confondus dans les manuscrits, et qui se substituaient parfois l'un à l'autre dans le langage. Ainsi j'auerai devait se lire, selon ce que voulait la mesure, tantôt j'averai en trois syllabes, tantôt j'aurai en deux. L'éditeur de la chanson de Roland imprimant toujours j'averai, estropie quelquefois le vers par cette orthographe. Cette distinction est, à la rigueur, une infidélité, comme l'introduction des accents. Reproduire les manuscrits, c'est à quoi l'on doit s'attacher.