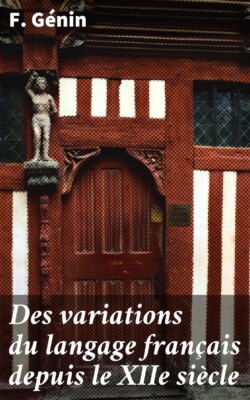Читать книгу Des variations du langage français depuis le XIIe siècle - F. Génin - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
S.
ОглавлениеJe n'ai pas besoin de faire voir que l's finale était effacée de la prononciation de nos aïeux, puisque nous-mêmes ne la faisons pas sentir; des verses, des mœurses, pour des vers, des mœurs, sont une tradition particulière à la Comédie française, et tout à fait mauvaise: heureusement elle commence à se perdre.
Quant à la manière affectée dont on fait aujourd'hui siffler l's finale sur la voyelle qui commence le mot suivant, il en sera traité au chapitre des consonnes articulées à la moderne.
Je rappelle ici pour mémoire que l's suivie d'une autre consonne dans le courant d'un mot, disparaît pour laisser prévaloir la seconde: esprit, estomach, et quelques autres, sont des vices consacrés, mais dans le fond aussi choquants que le seraient esse-pée, esse-tonner.
Dans ce passage de la Fontaine:
Ces deux veuves, en badinant,
En riant, en lui faisant fête,
L'alloient quelquefois testonnant,
C'est-à-dire ajustant sa tête.
(L'Homme entre ses deux âges.)
On ne manque pas de faire prononcer aux enfants tesse-tonant, comme aussi dans l'occasion fesse-toyer. Prononcez donc aussi esse-trange, tesse-te et fesse-te.
Les poëtes latins ne se faisaient aucun scrupule d'abattre l's et de maintenir la voyelle brève devant ces formes st, sp, sc, autorisés en cela de l'exemple des Grecs. Voyez plus haut (p. 38 et 39) la preuve de ce fait.