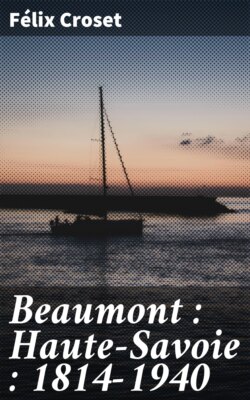Читать книгу Beaumont : Haute-Savoie : 1814-1940 - Félix Croset - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La fanfare
ОглавлениеTable des matières
Au cours de l’hiver 1883-1884, un groupe de jeunes gens du Châble, animés du désir de pratiquer la musique, étudient la possibilité de fonder une fanfare. L’idée fait son chemin. Le 25 mars 1884, vingt-cinq jeunes sont réunis et décident ce qui suit:
Art. 1 – Il est formé entre les sus-nommés et ceux qui adhèrent aux présents statuts par la souscription des sommes à verser qui seront fixées par le règlement à intervenir, une société qui a pour but de créer une fanfare.
Art. 2 – La société prendra le nom de «Fanfare des Enfants du Châble» (Suivent d’autres articles).
Le 3 octobre de la même année, le règlement est établi:
Art. 1 – La société de la fanfare dite “des Enfants du Châble” a pour but unique d’étudier la musique et d’en propager le goût par tous les moyens en son pouvoir. Comme son nom l’indique, elle a été créée par les jeunes gens du Châble eux-mêmes, sans aucun secours de la commune.
Art. 4 – Le président et le vice-président, élus pour une année, sont rééligibles. Ils ont pour mission de défendre, et de sauvegarder les intérêts de la société...
Art. 5 – Le directeur est chargé de l’exécution musicale... Il doit donner tous ses soins pour faire progresser la société. (...)
Art. 8 – Lorsque le directeur manquera une répétition, il sera passible d’une amende de cinq francs, sauf justification. Il sera également passible d’une même amende dans le cas où il se trouverait tout à fait incapable de donner sa leçon par état d’ivresse ou autre.
Art. 9 et 12 – Le conseil d’administration est composé de 7 membres pris parmi les exécutants... Il est chargé de l’organisation des concerts, bals, concours, etc.
Art. 9 – Les membres actifs constituent la force vive de la Société. Le but unique qu’ils doivent poursuivre est de se perfectionner dans l’art musical.
Ce règlement sera approuvé par les vingt-cinq premiers sociétaires, qui prennent le nom de “membres fondateurs”. Il est intéressant de noter leur profession: 1 clerc de notaire, 2 commerçants, 2 meuniers, 1 géomètre, 1 garde, 2 employés, 9 cultivateurs, 1 facteur rural, 1 tailleur d’habits, 5 jeunes de moins de 20 ans. Le premier président sera François Miguet.
M. Rouge, instituteur de la commune voisine de Saint-Blaise, féru de musique et compositeur à ses heures, accepte la direction.
Le 25 avril 1885, la société est officialisée par arrêté préfectoral. En cette même année, notre jeune société a déployé une grande activité. En raison de la compétence du directeur et de l’enthousiasme manifesté par les sociétaires, de rapides progrès permettent d’affronter le jury du concours musical de Thonon.
Le 27 avril, un concert (soirée littéraire et musicale) a obtenu un succès considérable, grâce au sérieux apporté aux répétitions par les actrices et acteurs . Au cours de la fête, une magnifique bannière offerte par les dames et demoiselles du Châble lui sera remise (ci-contre), à l’initiative de Mlle Andrina Mégevand.
Le 14 juillet sera la première fête nationale organisée et animée par la fanfare . La fête, dont nous donnons le programme ci-après, fut en tout point réussie, à la satisfaction générale.
Programme
Samedi soir et dimanche matin: Salves d’artillerie .
Le 2 août a lieu le concours musical de Thonon, où la société se rend par le train. Le parcours Le Châble-gare de Saint-Julien s’effectue en chars à bancs. Le député Folliet accueille la fanfare sur le quai de la gare chablaisienne. C’est après le déjeuner, dans un restaurant de la ville, qu’a lieu le concours. Notre jeune fanfare accroche une médaille d’argent à sa bannière. Le retour se fait dans la joie d’une journée agréablement remplie .
Le 21 novembre 1886 et pour la première fois, on fête la patronne des musiciens, sainte Cécile. Une retraite aux flambeaux parcourt le village. Originalité très remarquée: les musiciens sont coiffés de bonnets de coton blanc. Nombre d’habitants des communes voisines se sont déplacés pour assister et applaudir ce spectacle.
Quand la décision est prise de créer une vogue au Châble, la fanfare l’organise.
Et puis, tout comme pour la Société de Tir, une certaine lassitude saisit les membres; de plus, le directeur s’en va... La société ne compte plus que dix membres en 1894, puis se met en sommeil.
Mais, le 23 octobre 1897, à l’initiative d’Antoine Mégevand, quelques anciens se réunissent au café Pillet-Miguet, bien décidés à redonner vie à la fanfare. Un appel à la jeunesse sera fait par voie d’affiches. Le 30 du même mois, l’appel ayant été entendu, vingt personnes se réunissent au même lieu, bien déterminées à ne pas laisser sombrer la fanfare et donnent leur adhésion. Le 25 novembre, la société reprend vie.
En 1898, M. Guévin, nouvel instituteur, veut bien en assumer la direction. La vie de la fanfare reprend avec ses concerts, bals, etc. En 1903, elle se rend au concours de Turin, d’où elle reviendra avec une quatrième médaille. La fanfare aura l’honneur d’exécuter l’hymne national devant le Président de la République, en visite dans la région en 1910.
La présence de la fanfare du Châble était appréciée dans les fêtes des communes voisines, tout comme celle de la chorale de Beaumont.
La promenade annuelle était un moment particulièrement apprécié des sociétaires: elle les conduisit notamment à Marseille et à la Grande Chartreuse.
Voici un commentaire sur la vogue du Châble du 2 août 1908, paru dans le Cultivateur Savoyard du 13 août:
Une bonne petite vogue, bien ensoleillée, nullement apprêtée et vous souhaitant d’elle-même la bienvenue; pas de revue de pompiers, mieux encore: pas de harangues officielles! En revanche, un essaim de coquettes toilettes et de jolis sourires (sourires féminins s’entend), beaucoup de bambins mêlant leurs cris et leurs gambades aux flonflons des cuivres de l’orgue des chevaux de bois, un peu de poussière, négligée d’ailleurs à dessein par l’arroseur municipal. Ajoutez à cela les distractions du tir et du jeu marin, petits et modestes profits de notre fanfare. Les deux bals étaient si animés que les couples, s’égarant par hasard dans l’ombre, n’y faisaient point de vides, étant aussitôt remplacés par d’autres. Vous aurez, ou du moins nous espérons vous avoir donné, une idée de ce que fut la vogue du Châble en l’an de grâce 1908.
Notre profond dédain du compte-rendu protocolaire ne doit cependant pas nous faire omettre d’adresser nos vifs remerciements à la Chorale de Beaumont et à la Fanfare de Viry, venues, comme promis, nous apporter leur cordial concours. Merci aussi à nos gracieuses visiteuses, que nous espérons retrouver plus nombreuses encore l’année prochaine.
Voici la liste des prix du jeu marin et du tir.
Jeu marin: 1er prix, Décart Alphonse; 2e, Lacroix Eugène; 3e, Curval Louis; 4e, Pillet André ; 5e, Degournay; 6e, Excoffier François; 7e, Borgel André ; 8e, Pécoud Joseph; 9e, Dalbertot; 10e Mégevand André ; 11e, Taponier Louis; 12e, Mégevand Louis; 13e, Tapponnier Eugène; 14e, Héritier Paul; 15e, Evreux.
Tir: 1er prix, Décart Alphonse; 2e, Lachenal Jean; 3e, Pillet Léon; 4e, Mabut Joseph; 5e, Borsier; 6e, Mégevand André ; 7e, Balleydier Marc; 8e, Pillet Auguste; 9e, Curval; 10e, Taponier Louis; 11e, Bocquet André ; 12e, Larue Etienne; 13e, Monachon; 14e, Mégevand Antoine; 15e, Croset; 16e, Lachenal John; 17e, Mabut Henri.
Le journal Le Cultivateur Savoyard du 23 juillet 1914 publie le programme de la vogue:
Le Châble-Beaumont-Grande Vogue les dimanche 2 et lundi 3 août 1914, organisée par la Fanfare du Châble, avec le concours de l’Union Chorale de Beaumont. En voici le programme:
Dimanche 2 août.
La distribution des prix se fera le dimanche 9 août, à 9 heures du soir.
Le Comité.
Le Châble-Beaumont. Vélo-club du Salève.
A l’occasion de la vogue, la Société organise une course vélocipédique avec le parcours: Le Châble, Saint-Julien, Pont-de-Combes, La Forge, Le Châble. Le départ aura lieu à 14 heures.
Les concurrents sont priés de s’inscrire au Café de la Poste, au Châble, moyennant une taxe de 2 francs.
De nombreux prix sont affectés à cette course.
Le Comité.
Malgré les bruits alarmants qui se propagent, la fête se prépare, les forains installent leurs jeux. Le samedi, coup de tonnerre, des affiches sont placardées:
ARMÉE DE TERRE ET ARMÉE DE MER ORDRE DE MOBILISATION GÉNÉRALE
Par décret du Président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées.
Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914.
Les conscrits de la classe 1919.
Le lendemain, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Les forains démontent leurs installations. Le propriétaire du jeu de massacre loge son matériel dans le grenier de la forge à Colney . La majorité des membres de la fanfare étant mobilisée , toute activité cessera durant les hostilités.
Fin décembre 1919, décision est prise de reconstituer la société. Après l’invitation adressée aux jeunes gens de rejoindre les anciens, la fanfare compte vingt-quatre membres dont dix anciens. Antoine Mégevand reprend la présidence, Louis Curval la direction.
Comme auparavant, la fanfare sera présente ou organisera les fêtes du 14 juillet, la vogue, la fête de sainte Cécile, auxquelles s’ajoutera la célébration de l’anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Les soirées littéraires et musicales (concerts), très attendues par la population, connaîtront toujours un vif succès.
Entre 1921 et 1923, elle prêtera son concours à l’inauguration de monuments aux Morts dans les communes voisines.
La fanfare en 1922.
De nombreuses promenades seront organisées, notamment celle au col des Aravis en 1923, qui fut mémorable, les participants étant juchés sur les camions de la fromagerie Corajoud du Châble. La fanfare se rendra à Pontarlier en 1925, à Saint-Claude en 1928, en Alsace en 1930, à Paris, à l’occasion de l’Exposition internationale de 1937.
Le 9 septembre 1934, Le Châble est en fête, le village est abondamment pavoisé, des arcs de triomphe sont édifiés: la fanfare fête son cinquantenaire. Tous les membres se sont dépensés, sans compter, pendant plusieurs semaines pour en assurer la réussite. De nombreux mâts peints en tricolore sont fabriqués, ainsi que des drapeaux et des oriflammes aux couleurs nationales et savoyardes, ainsi que des écussons porte-drapeaux. Outre la partie musicale, avec les fanfares invitées de Saint-Julien, Cruseilles, Loisin et la chorale de Beaumont, un grand banquet de plus de cent couverts est préparé, servi par M. Durand de l’hôtel de l’Abbaye de Pomier et présidé par le docteur Henri Bouchet de Cruseilles. Une nouvelle bannière de couleur verte est offerte à la fanfare. La journée se termine par un grand bal.
En 1938 la fanfare participe à la grande fête champêtre de Cruseilles et joue des airs sur lesquels on se laissait entraîner au rythme des danses savoyardes et du quadrille.
La même année, la fanfare adhère à la fédération des Musiques du Faucigny. Le premier festival où la fanfare est présente se déroule à La Roche-sur-Foron.
3 septembre 1939: de nouveau la guerre; de nouveau, de nombreux sociétaires rejoignent les armées. Six membres de la fanfare connurent une longue captivité, hormis Edouard Mugnier qui s’évada en 1941. Au cours de l’hiver 1940-1941, la société reprit une activité restreinte, mais lors de leur service militaire, nombre de membres de la société firent partie de musiques ou fanfares.
Le local de la fanfare. La fanfare eut quelques difficultés pour rentrer dans ses meubles, surtout à ses débuts. Lors de sa fondation, elle utilisa un réduit au-dessus de la remise de la pompe à incendie. Rapidement il s’avéra trop exigu. On se transporta dans une salle aménagée dans les combles de la nouvelle école. Le bruit causé par les répétitions gêne l’instituteur. Ce dernier, en 1888, se plaint au maire, et demande que la fanfare regagne son premier local. Ses dirigeants font la sourde oreille!
Plus sérieux sera le conflit qui surgira pendant la période d’inactivité de la fanfare, alors que la compagnie des pompiers se réorganisait, en 1896. Chacun leur tour, l’instituteur, l’inspecteur primaire, le président de la fanfare, le sous-préfet, le maire, le conseil municipal, le sénateur A. Folliet et le député C. Duval entrèrent en lice!
En juillet 1896, dans une très longue lettre, l’instituteur, s’adressant à l’inspecteur primaire de Saint-Julien, se plaint que «de nouveaux maîtres plus exigeants» se sont installés dans cette salle, en l’occurrence les pompiers, dont le capitaine exige que la porte d’entrée de l’école soit constamment ouverte, ce que l’instituteur conteste . Ce dernier, sur un ton conciliant, demande «que l’on ne puisse entrer librement à n’importe quelle heure dans l’école, et que l’on soit tenu, lorsqu’on désire se rendre dans cette salle, de prévenir l’instituteur qui permettra d’entrer toutes les fois que cela ne dérangera pas les classes, et que ce ne sera pas à des heures indues».
En prévision de la reconstitution de la fanfare, en 1897, le maire n’est pas d’avis de laisser cette association occuper de nouveau la salle de l’école. M. Duval, député, intervient auprès du préfet par lettre en date du 30 avril et dit notamment: «Musiciens et pompiers font, non seulement gratuitement, mais en s’imposant des sacrifices personnels, un service dans l’intérêt public, il semble que le devoir de l’administration est de les encourager et leur venir en aide».
Le 17 mai, l’inspecteur d’académie fait part de son avis défavorable et le transmet au préfet. Puis c’est au tour du sénateur A. Folliet, qui, après avoir examiné les documents relatifs au local de la fanfare et des pompiers du Châble communiqués par le sous-préfet, répond à ce dernier par lettre datée du 19 juin. Le sénateur fait état d’assemblées pas tristes du tout! Qu’on en juge:
Lorsque la fanfare eut cessé d’avoir une existence comme corps de musique, la clé de la salle resta dans les mains de ceux des membres de la Société qui ne pouvaient plus se réunir utilement, tous les bons instrumentistes étant absents. Alors la salle servit surtout à de petites réunions nocturnes où l’on mangeait la saucisse en buvant du vin blanc; la petite fête se terminait vers 3 heures du matin, par des danses en sabots à réveiller des sourds. Il n’y a pas de locataires au monde qui soient tenus à subir de tels vacarmes. J’ajoute que détourner un local de sa destination, sans contrôle ni surveillance, est une source d’abus...
Si donc la nouvelle fanfare réussit à se réorganiser, ce que je souhaite vivement, je suis d’avis que le local soit remis à la disposition de la Société, mais sous les conditions suivantes qui me paraissent indispensables: 1. la clé de la salle sera remise à l’instituteur, seul gardien de l’immeuble... 2. la clé sera mise à la disposition du président de la fanfare les jours et heures qu’il indiquera pour les répétitions...
M. Folliet continue en exposant le cas des pompiers:
En ce qui concerne les pompiers, la situation est bien différente. La fanfare n’est point municipale; si elle n’avait pas la salle du Châble, elle serait obligée de louer une salle, ce qui est au-dessus de ses ressources. On l’aide à vivre en lui offrant cet abri; il n’y a qu’à en réglementer l’usage...
Mais la compagnie des sapeurs-pompiers est une institution municipale; M. le maire a offert la mairie, pourquoi le capitaine ne l’a-t-il pas acceptée? Parce qu’il voulait être maître chez lui. Chez lui, c’était encore cette malheureuse salle.
La compagnie des pompiers a été créée au commencement de 1896, sur l’initiative de son capitaine actuel qui, malgré cet élément de popularité, ne put parvenir à être élu conseiller municipal en mai 96... Son premier soin fut de refuser le local de la mairie et de s’emparer en conquérant de la salle du Châble où il prétendait être maître à toute heure. Des scènes fâcheuses eurent lieu. Le préfet, saisi de l’affaire par l’Inspection académique, interdit aux pompiers l’usage du local...
J’estime donc que la compagnie de sapeurs-pompiers du Châble-Beaumont doit être invitée à s’adresser à la municipalité pour être munie d’un local affecté à ses réunions...
Le 1er septembre, le maire, dans une lettre adressée au sous-préfet, dit qu’il a convoqué le conseil municipal pour discuter de ce problème d’affectation des locaux communaux. Seuls deux conseillers se sont déplacés. Il convoquera à nouveau le conseil le 5 septembre et ajoute:
«cette salle n’a pas été ni commandée, ni payée. (...) Les plans font foi, il n’y a pas les doubles fenêtres» .
Au cours de sa séance du 5 septembre, le conseil municipal, dans sa délibération, dit notamment: «Que cette salle a été créée sans son avis, qu’il ne l’a jamais reconnue expressément, ni payée, et qu’il se refuse absolument à en prendre possession et ne s’en reconnaît point propriétaire, ne se reconnaît pas le droit d’émettre un avis sur cette demande et laisse à l’administration compétente le soin de statuer à ce sujet». Le maire s’en lave les mains... Pourtant, la commune, propriétaire de l’école a bien un droit de regard sur cette salle! De plus, différents travaux y furent entrepris et, dans les devis, il est dit que ce local «est destiné aux besoins de la localité ».
Dans une longue lettre non datée adressée au sous-préfet par le maire, ce dernier rappelle que «la création d’une salle dans les combles de l’école du Châble est tout à fait irrégulière, cette salle ayant été construite arbitrairement». Il rappelle également l’arrangement intervenu avec la veuve de M. Laverrière (entrepreneur qui construisit les écoles) , puis expose les inconvénients et difficultés rencontrés par les instituteurs à cause de l’occupation de cette salle par la fanfare. Continuant, le maire fait part de l’agitation que fait régner cette affaire dans l’opinion publique.
Le maire fait sans doute preuve d’exagération quand, suite à sa demande faite aux pompiers de lui remettre les clés de cette salle, il écrit:
Au lieu de me remettre les clés, les pompiers les ont rendues à la fanfare, puis à force de souffler sur ce mort (la fanfare), ils lui ont redonné un semblant de vie pour revendiquer leur salle. De là, la demande en présence de laquelle nous nous trouvons.
Puis le maire termine ainsi: «Nous demandons que la maison d’école soit ce qu’elle doit être, une maison d’école et pas autre chose; que son personnel y soit tranquille et puisse dormir le soir après avoir bien travaillé le jour. Quant à la salle, elle peut être utilisée avantageusement pour l’enseignement du travail manuel et pour les réunions ou conférences extraordinaires. Tel est du moins l’avis de la majorité du conseil qui, si elle ne s’est pas prononcée plus nettement dans sa séance du 5 septembre sur cette question, a toute confiance dans la sagesse et la fermeté de l’administration supérieure pour sauvegarder nos intérêts scolaires».
Le 5 octobre, le sous-préfet transmet le dossier au préfet, accompagné d’une lettre explicative:
Au sujet d’une demande formée par le président de la fanfare du Châble en vue de laisser à la disposition de la société la salle inoccupée de l’école du dit hameau... La fanfare du Châble, à peu près dissoute depuis quelque temps, serait sur le point d’être réorganisée et qu’il serait désiré, pour encourager sa réorganisation, de lui permettre de faire ses répétitions dans la salle où des réunions ont déjà eu lieu.
L’autorisation ne serait accordée qu’aux conditions suivantes soumises à votre approbation:
1. Les réunions auraient lieu chaque dimanche de 1 à 4 heures du soir et trois fois par semaine de 6 à 9 heures du soir...
2. La salle ne pourrait être utilisée que par les membres de la fanfare et par les élèves que la société aurait à former; nulle autre personne ne devrait être admise.
5. Les entrées ou sorties des sociétaires devraient avoir lieu avec le moins de bruit possible.
Puis, continuant, le sous-préfet dit que «l’envoi de ce dossier a été retardé parce qu’on ne pouvait obtenir, soit de la municipalité, soit du conseil municipal, un avis ferme sur la demande de la fanfare, ainsi qu’il résulte de la délibération du 5 septembre».
En terminant, il est rappelé le règlement du différend entre la commune et les héritiers de M. Laverrière au sujet de cette salle. Nous ne connaissons pas la décision préfectorale; par contre, nous savons que la fanfare a occupé cette salle de 1898 à 1909. C’est seulement en 1909 qu’une solution durable est trouvée. Ce problème aura alimenté les conversations tant au cours des “veillées” qu’à l’auberge et aura divisé l’opinion publique dans la commune. Le règlement de cette affaire est sans doute à lier au changement intervenu aux élections municipales de 1900. A la suite de la construction d’un nouveau préau dans la cour de l’école , la fanfare demande l’autorisation d’occuper immédiatement l’ancien, attenant à la façade sud de l’école. Dans sa séance du 28 mars 1909, le conseil municipal cède cet emplacement. Puis, le 19 mai, un accord intervient pour le financement de la construction, sur l’ancien préau et sur le hangar de la Pompe à incendie, d’une salle assez vaste à usage, outre des répétitions ou des réunions, de salle des fêtes . La fanfare ainsi que les pompiers Participaient au financement de cette salle: «La fanfare contracte un emprunt de 2 000 francs. La commune versera annuellement une somme de 200 francs jusqu’à amortissement du capital. Les pompiers utiliseront cette salle et verseront 500 F. La fanfare versera tout de suite 500 F».
La salle sera terminée en décembre 1909, pour la Ste-Cécile, patronne des musiciens, grâce au concours actif des membres de la fanfare.
Nous avons parlé longuement de la salle de répétition. Le local où se déroulaient les soirées et les concerts avant la construction de la salle des fêtes, n’était qu’une vaste remise qu’on appropriait et décorait, mise gracieusement à la disposition de la fanfare par M. Honoré Girod. Après la démolition de cette remise en 1905 par M. Tapponnier pour y construire sa maison d’habitation, un local fut mis à disposition par M. A. Borgel.