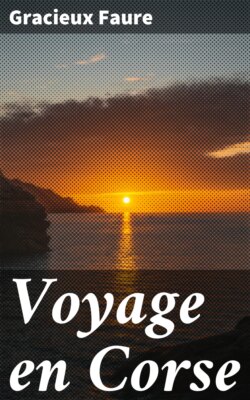Читать книгу Voyage en Corse - Gracieux Faure - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
X Mort de Gallocchio. — Anecdotes.
ОглавлениеTable des matières
Ses ennemis morts, Gallocchio semblait n’avoir plus à se garder que des voltigeurs et des gendarmes. Mais Rosola vivait encore.
Pourvu qu’ils fussent bien servis par leurs espions et leurs guides, et doués eux-mêmes de certaines qualités, les bandits n’étaient pas faciles à dénicher et à détruire. L’administration l’avait prévu. Elle accordait des primes parfois considérables, auxquelles les familles intéressées ajoutaient leur argent : de sorte que, si tuer pendant son sommeil un bandit qui croyait en lui, n’était pas pour le guide infidèle un acte de haute moralité, c’était du moins une excellente opération financière, qui rapportait beaucoup d’argent; il est vrai qu’elle n’était pas sans danger.
Huit fois sur dix, le bandit ne périssait pas autrement que par la main d’un de ses compagnons, de ses espions ou de ses guides. Dès qu’il était mort, le traître recevait secrètement le prix du sang, et disparaissait pour avertir les gendarmes. Ceux-ci arrivaient au galop, montaient à l’assaut de la citadelle, tiraient quelques coups de fusil sur le bandit, qui était quelquefois mort depuis vingt-quatre heures, et puis on dressait procès-verbal; un magnifique ordre du jour annonçait la grande victoire à toute la légion, au parquet, au ministre; des vainqueurs, les uns obtenaient le double galon, les autres, l’épaulette et la croix d’honneur, tandis que l’assassin allait enfouir son trésor : tout le monde était content.
A l’époque dont nous parlons, il se trouvait dans la contrée un bandit appelé L..., quelque peu parent de Gallocchio. Il avait pris le makis, je ne sais plus pour quel crime. Leurs relations de famille et cette similitude d’existence les rapprochèrent l’un de l’autre. Sans lui accorder une pleine confiance, Gallocchio ne le fuyait pas, et passait quelquefois la nuit en sa compagnie. Ce laisser-aller lui coûta cher.
L... était un misérable, qui, prêtant l’oreille à des suggestions criminelles, s’engagea à livrer le bandit, moyennant une grosse somme d’argent et la promesse de sa propre grâce. Sachant l’importance qu’on attachait à cette capture, il ne se gêna pas pour demander, et obtint tout ce qu’il voulut. Un jour donc, sachant qu’il doit coucher dans une grotte située sur un mamelon isolé et couvert de broussailles, il avertit sous main les voltigeurs et les gendarmes, qui arrivent au milieu de la nuit, pede suspenso, entourent le mamelon d’un cercle qui se rétrécit sans cesse, et d’où ils ne pensent pas qu’il puisse sortir. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire.
Entendant dès le début et comprenant ce qui se passe, Gallocchio s’attache au cou une de ces sonnettes que l’on met au bélier, au bœuf ou au bouc, pour guider le troupeau par ses tintements répétés; puis, agitant de temps en temps sa sonnette, il s’en va à quatre pattes à travers les broussailles, passe entre les gendarmes, leur tourne le dos, et se met en sûreté. L..., qui depuis trois jours était dans le fiumorbo, fut étonné de cette tentative, et se montra fort heureux du résultat. Il apportait une lettre d’un des meilleurs amis de Gallocchio : celui-ci ne conçut pas sur son compte le moindre soupçon.
Un autre jour, en février 1835, les deux bandits avaient fait ensemble une pénible partie de chasse; leur repas avait été commun, ils devaient coucher dans le même gîte. Simulant une fatigue extrême, L... s’endort ou feint de s’endormir profondément, tandis que, avec sa sollicitude habituelle, Gallocchio explore soigneusement les environs. Convaincu qu’aucune surprise n’est à craindre, il se couche à son tour et se livre au sommeil. L’autre, immobile comme un cadavre, ronflait déjà à pleins poumons; mais, dès qu’il s’aperçoit que son camarade dort aussi réellement, il se lève doucement sur ses genoux, prend son fusil, qu’il a eu soin de laisser armé, et lui brûle à bout portant la cervelle.
Telle fut la triste fin d’un jeune homme qui n’était pas fait pour le crime, et ne demandait qu’à marcher dans le chemin de la vertu. L’orgueil et la malice d’une méchante femme le détournèrent du bien pour le jeter dans le mal. Il était bien inspiré en voulant retarder les fiançailles jusqu’au jour du mariage; il l’eût été bien mieux encore, si, foulant aux pieds un stupide préjugé, il eût rendu leur parole à son infidèle fiancée et à sa mère. Est-ce que ces femmes parjures avaient droit à autre chose qu’à son mépris? est-ce qu’elles valaient la peine qu’il leur sacrifiât son bonheur et sa vie, qu’il fît couler à cause d’elles de véritables torrents de sang? Quand donc ce préjugé et plusieurs autres non moins funestes disparaîtront-ils sans retour du milieu de nous?
Aussitôt après son crime, L... s’enfuit, n’osant supporter la vue de ce qu’il avait fait. Il rencontra des bergers, et leur dit :
— Allez de ce côté : vous y trouverez les voltigeurs, et leur direz que Gallocchio est mort.
Je ne sais ce que devint cet homme abominable; mais son nom est encore en exécration dans tout le pays. Quant à Gallocchio, en dehors du cercle de ses inimitiés, il avait les sympathies universelles. Sa piété, sa probité, la pureté de ses mœurs, sa générosité, son intelligence, son courage, ses dramatiques aventures, en avaient fait l’idole de la contrée. On le pleura partout, partout on chanta des lamenti en son honneur. Aujourd’hui encore, on le considère . comme le type le plus parfait de ces bandits corses, dont on ne saurait approuver les excès, mais dont on a dit plus de mal qu’ils n’en méritent, parce qu’on s’est obstiné à les juger des hauteurs d’une civilisation qui n’est pas la leur.
Avant d’en finir avec Gallocchio, laissez-moi vous raconter quelques anecdotes qui, bien que sans importance, pourront peut-être vous intéresser.
Il se trouvait un jour aux environs de Cervione, charmante petite ville, bâtie à mi-côte, dans une position délicieuse, à deux pas de la mer de Toscane. Son territoire, qui s’appelait autrefois Campoloro, est d’une extrême fertilité; il fait partie de la Spiaggia d’Aleria, produit abondamment toute espèce de céréales, et surtout des vins rouges très estimés, dont il se fait dans l’île un grand commerce. Mais un produit qui, sans lui être exclusivement propre, y acquiert une qualité exceptionnelle, c’est le merle connu sous le nom de merle de Cervione.
Tout le monde sait que le merle est un oiseau voyageur, qui, à l’approche de l’hiver, abandonne pour un temps le continent européen, pour s’en aller chercher dans les îles et en Afrique de la nourriture et de la chaleur. Il n’arrive point par masses compactes, comme le pigeon, le canard, l’oie, le pinson des Ardennes et autres; il voyage isolément et sans bruit. Mais, s’il n’encombre pas l’atmosphère, on peut dire qu’il remplit le makis. Le nombre est incalculable de ceux qui s’arrêtent en Corse, où ils trouvent en quantité la baie du myrte, du lentisque, l’olive sauvage et autres menus fruits, dont ils sont très friands.
On les chasse surtout au fusil et au lacet. La chasse au fusil se fait un peu partout et de la façon la plus simple. Vous vous asseyez dans les broussailles, à portée d’un chêne vert ou d’un olivier isolé, et vous ne bougez pas. Au bout de quelques instants, vous les voyez accourir, pour prendre un peu de repos, sur l’arbre qu’a placé là pour eux la Providence. Ils jouent, ils sautillent, ils chantent, ils sont heureux : ils ne se doutent pas que l’ennemi commun de toutes les espèces animales est là qui les met en joue... Pan!... Si vous êtes adroit, un ou plusieurs tombent, les autres se sauvent. Mais bientôt cette bande est remplacée par une seconde, la seconde par une troisième, etc. Pour peu que vous soyez patient et habile, vous avez bientôt fait de remplir votre sac. Cette chasse est particulièrement bonne le matin et le soir.
La chasse au lacet se fait principalement aux environs de Cervione. Le myrte et le lentisque, les deux arbustes favoris des merles, y abondent tellement, que ces pauvres oiseaux s’y précipitent en quantités énormes, pensant avoir trouvé le paradis sur terre. Ils mangent, ils mangent, ils mangent, et digèrent si bien, que, sous l’influence de ces baies odorantes, toute leur personne se transforme. Quand vous les déshabillez de leurs plumes, leur corps a changé de couleur : leur peau et leur chair, généralement rougeâtres, sont devenues blanches comme le lait, parfumées comme la rose. C’est quand ils sont en cet état qu’on les nomme merles de Cervione. Les amateurs prétendent que c’est le plus délicat et le meilleur de tous les mets, surtout si l’on associe leur parfum à celui de la truffe.
Avant l’arrivée des merles, une compagnie italienne
— car nous abandonnons aux étrangers l’exploitation de notre gibier, comme celle de nos poissons et de notre corail — aborde sur nos rivages, avec ses approvisionnements et ses engins de chasse. Dans le taillis, généralement très fourré, ces messieurs tracent une infinité de tout petits sentiers, dans lesquels, à courte distance, ils placent une foule de barrières de lacets; puis ils se couchent sous un arbre, pour fumer leur cigare, dormir, ou monter tour à tour la garde. Quant à la chasse, elle se fait toute seule : les malheureux merles se disputent à qui périra le premier. On dit qu’il en périt mille chaque jour; et, si vous vous trouvez sur le port de Bastia, lorsque part le vapeur pour Marseille ou Livourne, vous voyez de tout côté des montagnes de caisses et de paniers pleins de merles.
Donc, un jour, Gallocchio rôdait autour de Cervione, attendant quelqu’un qui était à la ville. La faim le prit : il entra dans une maison écartée, pour demander à manger.
— Per Dio santo, répond le maître du logis, qui le connaît, cela ne pouvait mieux se rencontrer : j’ai pris ce matin deux douzaines de merles; mon vin est excellent : nous allons faire un bon repas.
— Quel malheur qu’aujourd’hui ne soit pas hier! Les merles sont mon plat favori, et tu m’as fait venir l’eau à la bouche ; mais c’est aujourd’hui vendredi, et non seulement je fais maigre ce jour-là, mais je jeûne.
Et il se contenta d’un morceau de pain et de fromage.
En Corse, comme dans le midi de la France, on appelle compère et commère les parents de l’enfant que l’on a tenu sur les fonts du baptême.
Gallocchio avait un compère dans le canton de Vezzani. Ce canton, un des plus étendus de la Corse, se compose de montagnes, de vallées et de plaines magnifiques, qui sont en grande partie malsaines en été. Son territoire, si vaste, si beau, si varié, si fertile, est presque entièrement couvert d’immenses forêts, d’épais makis et d’excellents pâturages ; mais sa population, très peu nombreuse, est disséminée dans cinq ou six villages perdus dans cette immensité, et se compose presque entièrement de bergers. Or les bergers, comme on l’a dit ailleurs, étaient les principaux admirateurs des bandits.
Le compère aimait beaucoup Gallocchio, lui avait souvent rendu service, et se montrait en toute occasion glorieux de le voir rattaché par un fil à sa famille. Mais comme il était très habile, grand amateur du métal jaune et blanc, et peu difficile sur les moyens de grossir son pécule, l’idée lui vint d’exploiter cette position pour s’enrichir. En conséquence, quand le bandit était absent, il se présentait chez les personnes qui le craignaient ou croyaient devoir le craindre; et il leur demandait, de sa part, en leur recommandant un silence absolu, de l’argent, des vêtements et des vivres. Sachant ses rapports avec le bandit, chacun s’exécutait sans rien dire; et par ce moyen la bourse, la garde-robe et le buffet du rusé compère se remplissaient à vue d’œil. Mais, comme dit un vieux proverbe, les jours se suivent et ne se ressemblent pas.
Gallocchio avait dans la contrée un proche parent nommé Lucciana, qui comptait parmi les bons propriétaires. Celui-ci le rencontre un jour et lui dit :
— Comment se fait-il, lorsque tu es dans nos parages et que tu éprouves quelque besoin, comment se fait-il que, au lieu de t’adresser à mon frère ou à moi, tu ailles demander des secours à nos ennemis? C’est honteux, pour toi comme pour nous.
— Moi !
— Oui, toi. N’as-tu pas, hier encore, envoyé ton compère chez M. X..., pour en solliciter de l’argent et du linge? Et il y a longtemps que ce commerce dure.
—Suis-moi : nous allons savoir la vérité. — Il paraît, dit-il à son compère, que depuis quelque temps un mauvais plaisant se présente chez mes ennemis, et leur demande de ma part de l’argent et d’autres objets. Est-ce que tu ne pourrais me dire le nom de cet homme?
— C’est moi.
— Et qui t’a chargé de cette mission?
— Personne; mais, comme ce sont des ennemis, j’ai cru qu’il était permis de les rançonner.
— Et, pour un peu d’argent volé, tu n’as pas craint de me déshonorer aux yeux du public, de ma famille, de mes ennemis eux-mêmes! Je devrais... mais, à cause de mon filleul, je te laisse la vie. Seulement, pour que la leçon ne s’efface pas de ta mémoire, je vais l’écrire sur tes épaules.
Et, avec la crosse de son fusil, il lui donne une de ces corrections qui doivent en effet laisser des traces.
Ce compère ne fut pas le seul à exploiter le nom de Gallocchio. Du côté de Castifao, à la jonction des trois arrondissements de Bastia, de Calvi et de Corte, un mauvais sujet rencontre un marchand de bestiaux, et se fait donner un bœuf, en se disant Gallocchio et le menaçant de toute sa colère. Gallocchio, qui se trouvait alors à quinze ou vingt lieues de là, en est informé : il se met aussitôt en route. Parvenu à Castifao, il se présente au voleur avec deux de ses camarades et une troupe de paysans destinés à servir de témoins.
— C’est donc toi, lui dit-il, qui est Gallocchio?
— Non, je ne suis pas Gallocchio.
— Tu l’étais hier, pour commettre un vol en son nom. Comment se fait-il que tu ne le sois plus aujourd’ hui?
Et, sans l’intervention des assistants, il l’aurait immolé sur place. Il se contenta de lui couper une oreille et de le livrer à la justice.
Les Corses travaillent volontiers la pierre, les métaux et le bois; ils ont peu de goût pour le travail des champs, et cependant c’est dans l’agriculture qu’est l’avenir de leur pays. Pour ces travaux pénibles, il leur vient chaque année trois ou quatre mille ouvriers italiens, qu’ils désignent sous le nom général de Lucquois, parce que le plus grand nombre est de Lucques. Sobres et laborieux, ces braves gens ne vont pas vite à la besogne; mais, qu’ils soient surveillés ou non, ils ne s’arrêtent que pour manger. On évalue à deux cents francs, en moyenne, ce que chacun d’eux économise dans une campagne et emporte dans son pays : au total, 800,000 francs, le plus net du produit de la Corse!
Gallocchio rencontre un jour, dans la forêt de Tizzavona selon les uns, dans les bois de Cervione selon les autres, un de ces malheureux Lucquois, qui s’arrachait les cheveux et pleurait à chaudes larmes.
— Qu’as-tu donc, mon ami? lui dit-il.
— Je rapportais à ma pauvre famille deux cents francs environ, que j’avais gagnés par six mois de travail. Mais j’ai rencontré là-bas ce brigand de Gallocchio, qui me les a volés; il ne m’a pas même laissé de quoi payer mon passage sur le bateau.
— Tu es sûr que c’est Gallocchio?
— Parfaitemant sur : il m’a dit lui-même son nom.
— Est-ce que tu le reconnaîtrais?
— Entre mille. Il s’est dirigé vers la fontaine.
— Mène-moi vers lui...
— Le voilà, le voilà, en train de déjeuner : c’est Gallocchio.
— Non, mon ami : c’est moi qui suis Gallocchio. Celui-là n’est qu’un infâme voleur, qui s’est servi de mon nom pour te dépouiller. — Rends l’argent que tu as pris à cet homme, et à genoux !
Le pauvre Lucquois obtint la grâce du faux Gallocchio ; et le misérable en fut quitte, comme les autres, pour une rude correction.
— Savez-vous bien, mon commandant, que, par certains côtés, votre bandit Gallocchio ressemble singulièrement à un honnête homme, et que, si je faisais partie d’un jury chargé de le juger, je ne me ferais aucun scrupule de l’acquitter?
— Vous auriez tort. Il est écrit : Homicide point ne seras, de fait ni volontairement ; il n’y a exception que pour le cas de légitime défense. Or, combien de fois, dans les meurtres qu’il a commis, Gallocchio s’est-il trouvé en état de légitime défense, c’est-à-dire, obligé de donner la mort immédiatement, sous peine d’être immédiatement tué lui-même? Est-ce que Ange-Joseph, les Antonini, les Cesario et tant d’autres avaient le poignard levé sur sa poitrine, le canon de leur fusil braqué contre sa tête? Nullement. C’est lui, au contraire, qui leur a dressé des embûches, les a tués en guet-apens, librement et volontairement, au moment où ils ne menaçaient en rien ses jours.
— Et ces injures, et ces parjures, et ces calomnies, et tant de machinations ayant pour objet de le perdre, les comptez-vous pour rien? N’est-ce pas lui qui a toujours été provoqué par d’implacables ennemis ?
— C’est vrai : aussi accordez-lui les circonstances atténuantes le plus largement que vous voudrez. Mais parce qu’il plaît à deux femmes de lui manquer de parole, cela lui donne-t-il le droit de tuer quinze ou vingt hommes? Est-ce que le vice autorise et excuse le crime? est-ce que l’ivresse, la vanité blessée, la colère, etc..., peuvent innocenter l’assassinat? Mais alors il faut jeter au feu le Code pénal : car, enfin, quel est l’homicide ou le voleur qui ne puisse se retrancher derrière un de ces arguments, et dire : J’étais ivre! on avait blessé mon amour! j’étais dominé par certaine passion! j’étais en colère! j’avais besoin d’argent! etc... Le grand tort de Gallocchio fut de ne pas suivre les conseils du curé d’Ampriani. Que de malheurs eussent été évités ! Pour moi, je ne l’aurais pas condamné à mort, mais je ne l’aurais pas non plus acquitté.