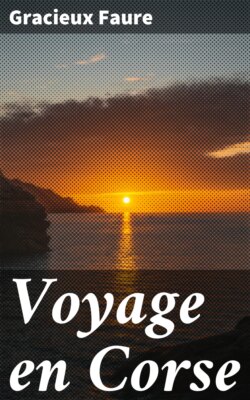Читать книгу Voyage en Corse - Gracieux Faure - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I Côte orientale. — Golfes. — Aleria.
ОглавлениеTable des matières
Bonifacio, battu des vents tout le long de l’année, se trouvait depuis quelques jours dans un calme complet. Pas le moindre mouvement dans les airs, pas la moindre feuille agitée sur les arbres ; le temps était lourd, la chaleur accablante; chacun cherchait l’endroit le plus frais de son habitation; personne n’osait s’aventurer dans la campagne, de peur d’une insolation ou autre accident de ce genre. Heureusement, nous avions Scipion, dont les récits abrégeaient la longueur des jours, rafraîchissaient l’atmosphère, nous charmaient l’esprit et le cœur. Un orage de nuit détruisit ce calme plat, rétablit les courants atmosphériques, remit la terre et le ciel dans leur état normal : il fut permis alors de sortir sans danger. Le capitaine X., ayant obtenu deux semaines de congé, put nous accompagner.
La côte orientale de la Corse n’est qu’une longue plaine, légèrement ondulée, de 180 kilomètres environ, sur 5 à 6 de largeur moyenne. Elle est à 85 kilomètres des côtes d’Italie. Généralement unie et peu échancrée, elle n’a que deux golfes importants, ceux de Santa-Manza et de Porto-Vecchio. Le premier, un des plus beaux et des plus sûrs de la Méditerrannée, est complètement désert; il n’est fréquenté que par des myriades d’oiseaux aquatiques et quelques barques de pêcheurs napolitains. Porto-Vecchio n’est pas moins beau que Santa-Manza; mais le fond n’en est pas, dit-on, toujours solide, et il se trouve ouvert aux vents de la montagne, qui parfois y jettent les Vaisseaux à la côte. Il a d’ailleurs l’avantage de posséder sur ses bords une petite ville de 2000 âmes, entourée d’une muraille, et classée naguère comme place de quatrième ordre; on l’a depuis peu déclassée. Les autres golfes plus petits que l’on y voit encore, se trouvent, comme les deux grands, dans l’arrondissement de Sartène, au sud-est par conséquent. Au-dessus et jusqu’à Bastia, on ne rencontre plus que des lacs, des étangs et des marais.
Tant que l’Italie fut fractionnée en cinq ou six petits États différents, nous n’avions aucun besoin d’être fortement protégés contre elle sur la côte orientale de Corse. Mais aujourd’hui que, grâce à notre secours, elle a chassé les étrangers pour ne plus former qu’un seul État puissant ; aujourd’hui qu’elle paraît oublier tant de liens qui nous unissent ensemble, pour s’associer aux Teutons contre les Latins, il est nécessaire que nous ayons en face d’elle une place de premier ordre, pour la défense et pour l’attaque : cette place, indiquée par la nature, est Santa-Manza, en face même de Rome, comme au nord C’est Saint-Florent, et Ajaccio au sud-ouest. Ces trois splendides golfes, reliés deux à deux par Bastia, Calvi et Bonifacio, feraient de la Corse une station inabordable.
La plus belle portion de la plaine orientale s’étend depuis l’embouchure du Golo jusqu’à la tour de la Sollenzara, sur 80 kilomètres de développement et 7 ou 20 de largeur moyenne. Les marins l’appellent la Spiaggia d’Aleria, à cause de la ville d’Aleria, la plus considérable de la Corse, que l’on y voyait autrefois. Cette plaine est la plus grande de l’île. Il faudrait chercher longtemps pour trouver en Europe un coin de terre plus ravissant, où le soleil verse avec plus de profusion la chaleur, la lumière et la fécondité. Heureux si le siroco ou sud-est ne venait corrompre ces bienfaits, en y mêlant l’insalubrité !
Le fleuve que vous voyez est le Tavignano, ou Rhotanus des anciens. Il sort du lac Nino, à l’endroit où se croisent la chaîne centrale et la chaîne secondaire, qui passe au-dessous de Corte. Après un cours de 80 kilomètres, il tombe dans la mer Tyrrhénienne, où il verse, même au mois d’août, 78,000 mètres cubes d’eau par minute; mais, du moment où il entre dans la plaine jusqu’à la mer, il change de nom et s’appelle Fiume d’Aleria. Son bassin proprement dit contient 83,000 hectares. C’est dans un angle formé par ce fleuve, à 3 kilomètres de son embouchure, et traversé par la route de Bonifacio à Bastia, que se trouvent les ruines ou plutôt les vestiges d’Aleria.
Aleria, qu’Hérodote appelle Alalia, est la ville de Corse la plus anciennement connue. On en attribue la fondation aux Pélasges, aux Phéniciens, aux Étrusques, aux Phocéens, etc. : ce qui prouve que sa véritable origine est inconnue et se perd dans la nuit des temps. Ce qui est certain, c’est que, au sixième siècle avant J.-C., fuyant sans doute les armes victorieuses des Perses, qui avaient envahi l’Asie occidentale, une colonie de Phocéens vint aborder sur nos rivages, s’empara d’Aleria selon les uns, ou la fonda selon les autres. C’est de là que partit, en 599, un de leurs chefs, nommé Euxène ou Protis, qui bâtit sur vos côtes, dans les poétiques circonstances que l’on sait, la ville de Marseille, au territoire des Segobriges : de sorte que, sans trop de bonne volonté, Aleria peut être considérée comme la mère de Marseille, et la grand’mère de ses nombreuses filles, Nice, Antibes, etc.; ce qui est un grand honneur pour la Corse.
— Mon commandant, dit alors le capitaine X., j’ignore, je l’avoue, les circonstances de la fondation de Marseille, et je ne serais pas fâché de les savoir.
— Nan, roi des Segobriges, avait une fille à marier. Or, dans ce temps et dans ce pays, l’usage voulait que le père convoquât à un splendide festin tous ceux qui prétendaient à la main de sa fille, de sorte que celle-ci pût aisément les voir et les entendre, les comparer et faire choix entre eux. Quand le repas était fini, elle descendait de son siège, parcourait toute la salle, une aiguière d’argent à la main ; et lorsqu’elle arrivait en face de celui qu’elle avait choisi, elle s’arrêtait, lui versait de l’eau sur les doigts, le désignant ainsi pour son époux; et tout le monde s’inclinait.
La veille du jour de cet intéressant festin, un vaisseau phocéen d’Aleria était entré dans le port. Son chef, Euxène ou Protis, alla naturellement rendre visite au roi Nan, qui le retint pour le grand dîner, ne se doutant pas qu’il invitait son gendre. La princesse, en effet, touchée de sa bonne mine ou de ces formes distinguées que donne la civilisation, lui accorda la préférence. Il s’arrêta donc dans les États de son beau-père, et y fonda Marseille, que l’on appelle encore aujourd’hui la cité phocéenne.
Les Phocéens, paraît-il, ne restèrent guère plus de vingt ans à Aleria; elle leur fut enlevée par les Étrusques, ligués avec les Carthaginois. A la suite de la première guerre punique, Publius Cornélius Scipion s’en empara, la détruisit de fond en comble; et, soit à cause de l’importance même de la ville, soit à cause des difficultés du siège, il considérait cette conquête comme un de ses principaux titres de gloire. La preuve, c’est qu’il voulut qu’on en fît mention dans son inscription tumulaire, laquelle se conserve dans un des musées de Rome, et forme, par parenthèse, un des plus anciens monuments de la langue latine.
Au temps des guerres civiles, Marius ayant fondé et peuplé de ses partisans l’importante cité de Mariana, vers l’embouchure du Golo, le dictateur Sylla reconstruisit Aleria pour contre-balancer l’influence de son rival. Depuis cette époque, c’est-à-dire sous la domination romaine et durant une partie du moyen âge, elle fut comme la capitale de la Corse. Quant à sa population, on en est aussi aux hypothèses, les auteurs la faisant varier depuis 15,000 jusqu’à 100,000 âmes,
Au neuvième siècle après J.-C., elle fut prise, saccagée, brûlée par les Sarrasins d’Afrique, et ses habitants massacrés ou emmenés en esclavage. Il paraît toutefois qu’elle ne fut pas complètement anéantie, attendu qu’il en subsistait encore une partie sur la fin du treizième siècle. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’une misérable bourgade de 75 habitants, pour un territoire de plus de 10,000 hectares, et dans un des pays les plus beaux du monde.
Comment s’est opérée cette triste métamorphose? De la manière la plus simple. Si, après avoir démoli Aleria, les treize cités maritimes dont parle le géographe Ptolémée et les nombreux villages de la côte, les Sarrasins fussent partis pour ne plus revenir, les habitants n’auraient pas tardé à redescendre dans leurs foyers et à rebâtir leurs maisons; ils auraient continué à tenir déblayé le lit des torrents, à mener leurs eaux se perdre dans la mer. Mais, les incursions barbaresques renouvelant pendant neuf siècles leurs déprédations et leurs ravages, nos populations durent finir par abandonner la plage et chercher un peu de sécurité dans la montagne. A partir de ce jour, les eaux venues des hauteurs, n’ayant plus personne pour les maîtriser et les conduire, se sont répandues de tous côtés, formant des flaques et des marais, des étangs et des lacs; tandis que, poussés en sens contraire par les vagues, les sables de la mer s’amoncelaient sur le rivage, obstruaient l’embouchure des fleuves, formaient çà et là des barres infranchissables, au point qu’en certains endroits les marais se trouvent plus bas que la mer : ce qui rend leur assainissement très difficile, sinon impossible.
Voyez, par exemple, un peu au nord de l’embouchure du Tavignano, cet étang de 570 hectares que l’on nomme l’Étang de Diana. Il servait jadis de port à la ville d’Aleria, et recevait les plus gros navires ; aujourd’hui, pour les causes que l’on vient de dire, il est complètement barré et sans communication avec la mer. Seules, de petites barques s’y promènent pour pêcher les grosses et excellentes huîtres dont il est rempli. Si Aleria sortait de ses ruines, elle n’aurait donc plus de port.
Des étangs que vous apercevez au sud, le plus grand, celui d’Urbino, a 750 hectares. Ses eaux salées abondent aussi en poissons et en huîtres; mais, comme celui de Diana, il est entièrement séparé de la mer, et se trouve entouré de vastes marécages. Tant que les eaux inférieures sont grossies par la fonte des neiges, tout va bien ; mais dès qu’arrive l’été, et que, sous l’influence d’un soleil brûlant, entrent en fermentation les matières végétales et animales qu’elles contiennent, alors il en sort, non pas la peste, la fièvre jaune et le choléra, comme des roseaux du Nil, du Mississipi et du Gange, mais des fièvres paludéennes, qui ressemblent à celles du Sénégal et donnent rapidement la mort.
Pour vous faire comprendre la promptitude avec laquelle, dans nos pays, s’opèrent ces ensablements, voici, au sud de Bastia, un immense étang de 1500 hectares de superficie, sur 3m 50 de profondeur ; et, au pied des montagnes, à l’ouest de cet étang, un petit village de 200 âmes, nommé Biguglia. Sous les Pisans et les Génois, Biguglia était la capitale de l’île; et l’étang qui a pris son nom, lui formait un port aussi vaste que sûr, que fréquentaient les flottes des deux républiques qui se disputaient les îles de la Méditerranée. En 1372, les Corses, commandés par Henri de la Rocca, battirent les Génois et leur enlevèrent leur capitale, qui, depuis cette époque, n’a fait que décroître jusqu’à devenir la misérable bourgade que nous voyons; tandis que son port se comblait par les atterrissements des torrents, se fermait aux ondes de la mer, et se changeait en un marais fangeux.
En procédant naguère à des travaux d’endiguement, pour empêcher les eaux de l’étang de se répandre et leur assurer un niveau constant, on a trouvé un navire enseveli dans les sables, à 10 pieds ou 3m 33 de profondeur. Or, comme cet enfouissement ne peut pas remonter au delà de l’époque où Biguglia fut détruite par les Corses, il s’ensuit qu’il a été de 0m 66 par siècle, et de plus de 6 millimètres par an.
Un conseiller à la cour de Bastia possédait une propriété charmante, à laquelle il ne manquait que de l’eau. Depuis longtemps il savait par cœur toutes les formules de l’abbé Paramelle, et avait fait des fouilles sur plus de vingt points différents; mais l’eau ne venait toujours pas. Un jour, il s’aperçut que des traces de sangliers, venus de tous côtés, allaient aboutir à un point commun du makis, où ces messieurs se roulaient, se vautraient, labouraient le sol, pour y trouver de la fraîcheur. Le lendemain les ouvriers étaient au travail, et découvraient, à trois mètres de profondeur, non pas un filet d’eau, mais une fontaine véritable, faite de main d’homme et parfaitement installée. Ses eaux abondantes tombent, par un large bec en granit, dans un bassin rectangulaire, destiné à servir de lavoir. Aux deux angles, à hauteur convenable, se trouvent de larges pierres plates, pour poser les tinettes et les cruches ; et des deux côtés du bassin, règnent parallèlement des bancs en granit, pour permettre aux commères de se reposer et de jouer plus commodément de la langue.