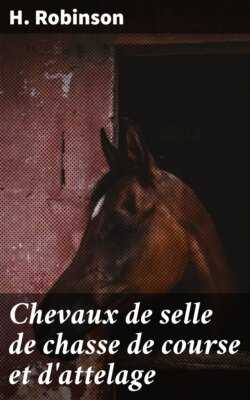Читать книгу Chevaux de selle de chasse de course et d'attelage - H. P. Robinson - Страница 14
ОглавлениеET MOUVEMENTS SUR PLACE.
On désigne sous le nom générique d’allures tous les mouvements que fait le cheval en vue de se déplacer.
Les allures se divisent en naturelles et défectueuses.
Les premières sont: le pas, le trot et le galop.
Les secondes sont: l’amble, le traquenard et l’aubin.
On appelle battue, foulée ou piaffée, le son que produit le pied en touchant le sol: dans le pas on perçoit quatre battues, deux seulement dans le trot et trois dans le galop.
Le pas est la plus lente, la plus douce des allures naturelles du cheval; plus ses battues sont égales, plus elle est régulière: quand l’animal part du pied droit les mouvements de ses quatre membres se succèdent dans l’ordre suivant: 1° antérieur droit; 2° postérieur gauche; 3° antérieur gauche; 4° postérieur droit. Un membre n’attend pas pour se lever que celui qui le précède soit posé, ce qui fait que dans cette allure, l’animal a constamment deux membres posés sur le sol et deux membres levés, à des degrés différents.
Sur un sol plat, le cheval doit placer chaque pied postérieur dans l’empreinte laissée par le pied antérieur du même côté. Si le cheval monte un plan incliné, ou s’il tire un fardeau considérable, le pied postérieur n’atteindra pas l’empreinte de l’antérieur; dans une descente très-rapide, au contraire, l’empreinte du pied antérieur sera dépassée.
Le pas est franc, lorsqu’il est prompt, sûr et léger; il est régulier quand les quatre battues se succèdent à intervalles égaux; il est relevé, quand le cheval meut vigoureusement ses membres antérieurs.
Le trot tient le milieu pour la rapidité entre le pas et le galop: il se distingue du pas en ce que dans cette dernière allure, le cheval a toujours deux membres en contact avec le sol, tandis que, dans le trot, il repose un instant sur deux membres qui se meuvent avec accord et se trouve un instant suspendu sans contact avec le sol.
Le trot, quoiqu’on le range au nombre des allures naturelles, n’est cependant presque jamais employé par le cheval à l’état sauvage. Il n’en use que pour passer du galop au pas. Cette allure dépend beaucoup par conséquent de l’éducation des poulains, et la meilleure preuve qu’on puisse en donner, c’est qu’au moyen-âge, par suite d’un dressage différent, l’allure du trot avait peu de points de ressemblance avec celle que l’on voit aujourd’hui.
Dans le petit trot, les pieds postérieurs n’arrivent pas aux empreintes laissées par les pieds antérieurs. Ces dernières sont dépassées au contraire dans le trot très-allongé.
Le galop est la plus accélérée des allures: il consiste dans une succession de sauts dans lesquels le bipède antérieur est soulevé le premier et à une plus grande hauteur que le bipède postérieur.
On dit que le cheval galope à droite ou à gauche, suivant que le membre antérieur droit ou gauche dépasse l’autre membre antérieur. S’il galope à droite, l’animal prend son point d’appui principal sur le membre postérieur gauche, ce qui explique la facilité avec laquelle il tourne à droite et la difficulté qu’il éprouverait à tourner du côté opposé. On dit que le cheval galope à faux quand il fait un cercle à gauche tout en galopant sur le pied droit et vice-versâ.
Voici l’ordre dans lequel les quatre membres se meuvent dans cette allure; je suppose que le cheval galope à droite: 1° le membre antérieur droit, 2° le membre postérieur gauche, 3° le bipède diagonal gauche.
De là les trois battues dont on perçoit le son; de là aussi cette conséquence que les deux membres qui opèrent chacun isolément font plus de fatigue que les deux autres qui travaillent de concert. Pour éviter d’user un cheval qui galope fréquemment, il faut donc employer alternativement le galop à droite et le galop à gauche.
On dit que le cheval est désuni s’il galope à droite du bipède antérieur et à gauche du bipède postérieur.
On donne le nom de galop à quatre temps à une allure de manège dans laquelle le bipède diagonal n’agit pas avec un parfait accord; dans le galop à quatre temps à droite, les battues se succèdent dans l’ordre suivant:
1° Le membre antérieur droit,
2° Le membre postérieur gauche,
3° Le membre postérieur droit,
4° Le membre antérieur gauche.
Selon la rapidité de l’allure, on distingue le petit galop ou galop de promenade; le galop ordinaire, galop de chasse ou galop rond; le grand galop ou galop de course.
L’amble consiste dans le mouvement successif des deux bipèdes latéraux; cette allure n’a d’autre rapport avec le trot que de fournir également deux battues.
Parmi les chevaux qui amblent, les uns prennent cette allure parce qu’ils y ont été dressés, les autres la tentent par suite de la faiblesse qui leur rend plus pénibles les allures naturelles.
Le cheval ambleur est agréable à monter, mais il est exposé à de fréquentes chutes au moindre faux pas; il fait, du reste, beaucoup de chemin, mais dure rarement aussi longtemps que le cheval trotteur.
Pour dresser les poulains à l’amble, il suffit d’attacher l’un à l’autre, au moyen d’une courroie, les deux membres de chaque bipède latéral et, dans cet état, de laisser les chevaux en liberté dans la prairie. Ils auront bientôt pris la seule allure qui leur soit permise dans cet état, et la conserveront toute leur vie.
Le traquenard est à l’amble ce que le galop à quatre temps est au galop ordinaire. Les membres agissent par bipèdes latéraux, mais les deux pieds du même côté ne touchent pas le sol de commun accord, de sorte que cette allure donne quatre battues comme le pas.
Les chevaux dont les reins sont faibles, les jambes ruinées, la prennent parfois.
L’aubin tient du galop et du trot: le cheval qui aubine galope du bipède antérieur et trotte du bipède postérieur, par suite de la faiblesse de son arrière-main. Des chevaux jeunes dont la formation n’est pas complète, prennent parfois cette allure défectueuse, mais quand on la rencontre chez des chevaux faits, c’est un indice d’usure complète.
MOUVEMENTS SUR PLACE.
Les mouvements sur place sont au nombre de quatre, savoir: le cabrer, la ruade, le saut et le recul.
Le cabrer est un mouvement par lequel le cheval enlève son avant-main et la tient en équilibre sur les jarrets, qui sont extrêmement tendus; cette action exige une grande dépense de forces musculaires.
L’animal qui va se cabrer porte les membres postérieurs aussi en avant qu’il le peut pour les rapprocher du centre de gravité ; il élève alors la tête et l’encolure, et imprime une impulsion vigoureuse à l’avant-main qui quitte le sol. Les muscles qui rattachent les membres postérieurs à la colonne vertébrale, ont la plus grande part à l’effort que fait le cheval. La durée du cabrer est ordinairement instantanée, cependant quelques chevaux très-vigoureux restent parfois dans cette position pendant un laps de temps plus ou moins long.
La préparation qu’exige chez le cheval le mouvement du cabrer, sert d’avertissement aux cavaliers qui peuvent au moyen de l’éperon écarter l’arrière-main du centre de gravité ou pousser vigoureusement en avant le cheval qui ne pourrait se cabrer sans prendre un temps d’arrêt.
Si les jarrets et les reins sont faibles, le cabrer est toujours fort dangereux pour le cavalier, car le cheval est exposé à se renverser. Si le cavalier n’a pu empêcher le cabrer de se produire, il doit immédiatement rendre la main et porter le plus qu’il peut le poids du corps en avant pour faire retomber le cheval sur ses quatre membres.
La ruade est un mouvement brusque du cheval qui, soit au repos, soit en action, baisse la tête, soulève son arrière-main et lance les membres postérieurs en arrière en montrant les fers.
La ruade en action n’a jamais que fort peu d’étendue, mais au repos, quand le cheval s’y est préparé, il peut lancer les membres à une grande hauteur. Pour effectuer ce mouvement, il rapproche du centre de gravité les membres antérieurs, et baisse la tête. Un cavalier habile s’apercevra de l’intention de ruer comme de celle de se cabrer, et, en tenant la tête levée, il y fera obstacle.
La ruade demande une dépense de force bien moins considérable que le cabrer, ce qui s’explique facilement, le centre de gravité du cheval que l’on suppose être placé à l’origine du dos, étant bien plus rapproché des membres antérieurs que des membres postérieurs.
Le saut est un déplacement du corps qui a pour cause la détente rapide des quatre membres. Le cheval plie les jarrets et la colonne vertébrale et, les tendant tout à coup, est violemment enlevé de terre. En retombant, il plie de nouveau toutes les articulations pour amortir la secousse.
Le cheval saute par étourderie, par gaîté, ou bien pour se débarrasser de son cavalier. Si celui-ci est entendu, il lui sera facile de prévoir l’acte auquel le cheval va se livrer et sinon d’y mettre obstacle, du moins de se lier assez fortement à la selle pour éviter d’être désarçonné.
Le recul offre au cheval une double difficulté à vaincre, provenant de la position du centre de gravité et de l’inclinaison des membres postérieurs, aussi favorable aux mouvements en avant que défavorable au recul.
L’animal, pour effectuer ce mouvement, porte la tête en arrière, rejette le poids du corps sur l’arrière-main, courbe son rein, et détache du sol un membre postérieur qu’il reporte à quelque distance en arrière.
L’action de reculer, très-fatigante pour le cheval, est cependant indispensable pour assouplir le rein des jeunes chevaux.