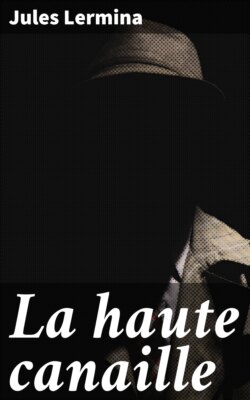Читать книгу La haute canaille - Jules Lermina - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII
HISTOIRE D’UN NIAIS
ОглавлениеTable des matières
Jacques Darneval, car nous avons appris le nom du propriétaire de Braco, s’était élancé comme un fou dans la direction de la villa d’Airvault.
Quiconque a aimé–et je ne fais pas à mon lecteur ni à ma charmante lectrice l’injure de croire que ceci ne les touche pas directement–connaît cette fièvre, sœur de la folie, qui s’empare du cerveau alors que quelque danger menace l’être auquel on a donné sa vie.
C’était un bon et brave garçon que Jacques Darneval.
Qu’on nous permette de raconter son histoire aussi brièvement que possible.
Notre tâche sera d’ailleurs facilitée par une circonstance spéciale.
Jacques était entré dans la vie au milieu d’événements mystérieux qui, de bonne heure, l’avaient rendu méditatif. Et il avait pris l’habitude–malheureusement trop rare–de tenir, depuis l’âge de vingt ans, une sorte de journal dans lequel il consignait les faits, grands ou petits, qui traversaient son existence.
Ce manuscrit–absolument authentique et qui sert de base à ce récit–est écrit d’abord avec toute la naïveté d’une âme ardente et jeune; mais, plus tard, chaque ligne crie le désespoir et la colère vengeresse.
Il nous a été remis par le dernier ami de son auteur, par l’homme qui–après les innombrables tortures subies par le malheureux Jacques, l’a soutenu, relevé, aidé dans la tâche terrible qu’il dut s’imposer un jour, à la suite des événements que nous sommes en train de raconter.
Ce dépositaire fidèle des manuscrits de Jacques nous a autorisé à y puiser largement et à révéler des faits inconnus, dont une catastrophe récente–l’affaire Estoret–a trop prouvé non seulement la vraisemblance, mais même l’exacte réalité.
Donc, bien des fois il nous arrivera d’emprunter à ces écrits certaines pages, rédigées dans des circonstances si douloureuses et si étranges, qu’elles sembleraient inventées à plaisir, si les preuves de leur vérité ne surabondaient pas.
Et chaque fois le lecteur appréciera ce qu’il y avait de vraie noblesse, de générosité virile dans l’âme de celui dont l’infamie des autres a fait plus tard un vengeur implacable.
Laissons un instant la parole à Jacques lui-même:
«Mai185.
Aujourd’hui, j’ai vingt ans, et je viens de vendre ma première toile. Oh! petite œuvre et petit prix. Mais cinquante francs! Que ceux à qui deux louis et demi n’ont jamais ouvert d’horizon ensoleillé me jettent le premier dédain. C’est que, pour moi, cet argent, le premier que j’ai gagné par mon travail, après cinq années d’efforts, d’illusions et de désillusions, c’est que ces trois pièces d’or représentent à la fois et la récompense du passé et l’affirmation de l’avenir.
Je suis sorti à travers les rues, fier, la tête haute. J’aurais voulu crier à tous: Je gagne ma vie! l’argent que j’ai dans ma poche, je le dois à mon travail! Tout à l’heure, il est passé auprès de moi, sur le boulevard, un gommeux qui sortait du café Anglais, où peut-être il avait dépensé quatre fois la somme en question. Je l’ai regardé avec mépris et me suis dirigé, orgueilleux, vers un bouillon Duval. Je ne vais pas au café Anglais, moi! Je sais ce que coûte l’argent qu’on gagne!»
«Quinze jours après.
Je suis un égoïste, et je m’accuse sincèrement. Lorsque, pour la première fois, j’ai ouvert le livre que je ne fermerai plus que lorsque la mort arrachera la plume de mes mains, il était de mon devoir d’inscrire à la première ligne un nom vénéré, le nom chéri que je ne peux prononcer sans que les larmes jaillissent de mes yeux.
Le nom de mon père.
Où est mon père? Pourquoi depuis si longtemps ne l’ai-je plus revu, là, auprès de moi comme au jour où, pour la première fois, il me mit un crayon aux doigts en me disant:
–Travaille!
Est-il donc vrai, pauvre père, que jamais ne me sera donné le bonheur de te serrer dans mes bras, d’entendre de ta bouche le récit de cette catastrophe –qui a dû être terrible, et que je ne connais pas– bien terrible, certes, puisqu’elle t’a à jamais séparé de moi que tu aimais tant? Le mystère qui a entraîné ta disparition ne se dissipera-t-il pas? Comme cela est extraordinaire! J’ai cherché, interrogé, je me suis enquis de tous côtés, je n’ai rien su, rien appris! Et ma mère, était-elle donc partie avec toi?
Quand je songe à tout cela, je me sens épouvanté. Faut-il que l’enfance soit si insouciante et si oublieuse que ses souvenirs ne puissent fournir à l’homme fait aucun indice certain? Hélas! on se laisse aller à la vie sans la regarder, sans la voir, comme un marin qui fermerait les yeux, alors que le courant l’emporte.
On dit qu’à mesure que l’âge vient, les temps premiers de la vie se détachent soudainement dans les brouillards de la mémoire comme des tableaux nets et clairs. Essayons si dans la confusion de mon cerveau je ne retrouverai pas des lignes plus fermes.
Voici: regardant en moi-même, je retrouve une éclatante vision: la beauté de ma mère. Cependant, j’ai peine il me souvenir qu’elle m’ait souri. Dans ma tête d’enfant, je me forgeais des chimères. Il me semble qu’elle ne m’aimait pas. Etais-je injuste? Le suis-je encore? Je ne sais; pourtant bien souvent j’ai regardé des mères, alors qu’elles veillaient aux jeux de leurs enfants, et j’ai surpris sur leur physionomie des expressions de céleste bonté que je n’ai pas vues au front de ma mère.
L’impression–bien lointaine–qu’elle m’a laissée est celle de la richesse, de l’éclat. Le cadre qui l’entoure me paraît brillant; la maison est splendide. Je suis entouré de domestiques. Une vieille gouvernante, plus revêche que maternelle, est attachée à mon service.
Etait-ce à Paris? Je ne le crois pas, car–cherchant encore dans mon cerveau–je vois de grands bois, une rivière qui coule, de vastes chambres pareilles à celles d’un château.
Mais ce qui domine tous mes souvenirs, c’est la figure triste et douce de mon père. Oh! lui m’aimait; je le sais, je le sens au plus profond de mon âme.
J’avais–aussi loin que je me le rappelle–cinq ou six ans; voici quelle était ma plus grande joie. Etant presque toujours seul avec ma gouvernante, qui ne savait que raconter des histoires ridicules d’ogres et de vampires–folies qui ne m’amusaient point et m’effrayaient–j e voyais plusieurs fois par semaine arriver un homme de haute taille, vêtu de noir, à l’œil bon. Il me prenait par la main, me disant doucement: Viens avec moi!–et nous partions à travers la campagne. C’étaient de longues promenades qui pour moi ressemblaient à une évasion. Lui, mon père, me parlait affectueusement, sérieusement aussi; il cherchait à m’instruire et je cherchais à le comprendre. Etant très grand, il se courbait vers moi pour que je l’entendisse mieux.
J’avais parfois des colères, des impatiences de gamin.
Alors il me prenait dans ses bras, et, m’enlevant de terre, il approchait ses lèvres de mon oreille et répétait:
–Sois bon, mon Jacques, sois bon!
Et aujourd’hui encore, il me semble entendre cette voix à mon oreille, cette voix répétant les mêmes mots. Oui, je serai bon, je le veux.
… Je ne voyais que très rarement ma mère. J’ai dit qu’elle était très belle. J’étais peut-être mauvais juge de ce qu’on appelle la beauté; mais elle était surtout toujours très bien parée. Elle avait des colliers, des diamants, des robes dont la soie craquetante faisait–chose étrange!–une impression désagréable sur mes nerfs.
J’ai dit que je ne savais pas quelle était la position de mon père. Pourtant il me semblait qu’il devait être quelque chose comme un intendant d’une très grande famille. Mais laquelle? Jamais je ne voyais personne. Seulement une ou deux fois par an, la maison, le parc, les bois environnants s’emplissaient de bruit, de fanfares. C’étaient des chasses, des réceptions; relégué dans ma chambre, le front collé aux vitres, je regardais passer, courir à travers les allées, se perdre dans les sentiers du parc des cavaliers élégants, des dames somptueusement parées.
Au milieu d’elles, je vis ma mère.
Mon père, toujours attristé, restait seul et, me venant chercher, m’emmenait dans une direction opposée.
Il est une petite scène que je n’ai jamais bien comprise, mais qui m’a vivement frappé: Un jour que j’étais seul avec ma gouvernante, ma mère– vêtue avec plus de luxe encore qu’à l’ordinaire–entra brusquement. Comme je courais à elle pour l’embrasser, elle me repoussa brusquement; puis s’adressant à la servante:
–Aidez-moi vite, cria-t-elle, je ne veux pas qu’il voie cela.
Il? De qui parlait-elle? En même temps, elle arrachait des diamants de ses oreilles, des bracelets de ses bras. La vieille femme jetait tout dans un coffre. Mon père survint un instant après. Il jeta sur ma mère un long regard, sans lui parler. Puis il me prit par la main et nous sortîmes.
Et quand nous fûmes dehors, en pleine campagne, je vis qu’il pleurait. Oh! à grosses et chaudes larmes. Inconsciemment, presque sans savoir ce que je disais, je lui répétai les mots qu’il avait si souvent prononcés:
–Sois bon, père, sois bon!
Il me regarda, puis, comme à son insu, ces mots s’échappèrent de ses lèvres:
–Il y a des bontés qui sont des lâchetés!
Que signifiait tout cela? Ai-je bien le droit de chercher à comprendre?
Le matin, j’allais, conduit par ma gouvernante, donner à ma mère le bonjour filial. Je la trouvais dans un boudoir attenant à sa chambre à coucher. Elle était drapée de vêtements dont les teintes m’éblouissaient. J’allais à elle, les bras tendus. De la main, elle m’arrêtait, et je sentais sur mon front un baiser froid et rapide, tandis qu’elle me disait:
–Allez, maintenant, et amusez-vous.
… Ce qui est vraiment étrange, c’est que je n’ai jamais pu savoir où se trouvaient cette maison, ce parc, ces bois. J’étais si peu mêlé à la vie extérieure, que tout mon horizon se renfermait dans ma chambre ou dans quelques endroits où me menait mon père. Et d’ailleurs, quand arriva la catastrophe qui me sépara de lui, quel âge devais-je avoir? Sept ou huit ans. Il est évident que depuis ce temps-là on a épaissi volontairement le mystère autour de moi. Je ne me souviens de rien et n’ai rien découvert.
Que s’est-il passé?
… Voici le fait décisif qui clôt douloureusement la première période de mon existence:
Un matin-il faisait à peine jour–un personnage que je ne connaissais pas, mais que j’ai su depuis s’appeler M. Bonneville et être un vieil ami de mon père, qui lui portait une grande affection, entra dans ma chambre, et d’une voix brève, comme un homme qui donne des ordres indiscutables, invita ma gouvernante à me lever et m’habiller.
Il ajouta qu’il m’attendait pour «m’emmener en promenade.»
Certes, c’était là un fait inusité. Mais dans le moment, je n’y vis qu’une surprise agréable, tant j’aimais le grand air et la liberté.
Ma gouvernante avait l’air effaré.
–Mais, monsieur, disait-elle, il est si tôt. Il faut que l’enfant dorme. Vous allez me le rendre malade.
M. Bonneville répondit:
–Faites ce que je vous dis: Il le faut.
Il semblait lui-même tout bouleversé.
Je m’en souviens, on était en hiver. Il faisait froid, et pourtant il avait de grosses goultes de sueur qui mouillaient son front.
La gouvernante qui, à tout prendre, était peut-être une bonne femme, pleurait en m’habillant, car M: Bonneville lui avait dit quelques mots à voix basse. Elle avait tressailli et était devenue toute pâle.
Elle murmurait en m’apprêtant:
–Pauvre enfant! pauvre enfant!
Quelques instants après, je sortais de la chambre avec M. Bonneville. En traversant les longs corridors, j’entendais des voix qui se croisaient. J’eus le pressentiment d’un malheur, et me pressai contre celui qui me conduisait.
–Mon père? où est mon père? lui demandai-je.
Il ne répondit pas et hâta le pas.
Nous arrivâmes dans la grande cour. Là, il y avait une foule de monde. Quand j’apparus, des murmures s’élevèrent. Ils me paraissaient menaçants. Qu’avais-je pu faire cependant? M. Bonneville me souleva, me prit dans ses bras et m’emporta, fièrement, jetant autour de lui des regards de défi. Les rangs s’ouvrirent devant lui. On se tut. Nous passâmes.
Depuis ce moment-là, je ne me rappelle plus rien.
Une voiture nous emporte au galop d’un cheval. Puis nous arrivons à une station et nous montons en chemin de fer. Le soir nous arrivions à un port de mer. J’étais exténué de fatigue. Nous nous embarquâmes sur un grand bateau dont le mouvement me fit horriblement souffrir.
Nous allions en Angleterre. Là, M. Bonneville me confia à un pasteur protestant, dans une petite ville des environs de Manchester. Depuis, je ne l’ai plus revu. Le pasteur m’a dit qu’il était mort.
Quand je l’interrogeais sur mon père, sur le passé, il me répondait qu’il ne savait rien.
Hélas! l’enfance a de cruelles insouciances. Combien lui faut-il de temps pour oublier ceux-là mêmes qu’elle a le plus aimés! Au bout d’un an, tout ce qui avait fui derrière moi n’était plus qu’une sorte de vague brouillard sur lequel de temps à autre,–mais bien rarement–se détachait le triste visage de mon père.
Tout m’était distraction. J’apprenais beaucoup et vite. Je ne m’exprimais plus qu’en anglais. Et puis la passion artistique commençait à s’emparer de moi. J’étais dans un milieu de puritanisme qui me contrainait à me replier en moi-même: je devenais un contemplateur, une sorte de lakiste. J’avais toujours aimé le dessin, dont mon père m’avait donné les premiers éléments dans nos courses à travers les campagnes. La solitude et le travail me firent peintre.
A quinze ans, le pasteur m’annonçait que mon éducation était finie et que j’allais partir pour Paris. Il aj outait que j’allais être livré à moi-même et me gratifiait de ces conseils bibliques qui, pour s’appliquer à tout comme des formules toutes faites, ne sont que des passe-partout de morale banale.
Il me remit une assez forte somme d’argent. Et je partis.
Voilà six ans que je suis à Paris. J’ai travaillé, j’ai lutté, toujours seul.
Aujourd’hui, je suis pris d’une sorte de nostalgie filiale.
Je donnerais tout pour revoir mon père!…»
Ces quelques pages nous ont édifiés–autant que peut le faire le récit d’un homme qui s’ignore lui-même –sur le passé de Jacques.
Nous ne citerons plus qu’un seul feuillet de ce carnet.
Les lignes suivantes, écrites trois ans après, étaient tracées-d’une main fiévreuse:
«Suis-j e fou? suis-j e vivant? est-ce bien moi qui écris? Quelle transformation s’est subitement opérée en moi? Je voudrais m’interroger et je ne sais que me répondre!…
Et pourquoi donc me taire? Pourquoi n’être pas franc en face de moi-même?
Oui, j’aurai le courage décrire ce mot: j’aime! j’aime! de toute la force de mon âme, de toute la puissance de ma conscience… j’aime pour ma vie entière… j’aime! j’aime!…
Ah! que je sens de bonheur à tracer ces quelques lettres qui résument toute mon existence, tout mon avenir!…
Comment cela s’est-il fait?… Je ne le sais plus. J’étais allé à l’exposition du cercle des Arts, indolent, vaniteux peut-être, étant certain de mon succès. J’étais arrêté devant mon tableau–ma Cléopâtre;–déjà bien des mains s’étaient tendues vers moi. Un concert d’éloges avait résonné à mon oreille. On m’avait salué maître; et presque indifférent, je souriais. Quand soudain il se fit en moi une sorte de commotion. je me sentis pâlir, je chancelai. Pourquoi?. Je ne la voyais pas encore, et pourtant elle était là, à quelques pas de moi. Elle aussi regardait mon œuvre, elle aussi me regardait moi-même… et je tremblai comme un enfant…
C’était hier, et il me semble que je n’avais jamais vécu jusque-là!… Oui, je suis né sous son regard. Ma force s’est centuplée; je me suis senti véritablement homme, véritablement artiste. Elle m’a sacré.
Elle m’a parlé. Que m’a-t-elle dit?… Ce n’étaient pas des mots qu’elle prononçait, non pas de vains assemblages de syllabes comme on en entend aux lèvres des niais de la foule.… c’était une harmonie ravissante, entraînante, qui m’élevait au-dessus de la terre!.
Ah! stupidité du langage!… Que puis-je écrire? Où trouver des formules pour rendre ce qui gonfle mon cœur et affole mon cerveau?… Je voudrais dire comment elle est belle; je ne le puis pas. De quelle couleur sont ses yeux, de quelles nuances étincelle sa chevelure?… Non, je ne sais rien. Décrire, ce serait profaner. J’aime comme les chrétiens adorent, enveloppé tout entier dans un rayonnement qui me transporte.»
«Mercredi.
Je l’ai revue. Je sais son nom. Elle s’appelle Diane. Je ne pense plus, je ne travaille plus, je ne vis plus. je dis, je répète: «Diane!» et je suis heureux.»
Dimanche.
C’est fini, je suis à elle, sans oser rêver qu’elle soit à moi.
Elle est noble, riche… que m’importe! Esclave, je me donne sans réclamer le prix de mon servage. Pour un sourire, je mourrais. Pour un mot, je mourrais. Est-ce que ma vie est à moi, à présent!»
Pauvre niais!
Voilà quel était l’homme dont Diane d’Airvault venait de dire au palefrenier son père:
–Je le hais et je le méprise!…