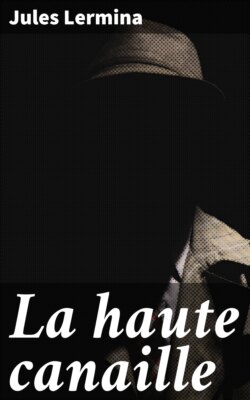Читать книгу La haute canaille - Jules Lermina - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
UN PÈRE A LA MODE. DE L’EMPIRE
ОглавлениеTable des matières
Donc l’homme, ayant frappé le chien, s’était rapidement éloigné de la Marne et avait rejoint la route qui monte aux hauteurs de Bellevue, au-dessus du Perreux. Vestiges d’un parc ancien et magnifique, des châteaux modernes, tout enverdoyés de superbes bouquets d’arbres, se dressent à une centainede mètres de la berge. Bellevue, le nom est juste. Jamais paysage plus gracieux ne s’est offert aux regards, alors qu’accoudé aux balustres de pierres et de briques, le propriétaire de ces villas contemple en face de lui la rivière se perdant à l’horizon entre des massifs noirâtres et au delà les côtes, opulentes de pâturage, qui forment frontière entre les deux départements de la Seine et de Seine-et-Oise.
Mais la nuit couvrait ces beautés; et, dans l’âme de l’assassin, il y avait des préoccupations qui augmentaient encore les ténèbres autour de lui.
Il allait, se hâtant.
Arrivé au sommet de la côte il s’arrêta et sembla hésiter un instant.
En face de lui se trouvait un mur élevé dont la ligne supérieure se détachait plus noire dans l’ombre qui l’enveloppait. Il mesura la hauteur du regard; puis il haussa les épaules.
–Bah! murmura-t-il, j’en ai fait bien d’autres.
Puis, il ajouta:
–Avant tout, soyons prudent!
Alors-il tira de sa poche une petite lanterne sourde et la posa auprès de lui. D’un étui de cuivre, il tira une allumette, l’enflamma en la frottant contre sa cuisse, puis l’approcha de la mèche. La lanterne s’éclaira.
S’agenouillant de façon à obstruer le rayon de lumière, il tira de sa ceinture le billet qu’il y avait glissé, le déplia et le lut encore une fois attentivement.
Un frisson parcourut tout son être:
–La malheureuse! fit-il d’une voix à peine perceptible, elle s’est perdue! Mais je suis là, moi! et je la sauverai. Mais comme je pourrais être surpris, prenons d’abord nos précautions pour que rien ne soit découvert.
Il roula soigneusement le papier de façon à ce que son volume fût considérablement réduit. Puis, avec une habileté qui dénotait de singulières habitudes de précautions, il le fixa dans ses, cheveux derrière son oreille.
Ceci fait, il eut un soupir de satisfaction; puis, de nouveau, il leva la tête vers la cime du mur, et fit un geste de résolution.
–Allons, dit-il.
Alors, on eût pu voir, dans la nuit, une ombre noire qui semblait ramper sur les pierres frustes. Comment cet homme pouvait-il gravir cette pente presque à pic? Où ses pieds trouvaient-ils un point d’appui? C’était miracle que de le voir s’élever peu à peu.
Quelques minutes à peine s’étaient écoulées lorsque sa main vigoureuse se posa sur le sommet de la terrasse.
Il s’arrêta et respira un instant. De larges gouttes mouillaient son front.
Devant lui, un parc s’étendait. Il ne voyait rien qu’une masse noire et interrompue d’arbres et de taillis.
Mais il n’avait pas accompli un tel effort pour s’arrêter. Quelques instants après, il se laissait tomber sur le sol.
Le heurt fut lourd et résonna fortement.
L’homme tressaillit et se blottit contre le tronc d’arbre, inquiet.
Mais autour de lui le silence continuait.
Seulement, à quelque distance, on entendait l’écho d’un instrument, légèrement touché, évidemment par une main féminine.
Si quelque observateur avait pu examiner en ce moment le visage de l’inconnu, il eût été surpris de voir ses traits durs, brutaux, s’éclairer d’un rayonnement indicible. On eût dit du bonheur, presque de l’amour.
S’écartant de l’arbre, il se mit à se glisser à travers la futaie, attentif, s’arrêtant dès qu’une souche craquait sous ses pieds. Et bientôt il se trouva à la lisière du petit bois.
Devant lui, s’élevait la maison d’habitation, villa plus massive qu’élégante, non point une de ces bâtisses bourgeoises, d’une élégance douteuse, que des entrepreneurs élèvent à la diable pour les revendre le plus tôt et le plus cher possible, mais une sorte de château carré, dont l’architecture s’était évidemment inspirée des modèles haussmanesques dont l’empire a couvert les quartiers nouveaux.
Un large perron, couvert d’une marquise, donnait accès à un vestibule éclairé par des lampes. On apercevait l’escalier spacieux, couvert d’un tapis et encadré de statues qui soutenaient des torchères.
Sur le sable, à la lueur jaune qui passait à travers la cage vitrée, on voyait les traces circulaires d’une voiture.
Dans le vestibule, auprès de la porte, un laquais –une sorte de suisse–aplatissant sa rotondité sur une chaise, dormait à demi.
Au rez-de-chaussée une seule fenêtre était éclairée:
–Ah! ils sont dans la bibliothèque, se dit l’inconnu. Comment parvenir jusque-là sans être vu!
Pendant qu’il réfléchit aux moyens de franchir le court espace qui le sépare de la maison, pénétrons à l’intérieur, dans cette pièce qu’il semblait connaître.
C’était en effet une sorte de boudoir-bibliothèque, d’une élégance toute moderne. Des sofas couverts d’une étoffe de soie bleue régnaient autour de la pièce, surmontés d’armoires vitrées, en bois de rose et garnies de volumes en chagrin blanc, à fers dorés. Une de ces bibliothèques dont les livres sont inamovibles.
Au milieu, un piano-orgue de grand format et dont la tablette supérieure était surchargée de statuettes et d’objets d’art.
Devant l’instrument, une jeune fille était assise, et laissait errer ses doigts sur les touches, tandis que son pied–petit comme celui d’un enfant,–pressait les pédales.
Elle était blonde. Ses cheveux, séparés au milieu du front, tombaient sur ses épaules en deux longues nattes, qui se recourbaient autour de sa taille. Eût-elle été debout, qu’elles eussent touché la terre.
Jamais peut-être l’exquise création de la Marguerite, d’Ary Scheffer, n’avait été plus adorablement réalisée. Le front blanc, bombé, un peu haut, s’éclairait de deux yeux d’un gris bleuté, d’une douceur, d’une langueur qui, en vérité, auraient pu paraître excessives, pour peu que l’on eût conçu le moindre doute sur la réalité de cette virginalité délicieuse.
Dans la souplesse du cou blanc, dans le sourire presque béat des lèvres rouges, un sceptique eût peut-être été tenté de chercher, sous la fraîcheur rosée de la jeune fille le masque de la comédienne.
Auprès de l’orgue, debout, était un homme, presque un vieillard.
Nous le caractériserons d’un mot: type Morny.
Une élégance de mise à la fois sobre et charmante. Le visage d’une teinte mate, les lèvres minces à l’éternel sourire, blotti sous des moustaches effilées en pointes pommadées, à la mode impériale. Cet homme était–avait été–ou aurait dû être préfet.
Sur son dos, le vêtement avait des allures de frac. A la boutonnière, un camélia blanc.
Evidemment, il venait de rentrer, car d’une de ses mains encore gantée de gris-perle, il tenait son claque fermé, tandis que l’autre jouait négligemment avec le gant dont il frappait le bois de l’instrument.
Cet homme pouvait avoir soixante ans; mais l’âge n’était trahi que par les rides multiples qui plissaient les paupières et les tempes. Les cheveux étaient encore noirs et les dents très blanches.
Seulement, c’étaient là secrets de valet de chambre.
M. le marquis d’Airvault–tel était le nom du personnage–était fort bien vu à la cour de Napoléon III, où il remplissait des fonctions intermédiaires entre celles de laquais et de conseiller intime.
Du reste, point de titre officiel.
Ses attributions étaient officieuses et délicates. On aurait pu le qualifier d’intendant des petits plaisirs de Sa Majesté.
Homme souple, précieux que le marquis d’Airvault, –qui ne dédaignait pas–en cas de besoin et pour satisfaire au caprice de son maître vénéré–de se prêter à des besognes qui d’ordinaire amènent de vieilles femmes sur les bancs de la police correctionnelle.
Mais,–comme il arrive très souvent,–M. d’Airvault était, en famille, d’une excessive rigidité. Il est vrai que la belle marquise d’Airvault, morte l’année précédente à la suite d’un refroidissement, résultat d’une exhibition trop décolletée à une séance de tableaux vivants de Compiègne, avait royalement marqué sa place parmi les belles des Tuileries; il est vrai encore que les familiers du palais–et quelques autres– lui avaient donné,–entre eux, bien entendu,–le surnom de Rose-Cuisse, qu’elle méritait, paraît-il, d’admirable façon; il est vrai encore que. etc.
Mais M. le marquis–dont ces incidents avaient quelque peu contribué à améliorer la position–affirmait qu’il n’avait jamais transigé avec les principes.
Propriété, religion, famille constituaient pour lui la trinité vénérée, le palladium, le tabernacle sacro-saint.
Il était sans pitié pour quiconque glissait sur la mauvaise pente; et il méprisait avec fracas celles-là mêmes qu’il y avait poussées, pour l’agrément de Sa Majesté.
Enfin, cet homme était sévère avec sa fille jusqu’à la dureté.
Méritait-elle d’être plainte? Nous le saurons bientôt.
Mais parfois il semblait que son père éprouvât pour elle une sorte de haine.
Petite, il l’avait battue. Plus grande, il l’avait brusquée, insultée.
Peut-être avait-il voulu lui inspirer le respect que, dans ces sortes de familles, les enfants refusent à leurs parents trop bien connus d’eux.
Le fait est que Diane d’Airvault le méprisait et le haïssait.
Du reste, tout cela doré des apparences d’une exquise distinction.
On se parlait avec une sorte de respect; on ne se tutoyait pas.
Donc, au moment où nous intervenons dans l’entretien engagé entre le père et la fille, voici quel était leur dialogue.
Le marquis est pâle. Sa voix tremble légèrement. Mais il sourit.
Diane semble perdue dans un rêve de pureté. Ses yeux sont plus languissants, tout son être a des ondulations plus angéliques que de coutume.
Le marquis parle:
–Mademoiselle, ces hésitations ne peuvent durer plus longtemps. Ce matin encore, le général F. m’a demandé silo mariage projeté s’accomplirait bientôt, et j’ai dû m’engager.
Diane joue doucement une romance de Gounod.
Les notes, finement liées font un accompagnement de harpe à sa réponse, modulée d’une voix mélodieuse:
–Je regrette, dit-elle, que d’aussi hauts personnages s’intéressent autant au sort d’une pauvre fille comme moi: je ne saurais cependant, pour leur complaire, enchaîner ma vie tout entière, sans avoir mûrement réfléchi.
–Je vous ferai observer que voici tantôt un an que je vous ai parlé de cette alliance et que vous avez eu tout le temps nécessaire pour formuler une réponse… Je vous ferai observer encore qu’il m’est pénible de jouer en ceci un rôle ridicule…
Ici Diane lève sur lui ses yeux bleus.
–Oui, ridicule, continua le marquis. Ne vous ai-je pas présenté celui que je vous destinais pour mari…
–M. le comte de Planay…
–Oui, Gontran de Planay, qui appartient à une des premières familles de France…
–Noblesse du premier empire…
–N’est-ce pas la meilleure? Quoi qu’il en soit, vous l’avez accueilli, vous ne l’avez pas rebuté. M. de Planay a été admis pendant quelques mois à vous faire sa cour.
–Vous ne supposiez pas, mon père, que j’eusse la pensée de me marier pendant que je portais le deuil de ma mère.
–Non, je le sais. Aussi ne vous pressé-je pas tout d’abord. Mais aujourd’hui ces motifs de retard n’existent plus. l’empereur a daigné me demander si vous ne paraîtriez pas bientôt aux fêtes des Tuileries…
–Ah! Sa Majesté! commence Diane sur un ton légèrement ironique.
–Sa Majesté me porte une grande bienveillance.
–Et puis, si je ne me trompe, ajoute la jeune fille en souriant et en regardant son père en face, Sa Majesté a reçu de vous mon portrait. et ne serait peut-être pas fâchée de voir l’original…
Le marquis se mord les lèvres.
–Enfin, me direz-vous du moins quelles sont vos objections?…
–A mon mariage avec M. de Planay? Mon Dieu! je n’en ai pas de fort sérieuses…
–Oh! un instant!… M. de Planay est, je le reconnais, un charmant cavalier, fort bien en cour, ayant mené largement la vie: son cheval a battu les anglais au grand prix… il a été l’amant de la petite Idalie des Bouffes…
–Ma fille!
–Ce n’est pas un reproche. cela pose un homme, et au moins on n’est pas la femme du premier venu… Mais, je vous demande pardon si je m’occupe de ces vétilles, il m’a été dit,–par qui? ma foi, je ne sais plus!–que M. de Planay était ruiné…
–C’est une calomnie. M. de Planay, pour soutenir dignement son rang, a pu entamer son capital… Mais, d’une part, je vous donne trois millions de dot. de plus Sa Majesté attachera immédiatement après son mariage M. de Planay au conseil d’État. sans parler de plusieurs faveurs qui rendront sa position des plus enviables…
–Et tout cela pour que j’aille à Compiègne redemander à Sa Majesté mon portrait! reprend Diane toujours souriante.
Cette fois, le coup a porté trop fort.
C’est que la fille et le père s’entendent fort bien.
Tout deux savent que ce mariage n’est qu’un marché. M. d’Airvault veut que sa fille soit mariée, parce que Pempereur le désire, le veut… M. de Planay est un de ces hommes qui ont bu toute honte jusqu’à l’ivresse.… M. d’Airvault a des rêves d’ambition, il veut une ambassade.
Diane sait tout cela…
–Ma fille, fait le marquis dont la voix vibre de colère, voici plusieurs fois que percent dans vos paroles des allusions que je ne puis ni ne veux permettre, surtout quand elles semblent attaquer et l’honneur de mon souverain et ma dignité de père…
A ce mot, Diane se lève et, haussant les épaules, se dirige vers la porte.
Mais déjà le marquis, livide de rage, s’est jeté au-devant d’elle:
–Prenez garde, lui dit-il. Ne me poussez pas à bout…
–Monsieur, réplique Diane, je ne suis pas une enfant, et vous pouvez vous dispenser de ces façons de pédagogue en colère… J’ai dit ce que j’ai voulu dire. Vous m’avez comprise, tout est au mieux. Je n’aime pas l’hypocrisie en famille. Vous avez besoin de moi comme marchepied à votre ambition. Je vous répondrai d’un mot. Ce rôle ne me répugne pas. J’ai aussi mes ambitions, moi. Je n’ai aucune raison de ne pas épouser M. de Planay. Celui-là ou un autre… Toutes vos marionnettes de cour se ressemblent. Seulement, j’entends agir à ma volonté, à mon heure… Donc, laissons là ces discussions inutiles et pénibles à tous égards… Elles ne pourraient que diminuer le respect que nous nous devons l’un à l’autre.
Elle a parlé d’un ton ferme. On devine en elle– sous cette enveloppe de vierge–une force de volonté qui étonne et effraie.
Le marquis a reculé, dompté. Sous ce proxénète, il y a un lâche.
–Du moins, balbutie-t-il, fixez un délai. Je vous en supplie. Il y va de… votre avenir…
Et après un silence, il ajoute:
–Et du mien!
–Enfin, dit Diane, voilà qui est franchement parler. J’aime mieux cela. Eh bien, monsieur, dans un mois vous aurez ma réponse.
–Dans un mois! J’ai votre parole?
–Oui!… Je vous la donne…
M. d’Airvault rayonne. Lui qui ne sait ce que c’est que de tenir une parole croit à celle de sa fille. Un mois! et alors il pourra solliciter un poste diplomatique… auprès du saint-siége! le rêve de toute sa vie…
–Merci! merci! dit-il avec effusion; et saisissant la main de sa fille, il y dépose un baiser.
Et, à reculons, avec les allures les plus correctement aristocratiques, il sort.
Diane reste seule; elle se tient d’abord debout, immobile.
Mais quel changement sur son visage! Les traits se sont contractés, durcis en quelque sorte. Les prunelles ont pris des teintes d’acier. Les lèvres serrées ont des duretés implacables.
Puis elle se plie, se laisse tomber sur un sofa, porte les mains à son front et murmure:
–Oui! ce mariage c’est le salut! c’est l’avenir! c’est la fortune éclatante et radieuse!… Mais. puis-je y songer!… Ah! misérable folle que je suis! et seule, je suis seule! Oh! qui donc me délivrera du passé?…
Alors une main touche légèrement l’épaule de la jeune fille…
Et une voix répond:
–Moi! je vous en délivrerai!