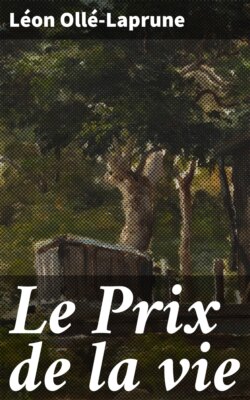Читать книгу Le Prix de la vie - Léon Ollé-Laprune - Страница 11
LES LOIS DE TOUTE VIE
ОглавлениеLe dilettantisme méconnaît les lois de toute vie, il rend le «vivre» impossible. Je ne parle pas en moraliste. Je prends la vie comme un fait, et je dis: Cette façon d’entendre la vie rend la vie impossible, parce qu’elle est en opposition avec les lois de toute vie.
Je suis encore au début de mon étude: je dois me tenir en garde contre toute généralisation hâtive. Mais je dois aussi user de mon esprit, et savoir faire des inductions que les faits autorisent.
Je considère d’abord la vie au sens physiologique du mot.
Il est certain que la vie est constituée chez les plantes par deux fonctions, la nutrition et la génération, et que, chez les animaux, ces deux fonctions se retrouvent avec autre chose en plus.
Ce qui caractérise d’abord la vie, c’est la nutrition.
L’être organisé vivant reçoit du dehors l’aliment. Il se l’assimile et le transforme, pour ainsi dire, en sa propre substance. Ainsi, il se conserve et il croît. Il se maintient dans l’existence et il s’augmente.
On nomme «intussusception» cette opération vitale par laquelle l’être vivant, ayant reçu l’aliment, se l’incorpore.
Je remarque que la vie, ainsi entretenue, se dépense sans cesse; mais que d’abord, pour cet entretien même, il faut dépenser.
La vie en allant acquiert sans cesse, vires acquirit eundo. Mais pour acquérir même, il faut dépenser.
L’aliment est cherché, puis appréhendé, puis absorbé.
Le chercher est déjà une dépense vitale. Dans le nouveau-né, il y a déjà des mouvements; et, dans le végétal, les radicelles vont au loin chercher l’aliment dont la plante a besoin.
Prendre l’aliment est une autre dépense vitale. Sucer, comme le fait le nouveau-né, c’est un effort.
S’assimiler l’aliment est encore une autre dépense de forces vitales. Les opérations de la digestion, multiples et compliquées, sont extrêmement actives.
Ainsi, la vie ne s’entretient pas sans dépense. Et la vie ainsi entretenue se dépense: elle n’est entretenue que pour être dépensée.
Il y a des moments de relâche. C’est nécessaire. Mais le repos continuel, ce serait la mort.
L’être vivant travaille, il emploie ses forces. Et plus la vie qu’il possède est riche, précise, haute, plus intense est le travail par lequel il la déploie. La vie de relation chez l’animal est un déploiement presque incessant d’activité sortant de l’être vivant pour se répandre au dehors.
La nutrition, qui se fait par le mouvement, aboutit elle-même au mouvement. Partout, à tous les degrés, sous toutes les formes, nous trouvons le mouvement, expression et effet de l’opération vitale, de l’activité vitale; et à la fin, nous apercevons le mouvement d’expansion, mouvement par lequel l’être s’espace, exspatiatur, va où il n’était pas, agit où il n’était pas, porte en dehors de soi sa vie propre par sa propre action. L’être vivant acquiert, mais il dépense; il prend en soi, mais il répand hors de soi; il fait entrer en soi, mais il sort de soi. Jamais il ne se borne, d’instinct, à acquérir, à accumuler, à emmagasiner, à épargner, à réserver. Il fait tout cela, mais pour user de ce qu’il acquiert et garde. D’instinct, il n’est pas avare. Et la jouissance purement stérile n’est pas, en fait, ce que d’instinct il cherche et se procure.
Mais voici quelque chose de plus.
L’être arrivé à son accomplissement et à une sorte de plénitude, produit.
La reproduction est comme la suite et le complément de la nutrition. Physiologiquement, nutrition et génération se tiennent: celle-ci continue celle-là. Considérons avec attention, avec admiration, avec respect, cette grande loi de la vie. L’être vivant reçoit, mais pour donner; il prend, mais pour rendre; et cela même, c’est la vie: la fécondité est un caractère essentiel de la vie.
Ainsi la vie s’entretient par une action qui est une dépense de force; elle ne s’entretient que pour se dépenser; et elle se reproduit: la vie est féconde, la vie engendre la vie, elle devient cause de vie pour autrui.
Nutrition, expansion, reproduction: partout l’activité ; nulle part l’inertie, nulle part la complète concentration en soi et pour soi, le pur ramassement, si je puis dire, le pur repliement sur soi et en soi.
Pourquoi ne serait-ce pas, exceptis excipiendis, la loi de toute vie? Nous trouverons, en considérant la vie ailleurs, bien des complications, et par suite il y aura lieu d’apporter à la loi des modifications et des restrictions. C’est à prévoir. Ne serait-il pas insensé, étant encore à ce début de nos recherches et ne considérant que les humbles commencements de la vie, de prétendre découvrir dès l’abord des lois qui se pussent appliquer à tout sans se modifier? La plus simple expérience nous apprend que les lois élémentaires ou fondamentales se modifient à mesure que l’on passe dans une sphère plus haute. C’est ainsi que je donne à la loi de la pesanteur une sorte de démenti quand je retiens l’objet que son poids entraînerait. Mais qui ne sait que la loi de la pesanteur demeure néanmoins dans son ample et fondamentale généralité ?
J’entrevois un lien d’analogie entre tous les êtres. Je ne suis pas en état de rien affirmer encore. Mais je me garde de m’interdire ces visées. Autant la méthode exige que l’on se retienne pour ne rien affirmer prématurément, autant il est bon de savoir regarder au loin et entrevoir les grands horizons. Pourquoi les lois fondamentales de la vie ne seraient-elles pas partout les mêmes? Pourquoi ne retrouverions-nous pas dans d’autres sphères, avec des modifications indispensables, ces termes qui nous frappent: acquérir, dépenser, entretenir, produire, engendrer? Et pourquoi n’y aurait-il pas lieu de dire partout que jouir n’est jamais que l’accompagnement?
Essayons une première vérification des lois entrevues. La vie intellectuelle est bien différente de la vie physiologique, et elle nous est familière. Étudions-la. Voyons comment procède l’intelligence.
C’est une nécessité pour elle de recevoir et d’acquérir. Il peut bien y avoir des théories ambitieuses qui attribuent à l’esprit humain une puissance quasi créatrice. Mais les faits nous montrent l’intelligence indispensablement assujettie à recevoir ce qui lui est donné. Les données de la connaissance peuvent être oubliées, méconnues: elles sont ce sans quoi rien, ne se ferait, ce sans quoi nous ne penserions pas, les unes étant les faits mêmes et les existences qu’il s’agit de percevoir et non d’inventer, les autres étant les principes essentiels du connaître et de l’être qu’il s’agit de dégager et, en ce sens, de découvrir, mais non de faire ni de créer.
L’intelligence est donc réceptive ou perceptive, c’est manifeste, mais non pas sans action propre: ce n’est pas moins manifeste. Peut-on se réduire à la pure mémoire conservant les acquisitions intellectuelles? Ce serait un danger d’y tendre ou d’y réussir en partie. C’est une impossibilité d’y réussir entièrement. Et, d’ailleurs, l’acquisition même est un travail, un effort, un acte. Tout en témoigne. La plus élémentaire perception enveloppe, implique quelque acte du sujet percevant. Une pure impression et réception toute passive ne serait, à aucun degré, une connaissance ni l’analogue de la connaissance.
Regardons maintenant l’intelligence riche de ses acquisitions et de ses labeurs. Pourra-t-elle jouir simplement de ce qu’elle aura acquis ou fait elle-même? Nullement. C’est une nécessité de se renouveler sans cesse. En vain a-t-on trouvé de ses idées des formules heureuses. On ne peut s’y complaire ni s’y reposer. Il faut sans cesse sortir de soi, sortir de ses propres pensées et des formes où l’on les a recueillies, sortir de tout ce qui est fait, car tout cela vieillit, et la stagnation est mortelle pour l’intelligence. Jamais le moment ne vient de s’enfermer une fois pour toutes dans ce qui est fait, pas même dans ce que l’on a fait soi-même. Il faut que la flamme de l’esprit soit toujours vive et agissante, et ravive et renouvelle tout. Il faut sans cesse agir, sans cesse travailler de l’esprit.
Et il faut sortir de soi pour aller à autrui. Toute pensée nette et forte tend à s’exprimer, et qu’est-ce que s’exprimer si ce n’est se répandre dans le sensible et comme l’intellectualiser? La pensée qui trouve dans le mot un corps, se communique en quelque sorte à cette chose matérielle et la remplit de soi, l’anime de sa vertu propre et l’élève à soi. Puis, c’est un besoin de la pensée de se communiquer à d’autres esprits. Quiconque a des idées un peu puissantes a l’ambition de les propager, et toute conviction sérieuse répugne à demeurer enfermée en elle-même; elle aspire, elle travaille à se faire partager: partage bienheureux qui ne la diminue pas, qui, tout au contraire, semble l’augmenter. C’est un rayonnement. Plus le foyer rayonne au loin, plus c’est le signe qu’il est ardent et puissant. La naturelle aspiration de l’intelligence et son triomphe, c’est de devenir pour d’autres intelligences lumière et force, cause de connaissance, cause d’intellection.
Considérons la science, qui est le produit brillant et solide de l’intelligence. Elle est soumise à ces mêmes lois de la vie. En un sens, elle n’est jamais achevée, et en elle il y a, à côté d’acquisitions et de possessions incontestées, un recommencement perpétuel. Si elle devenait stagnante, elle ne tarderait pas à périr. Avec cela, elle a une force d’expansion incessante. Celui qui sait a le désir d’engendrer, étant un homme qui sait, d’autres hommes qui sachent.
Nous retrouvons dans l’art véritable les mêmes lois encore. Il faut bien distinguer l’artiste du connaisseur et de l’amateur. Ce sont ceux-ci qui se bornent à contempler et à jouir. Ils sont stériles. Ils finissent par n’être plus que des collectionneurs, et pourvu qu’ils forment des espèces de nécropoles où les objets d’art, isolés de tout milieu vivant, se rangent pour s’offrir commodément aux regards curieux, ils sont contents. Mais bien différent est l’artiste. Déjà la vraie admiration des belles choses est vigoureuse et féconde. Elle ne fait pas de tout homme qui admire la beauté un créateur de beauté ; du moins elle suscite dans l’âme un désir d’agir harmonieusement, si je puis dire, une ambition généreuse de réaliser, en quelque manière, en soi et autour de soi, quelque idée noble. C’est que l’art, si l’on va au fond, est puissance et énergie. Il consiste, avant tout, à façonner, à former, à faire: il fait être ce qui n’était pas, il produit, il crée. Son nom qui nous vient du latin, ars, était primitivement synonyme d’activité. Et dans une langue bien différente, la langue allemande, c’est l’idée de pouvoir qu’éveille d’abord le terme par lequel on le désigne: Kunst ne vient-il pas de können? L’artiste est généreux et fécond. Il n’absorbe en soi tout ce qui lui vient de la nature, des autres hommes, du passé et du présent, que pour le rendre transformé par l’action de son génie. Il ne reçoit que pour donner. En lui apparaît, à un degré éminent, ce grand caractère de la vie: la générosité avec la fécondité.
Maintenant que nous avons constaté, dans l’ordre physiologique, les lois de la vie, et qu’ensuite nous en avons vu l’analogue ailleurs, dans l’intelligence, par exemple, dans la science, dans l’art, n’avons-nous pas le droit de considérer toute la vie humaine, et de dire qu’à n’examiner que le seul fait de vivre et ce qui est requis pour vivre, bon pour vivre, et enfin ce à quoi porte le seul instinct de vivre, sans faire intervenir encore aucune notion morale proprement dite, la vie humaine a pour loi élémentaire, ou mieux pour loi fondamentale, de ne pouvoir subsister ni dans la langueur et la stagnation, ni dans l’isolement et l’égoïsme.
Or, prendre la vie en pur connaisseur, en pur amateur, en dilettante, c’est précisément se condamner à la stagnation et à l’égoïsme; c’est donc se condamner à l’impuissance et à la stérilité ; et, par conséquent, c’est aller contre la loi même de toute vie.
On croit que cette contemplation intelligente, qui va jusqu’à nous identifier avec l’objet de notre contemplation, multiplie la vie. C’est une erreur. Cela tarit les sources de la vie. Parce qu’on n’agit plus, s’étant réduit à regarder et à jouir, on finit par ne vivre que peu, on finit par ne vivre plus. Parce qu’on est égoïste, s’étant réduit à soi et à sa propre jouissance, on vit de moins en moins, et finalement on cesse de vivre. L’instinct de sociabilité est bien autrement puissant qu’il ne le paraît d’abord. Nous n’avons pas seulement besoin du secours d’autrui pour nous soutenir dans la vie. Nous ne demandons pas seulement aux autres les ressources qui nous manquent. Bien plus profond encore, bien plus vital est l’instinct qui rend l’homme nécessaire à l’homme. Chacun a besoin de faire quelque chose pour autrui, d’être pour autrui cause de quelque bien, de quelque degré d’être, de quelque surplus d’être, si je puis dire, et sans cette générosité qui nous fait sortir de nous et donner de notre vie à d’autres que nous, nous ne sommes pas bien nous-mêmes: notre vie, qui ne se dépense pas, languit et s’use. Nous dépérissons pour avoir voulu enfouir en nous la vie comme un avare son trésor, tandis que c’est une source qui se renouvelle à condition de se répandre. Non, il n’y a pas d’individu qui n’ait rien à faire, en ce monde, rien à donner. Et proposer à l’humanité comme un bel idéal de faire comme un négociant qui se retire, sa fortune faite, et ne songe plus qu’à en jouir, c’est condamner l’humanité à languir et à descendre, degré par degré, vers la mort.
Il ne s’agit donc ici de proscrire ni le repos, ni le loisir, ni même le badinage; tout cela est utile à son heure, — mais il s’agit de dire qu’une conception de la vie qui la réduit à regarder et à jouir la compromet, la ruine, la tue, parce que cette conception méconnaît les lois fondamentales de toute vie. La vie se maintient par l’action et tend à l’action. Vigoureuse, puissante, elle est expansive et féconde. Le vivant semble tirer tout à soi; mais, quand il est bien soi, il sort de soi. Recevoir et donner, telle est la double loi de la vie. Pourquoi ne me servirais-je pas de ces mots simples, expressifs, dénués de toute prétention scientifique, mais si propres à rendre vivement ce que le sens et même la science des choses vivantes nous apprennent? Recevoir et donner; et j’entrevois qu’il vaut mieux donner que recevoir. Plus l’être est fortement organisé et vit d’une vie puissante, plus il donne. J’entrevois que le vivant qui serait tout par soi, ne recevant rien, aurait la vie pleine, la vie parfaite, et que, plus et mieux que tout autre être imparfait, il donnerait, tant il est vrai que donner est chose belle et excellente, et convenant à la vie! Mais n’anticipons pas. De ce que nous avons vu des lois de la vie, telles que la précédente étude nous les a montrées, bornons-nous à conclure pour le moment que nous ne pouvons pas admettre que la vie ne soit qu’un jeu ou un spectacle. Celui qui ne songerait, comme l’antique Narcisse, qu’à se mirer dans l’eau transparente des choses, comme Narcisse périrait; car, cessant d’agir, il devrait bientôt cesser de vivre. Les lois de la vie ne sont pas méconnues impunément.