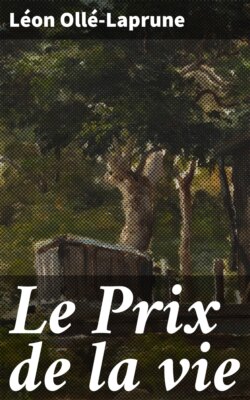Читать книгу Le Prix de la vie - Léon Ollé-Laprune - Страница 5
ОглавлениеLA QUESTION DE LA VIE
La vie, cette chose qui est en moi, qui est mienne, et qui de tant de manières m’échappe, puisque je n’en ai pas le secret et que je n’en suis ni le principe ni le maître: quel objet incessant de mes pensées, de mes désirs, de mes soins! Et, si je me mets à réfléchir, quelle énigme! Je porte sur la vie les jugements les plus divers, les plus contradictoires: je la juge bonne, et je la déclare mauvaise; je l’estime, et je la méprise; je tiens à la conserver comme une chose précieuse et chère entre toutes, et je la prodigue comme une chose vile. Tantôt il n’y a rien de plus grand ni de meilleur, tantôt rien de plus pauvre, de plus mesquin, rien de pire. Je m’en lasse et m’en dégoûte, je m’y attache et m’y complais. Au fond, c’est bien le mot qui résume toutes mes aspirations, toutes mes ambitions, toutes mes espérances, toutes mes joies; et si, par moments, il semble résumer toutes les peines, toutes les désespérances, toutes les déceptions, c’est que, dans cet espace de temps qui en est la mesure et que nous nommons lui-même la vie, des événements fâcheux et des circonstances contraires en ont empêché le déploiement libre: elle n’a pu s’épanouir, elle n’a pu être elle-même; et alors froissés, blessés, rabroués, si je puis dire, ce n’est pas de vivre que nous nous plaignons, c’est de ne pas vivre assez. Tant il est vrai que vivre est ce à quoi nous tenons par le fond de notre être! Ne hasardons ici aucune formule philosophique, ce serait prématuré ; mais enfin, être et tendre à persévérer dans l’être, n’est-ce pas tout un? et pour l’être vivant, quelle différence concevoir entre vivre et tenir à vivre?
Je tiens donc à vivre, j’aime à vivre, je veux vivre, et cela de toutes les façons. Je n’ai pas besoin, en effet, de réfléchir beaucoup pour m’apercevoir que la vie en moi est multiple, que les opérations vitales sont diverses, et bientôt je remarque qu’entre ces formes variées de vie que je trouve en moi il y a une liaison et aussi un ordre. Les unes m’apparaissent comme la condition et la base de tout le reste; les autres se montrent à moi comme plus belles et plus estimables que ce sans quoi, d’ailleurs, il semble qu’elles ne pourraient exister. A première vue la vie organique est le support de tout; mais la vie intellectuelle, la vie morale ont une valeur plus grande que ce qui les rend possibles, et si haute en est la dignité que, pour l’amour d’elles, on peut, que dis-je? l’on doit renoncer à la vie organique. Je veux vivre, et parfois pour vivre il faut mourir. Quelle étrange chose! Et comme toutes ces formes de la vie, enchevêtrées les unes dans les autres, rendent difficile de juger de la vie! Les formes nobles sont, en un sens très vrai, ce semble, dépendantes des formes inférieures. Ainsi le feuillage, la fleur et le fruit de l’arbre supposent les racines enfouies dans la terre. Et ces mêmes formes nobles apparaissent comme ayant une telle excellence qu’elles méritent que tout leur soit sacrifié : on dirait alors qu’elles subsistent par elles-mêmes: et pourtant, est-ce donc le moyen de conserver dans leur éclat le feuillage et la fleur, et de faire parvenir à sa maturité le fruit, que de couper l’arbre qui les porte?
La vie est bien ce que nous connaissons le mieux, et c’est, en même temps, ce qui nous est le plus inconnu. Nous n’en avons aucune idée nette. Dès que nous y arrêtons notre pensée, nous voyons que, sur cet objet si familier et si intime, la confusion est extrême. Nous ne savons qu’en penser, pensant d’elle tant de choses différentes et contraires. Si nous nous demandons ce que nous en pouvons faire, l’embarras est le même. Nous en voyons tant d’emplois différents, tant d’usages opposés! Et ainsi nous constatons que les premières réflexions sur la vie achèvent d’en brouiller le sens et nous exposent à l’impuissance d’en prendre la direction. Commençant à l’interroger, nous n’entendons plus du tout ce qu’elle est ni ce qu’elle vaut, ni ce qu’elle nous veut; nous ne savons plus comment l’orienter. Elle est devant nous à l’état de question: nous voudrions découvrir le mot de l’énigme, et nous n’y réussissons pas. Elle est devant nous à l’état de chose pratique, d’affaire à conduire, de bataille à engager: il nous faut un mot d’ordre, et nous ne savons où le trouver.
Le mieux serait-il donc de se laisser vivre sans y penser jamais? On aurait au moins pour aller et se mouvoir la nature, l’instinct, et aussi la coutume et la tradition. Si la réflexion empêche de vivre parce qu’elle embrouille les raisons de vivre et diminue les forces vives, il faut renoncer à réfléchir.
Non, il ne faut pas renoncer à réfléchir: il faut réfléchir davantage et mieux.
En toute matière, pour se faire des choses une idée nette et distincte, un effort est indispensable: effort d’attention, grâce auquel on écarte toutes les idées circonvoisines, accessoires, étrangères; une fois qu’on a dégagé ainsi d’un entourage trop touffu quelque point simple, la lumière se fait: on saisit nettement telle chose, on en a une notion distincte et exacte. Puis, grâce à un nouvel effort, on ouvre cet objet: après l’avoir distingué de tout le reste, on y distingue ce qu’il contient en soi; on y pénètre pour en visiter les replis, pour en scruter les détails, pour en apercevoir les appartenances, les suites, les dépendances, les replis obscurs; on en obtient ainsi une connaissance de plus en plus complète, de plus en plus profonde. Voilà comment l’on procède en tout ordre de choses: il s’agit, non pas de découvrir ce que personne n’aurait jamais soupçonné, de révéler ce que personne n’aurait jamais dit, mais de mettre à nu ces idées essentielles qui se laissent saisir par tous dès qu’elles sont débarrassées du reste, ces points simples sur lesquels tout le monde est d’accord, puis, par un second travail de la pensée, d’en développer le contenu; car si l’idée simple est claire, elle est riche aussi et féconde, et la déployer, la dérouler, faire voir les trésors qu’elle recèle,
... atria longa patescunt,
c’est la tâche et c’est la récompense de la pensée philosophique, attentive, réfléchie, docile à la leçon que lui donnent les faits et aux éternelles exigences de la saine raison.
Je veux savoir que penser de la vie et qu’en faire. Je commence par me recueillir. Je m’efforce de faire cesser ce tumulte incessant des événements, des choses et des hommes, autour de moi, des images, des mots et des arguments, au dedan de moi. Je veux user de mon esprit, voir par moi-même ce qu’il en est, prononcer avec connaissance de cause. Non que je prétende m’enfermer en moi-même pour tout tirer de moi. Je comprends trop l’absurdité et le danger qu’il y aurait pour moi à vouloir être ce que Leibniz appelle un solipse, à regarder comme non avenu ce que pensent les autres, à user de mon esprit comme si tout commençait à moi. Mais l’étude que j’entreprends demande que je me mette moi-même en face de mon objet et que je travaille à en juger à bon escient. Je m’engage donc dans cette étude avec une entière sincérité, résolu à tout faire pour bien voir, résolu aussi à ne jamais redouter la vérité connue: j’en veux embrasser par avance toutes les conséquences. Mon étude est toute spéculative; mais sans doute, en cette matière, les conséquences pratiques ne seront jamais loin. Si telle vérité a dans la pratique telle suite contraire aux passions humaines, ce ne sera jamais pour moi une raison d’hésiter devant la vérité, de la nier, même de l’atténuer. Il n’y a de sincérité complète, de sincérité véritable qu’à ce prix. Je veux être sincère de cette manière-là. Et maintenant je commence.