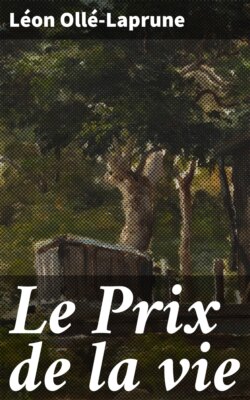Читать книгу Le Prix de la vie - Léon Ollé-Laprune - Страница 9
ОглавлениеLE SÉRIEUX DE LA VIE
Je veux faire œuvre de philosophe. Il faut donc que je fasse œuvre de raison, que j’emploie des procédés méthodiques pour arriver à un jugement sûr, que j’aie recours à la discussion. Discuter! c’est un bien gros mot et une bien lourde chose, quand il s’agit de certaines idées très légères, très délicates, ennemies de la consistance, toutes en nuances fines et en à peu près spécieux, comme celle que j’ai en vue en ce moment. Mais enfin cette réponse quelque peu fuyante à la question de la vie est susceptible de se fixer en une proposition qui est bien une thèse; et cette thèse, il faut la regarder en face, l’examiner, la discuter.
Si je me bornais ici à étudier des intérieurs d’âmes, à m’y intéresser, à m’en amuser, à les décrire de mon mieux, je ne procéderais pas en philosophe. Je parlerais du dilettantisme en dilettante. J’ai à voir si la solution qu’il propose est fondée.
Considérons la formule où semble s’exprimer le mieux cette conception: La vie est chose vaine, mauvaise peut-être. Qui sait? Mais qu’importe? Qu’est-ce autre chose, en effet, qu’un spectacle? Voir, comprendre, et jouir de voir et de comprendre, n’est-ce pas le tout de l’homme?
Ainsi la grande affaire de la vie, c’est de voir et de comprendre. Le reste va comme il peut. On en prend son parti, théoriquement. On ne s’attarde pas à se plaindre de la vanité de la vie. Pour qui sait traverser la vie en fin connaisseur, en amateur, en spectateur curieux et amusé, tout se vaut ou tout est sans valeur foncière; tout lui est égal, pourvu qu’il voie et jouisse de voir.
Qu’il y ait dans cette façon de prendre les choses un bel effort d’intelligence et de la délicatesse, et que ce soit faire honneur à la pensée de l’homme de prétendre que voir et comprendre procurent la seule jouissance qui fasse qu’il vaille la peine de vivre: je ne le nie pas.
Mais il faut procéder à un examen vraiment philosophique.
Cette conception de la vie reconnaît-elle ou méconnaît-elle les conditions de la vie? Voilà ce qu’il faut voir.
D’abord, ce qui nous est proposé là ne peut s’adresser qu’à une élite. C’est mauvais signe.
En un sens, quand on veut parler de l’homme et parler à l’homme, il faut considérer l’élite; en un autre sens, il ne le faut pas.
Pour juger de la vraie nature d’un être, il faut regarder cet être accompli, achevé, parfait, parvenu au terme que comporte et qu’appelle son essence. Parlant de l’homme, c’est dans ses échantillons les plus excellents qu’on doit le prendre; c’est de l’homme vraiment homme — et il est tel par la culture et la civilisation — qu’il s’agit, et c’est à l’homme vraiment homme que s’adresse le discours.
Mais si par l’élite on entend une portion de l’humanité placée dans des conditions très particulières de culture, si ce que l’on dit ne convient qu’à un petit nombre de gens fortunés et raffinés, cela m’inquiète. Cette vie proposée à nos regards et à nos souhaits, je n’ose dire à nos efforts, puisque nous considérons une conception où l’effort n’a guère de place, mais je dirai cette vie que l’on nous dit d’ambitionner et de nous ménager par nos soins, en arrangeant de notre mieux les circonstances, c’est un idéal. Or, ne faut-il pas que l’idéal humain soit accessible à tous, qu’une théorie de la vie humaine ou, si l’on aime mieux, une formule résumant la vie humaine, ne soit ni étroite, ni dédaigneuse, qu’elle soit susceptible d’être universalisée? Celle-ci ne s’ajuste qu’à une très petite partie de l’humanité, et l’on ne voit pas comment elle pourrait jamais s’appliquer à l’homme même.
Maintenant, laissons cette considération et, prenant la maxime en elle-même, voyons si là où elle est applicable elle tient compte, oui ou non, des conditions de la vie. J’entends ici ces conditions générales sans lesquelles la vie ne serait plus.
D’abord, la théorie en question oublie que pour tout homme, en quelque rang de la société qu’il soit, si fortuné et si cultivé qu’on le suppose, il y a des moments difficiles à traverser. Tout ne va pas tout seul. On rencontre des obstacles, on a affaire à des ennemis. Il faut se défendre, il faut lutter pour vivre. La lutte pour la vie, c’est une des conditions de la vie. J’emploie ici ces mots sans faire de système; je n’y vois que l’expression d’un fait, d’un fait certain: de toutes sortes de manières, il y a à lutter pour vivre. La théorie que nous examinons désarme l’homme. Ne lui parlant que de voir, de comprendre, de jouir, elle le laisse aux prises avec les difficultés de la vie sans l’y préparer. Cela est grave.
Il y a plus. La vie dût-elle être toujours facile et unie, cette formule serait encore défectueuse. Considérons l’homme même, elle le désagrège, si je puis dire, et le détruit de toutes les façons. L’état qu’elle préconise est un état morbide.
Je sais bien ce qu’on va me dire: Pour qui étudie les êtres en savant, il n’y a pas de maladie au sens vulgaire: il y a des états, et d’autres états, tous diversement mais également intéressants. Je ne m’arrêterai pas à discuter cette assertion. D’un certain point de vue a-t-elle quelque valeur? Au début de cette étude, nous ne sommes pas en mesure de prononcer. Mais, ce qui est visible dès maintenant et certain, c’est que chaque être a des conditions d’existence qu’il remplit ou ne remplit pas, qu’il y a des conditions nécessaires et suffisantes pour être, et puis, au delà du nécessaire et du suffisant strict, ce qui est requis pour être bien; et que cela peut se rencontrer réuni ou manquer plus ou moins.
Ce sont là des notions simples, saines, qu’il faut conserver. Je ne vois aucune raison pour m’en défaire; je ne trouve aucune théorie qui les démente manifestement et me force à les écarter.
Dès lors, vous reconnaîtrez l’état morbide à ce signe que l’être se détruit ou par défaut, ou par excès.
Si ce qui est strictement exigé pour être manque, l’être n’est plus, et à mesure que ce qu’il lui faut pour être lui est ôté, il se diminue lui-même et se détruit.
Si ce qui est requis pour l’excellence, si ce que l’être comporte, appelle, mais qui, lui manquant, ne l’empêche néanmoins pas d’être, ne lui est pas donné ou lui est ôté, il est dans un état de moindre perfection, il est privé de sa fleur de beauté. Ce n’est pas maladie ni pente vers la mort, mais c’est décadence pourtant s’il a connu l’état supérieur, c’est du moins infériorité, puisque c’est demeurer au-dessous de l’idéal de sa nature.
Si l’être sort de ses limites propres, s’il s’étend, se dilate, s’exalte outre mesure, à la façon de l’organe atteint d’hypertrophie, c’est manifestement un excès, et un excès qui rend l’être mauvais de bon qu’il était, c’est un excès morbide.
Le dilettantisme détruit l’homme. Il le rend malade, et par défaut, et par excès. Il lui ôte tout ressort et énerve en lui la volonté. Il produit une véritable atrophie. Il tend aussi à détruire ce que dans l’homme il exalte: la sensibilité, qu’il rend suraiguë, qu’il affine à l’excès, qu’il fausse, en sorte que le plaisir devient peine et la peine plaisir; l’intelligence, qu’il dissout par l’habitude de l’analyse à outrance, qu’il abîme dans les objets de son inerte contemplation, et qu’il finit par rendre incapable de saisir ces mêmes objets, la condamnant, par l’excès même d’une précision aiguë, au vague et à une confusion sans remède.
Voilà donc ce que fait de l’homme la. théorie que nous discutons. Elle méconnaît la condition humaine en oubliant la lutte pour la vie. Elle méconnaît la nature humaine, car elle contrarie la direction naturelle des facultés humaines; elle en trouble l’équilibre naturel; elle tend à les détruire toutes, par atrophie ou par hypertrophie. Elle fait d’un état morbide l’idéal humain, et, finalement, elle détruirait, si elle pouvait se réaliser entièrement dans les faits, la vie même qu’elle aspire à multiplier et à exalter.
Ne commençons-nous pas à voir que la première leçon que nous donne la vie interrogée sans parti pris, c’est qu’elle est chose sérieuse, et que pour vivre vraiment, il faut précisément prendre la vie au sérieux?