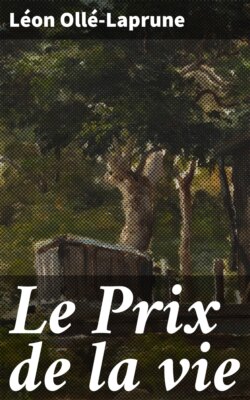Читать книгу Le Prix de la vie - Léon Ollé-Laprune - Страница 8
LES OPINIONS CONTEMPORAINES
ОглавлениеTrois puissances attirent tous les regards à l’heure qu’il est. Elles se disputent l’empire des âmes: chacune d’elles prétend nous fournir l’explication de la vie et en déterminer la direction; les trois ensemble forment un certain esprit d’où sort une conception assez nouvelle de la destinée humaine et de la conduite humaine. Ces trois puissances sont l’Art, la Science et la Critique. J’écris ici ces mots en lettres majuscules. Je suis un usage que je ne crois pas bon en général. Il me semble qu’ici c’est un moyen de marquer aux yeux pour ainsi dire que ces puissances exercent un grand empire sur les pensées et les actions des hommes.
Chacune d’elles implique une idée qui en est comme l’âme: cette idée, appliquée à la question de la vie, y devient principe d’explication et principe de direction.
Pour l’Art, au moins dans beaucoup d’esprits, l’idée maîtresse, ou principale, ou vitale, c’est l’idée d’une activité abondante, surabondante, qui se déploie librement, sans être assujettie à aucune nécessité, ni non plus à aucune obligation: activité qui se dépense comme en se jouant, sans autre raison que l’abondance même de la vie; en sorte que, par cette liberté même et cette fécondité, elle a dans son jeu ce charme souverain de ce que nous nommons grâce et beauté et elle produit sans but précis des œuvres superflues, inutiles, dont la valeur esthétique est la seule raison d’être.
Dans la Science, l’idée maîtresse est bien différente: c’est celle d’un enchaînement régulier d’antécédents et de conséquents, auquel on donne le nom de déterminisme scientifique.
Dans la Critique, l’idée maîtresse est à la fois semblable et différente: c’est l’idée dévolution, laquelle en effet semble impliquer le déterminisme, mais sans y être elle-même impliquée; car l’évolution est un développement à partir d’un germe, développement soumis apparemment à la loi du déterminisme; mais le déterminisme se conçoit en dehors de toute évolution proprement dite: une connexion ou suite régulièrement uniforme n’est pas nécessairement un développement à partir d’un germe.
Ces trois idées maîtresses produisent chacune une tendance à considérer la vie d’une façon particulière.
Ou la vie est elle-même une sorte de jeu; ou elle est un système déterminé à la façon de tout ensemble de faits physiques ou chimiques ou physiologiques; ou enfin elle est une évolution. L’expliquant par les principes mêmes de l’Art, ou de la Science, ou de la Critique, tantôt on n’y voit qu’un mouvement souple et varié, témoignage d’une activité très riche, très belle peut-être, mais sans but; tantôt on la considère comme une partie d’un tout bien lié ; tantôt on y reconnaît un moment d’une vaste et longue évolution.
Puis, mêlant ces diverses idées, on est porté à comparer la vie à un organisme qui a ses lois et aussi ses fantaisies explicables au fond par ces lois mêmes. Alors on parle de la vie sans introduire dans le discours aucune notion morale. Le devoir, la responsabilité, la loi morale et la liberté morale, tout cela a eu son heure dans l’évolution humaine; mais tout cela ne compte plus, tout cela est sans fondement, sans réalité. Pour l’organisme dont l’activité débordante se dépense en un jeu sans objet et par cela même charmant, pour l’organisme dont toutes les fonctions sont soumises à d’invariables lois, pour l’organisme enfin dont une évolution régulière explique la naissance, la croissance, le déclin et la mort, y a-t-il lieu de parler de liberté morale, de devoir, de responsabilité ?
Cependant il y a lieu de donner à la vie humaine une certaine direction: car il est manifeste qu’à certains égards on l’ordonne à son gré, soit qu’en ces desseins mêmes et en ces résolutions, on soit maître de soi ou mû par d’invisibles ressorts. On l’arrange donc ou avec des préoccupations esthétiques; ou avec des préoccupations scientifiques; ou avec des préoccupations critiques.
Dans le premier cas, on la considère moins de l’œil de l’artiste qui crée que de l’œil de l’amateur qui regarde: y voyant un jeu destiné à plaire, on tâche que le jeu soit aussi agréable, aussi intéressant que possible.
Dans le second cas, on tâche avant tout de la comprendre; mais quand les choses sont comprises, c’est-à-dire ramenées à des lois qui les expliquent, elles sont sous la main du savant qui les comprend; les lois claires sont aussi des lois fécondes; de l’explication lumineuse sort une impulsion puissante. Savoir, c’est pouvoir. La science est conquérante. De là, dans l’ordre des choses humaines, une tendance née de la science, née du déterminisme scientifique, tendance à refaire le monde, dans la mesure où il dépend de nous, selon les formules de la science même. La conception toute scientifique de la vie donne lieu ainsi à des projets de réforme humanitaire. Le rêve parfois est le fruit de la science positive. C’est elle surtout peut-être qui aujourd’hui engendre les utopies.
Envisage-t-on la vie avec des préoccupations critiques? On tâche de multiplier les occasions et les matières d’observation; puis l’on remarque que c’est comme multiplier la vie même; et pour cela on s’affranchit de tout ce qui resserre, limite, restreint l’activité. Le critique trouve que la joie de la vie, la raison de la vie, le but de la vie, c’est de tout voir, de tout pénétrer, de tout expliquer, de s’identifier avec tout, de vivre en tout et de tout, et, pour ainsi dire, de vivre soi-même toute vie.
Quel sera, dans chacune de ces régions, le mot d’ordre? Dans la région de l’Art ou plutôt de l’esthétique, le mot d’ordre sera: Jouis du jeu auquel tu assistes, et joue toi-même si tu peux, et jouis de ton propre jeu. L’important, c’est de s’assurer une bonne place au spectacle de la vie.
Dans la seconde région, le mot d’ordre sera: Comprends le mécanisme des choses, et fais toi-même ton rôle de rouage. Le tout est de comprendre. En comprenant, on prend sa part de puissance dans l’univers, on coopère à la marche de la machine totale. On est broyé, l’heure venue, par la nécessité : comme elle nous fait tout ce que nous sommes, elle nous défait. Mais le voir, le savoir, le comprendre est précisément toute la raison de vivre pour l’homme qui pense.
Dans la troisième région, le mot d’ordre sera: Jouis de tout et comprends tout, et par là étends, affranchis, dilate, accrois ta puissance de vivre; vis toutes sortes de vies; à force de comprendre et de jouir en comprenant, tu te multiplieras comme à l’infini, tu seras pour ainsi dire toutes choses, dominant tout, n’étant retenu par rien, détaché de tout, trop clairvoyant pour être dupe de rien comme pour rien dédaigner, demandant à l’intelligence une source inépuisable d’illusions scéniques que l’intelligence même donne sans cesse le moyen de dissiper. Ainsi accomplis en toi-même l’universelle évolution, et, si par hasard tu allais être fasciné par le spectacle, vite romps le charme par un sourire, libère-toi par l’ironie.
Ces formules résument l’usage de la vie tel que le souhaitent aujourd’hui beaucoup de gens instruits et cultivés. Et avec cela il y a dans l’atmosphère intellectuelle des courants étranges et d’ailleurs contraires. Un vent de pessimisme envahit les âmes, les abat, les dessèche. En même temps je ne sais quels souffles viennent des régions supérieures et y emportent les âmes. On songe à ce qu’on appelle si volontiers «l’au delà ». On déclare qu’on ne sait ce que c’est, qu’on n’en peut rien savoir. Mais quand la connaissance cesse, la croyance va encore, va toujours; et si croire n’est plus guère possible, on peut du moins rêver, et le rêve a ses espérances. Découragements amers ou attendris, désespérances raisonnées ou poétiques, ou bien croyances vagues et presque sans objet, rêves vains mais sublimes, espoirs sans fondement aucun pour la raison mais agréables et stimulants, l’Art s’enchante de tout cela, la Science le suggère presque ou du moins le tolère, et la Critique y trouve un nouveau sujet d’étude qui la captive et la charme.
Voici maintenant une autre réponse à l’énigme de la vie, un autre but proposé à l’humaine activité. J’entends retentir un grand mot bien vibrant, et il fait fortune: la Pitié ! Au nom de la Pitié, on nous prêche l’action, l’espérance, le courage. On condamne le dilettantisme et ses langueurs, le savoir sans entrailles, les projets inefficaces d’universelle réforme, les vaines discussions et querelles d’école, les négations procédant de l’analyse à outrance. On regarde, on touche, on panse de ses mains, on console avec son cœur l’humanité souffrante. On ne se borne pas à promettre aux hommes, comme dans les philosophies nées des sciences, une amélioration lointaine, ou à la préparer lentement par des moyens scientifiques; on y travaille tout de suite, et soi-même, et pour chacun, et l’on proclame que le beau de la vie, le tout de la vie, c’est de se dévouer pour les humbles, pour les petits, pour tous ceux qui souffrent; c’est de s’user, de se dépenser, de mourir s’il le faut, pour procurer leur soulagement par les œuvres qu’inspire une cordiale et efficace pitié.
Et pourtant, presque partout, règne ce que je pourrais nommer une grande désillusion morale. Même avec des sentiments nobles et une doctrine généreuse, on craint le plus souvent de donner aux termes qui désignent les choses morales leur sens plein, qui est aussi leur sens usuel et consacré. Le langage semble se vider, et c’est avec un scepticisme secret ou avec une hésitation venant de je ne sais quel respect humain que beaucoup de gens, et même ou surtout des philosophes prononcent les mots de devoir et de responsabilité.
Jamais peut-être la question de la vie n’a été l’objet d’une plus générale attention; jamais non plus les fondements de la morale n’ont été plus violemment secoués. Un regard jeté sur les catalogues de nos libraires suffirait pour en convaincre l’observateur le plus superficiel. La vie entre dans l’intitulé des livres les plus divers, et d’autres titres non moins significatifs déclarent, avec éclat, la crise de la morale. Kant, dont l’influence maîtresse dure encore, a enseigné la défiance à l’égard de toute réalité transcendante, et la confiance dans le seul absolu que sa critique de la connaissance épargnât, ou plutôt, peut-être, dans celui qu’elle avait pour but de mettre hors de pair, l’Impératif catégorigue, le Devoir. Or, cette confiance s’ébranle, et cet absolu tend à disparaître à son tour: beaucoup d’esprits, que les choses de la morale préoccupent, n’y veulent plus rien que de relatif, des faits, là comme ailleurs, et non des principes, des mœurs, mais plus de morale, ainsi que le disait Schérer, dès 1861, dans un article célèbre.
Une nouveauté très remarquable, la plus remarquable peut-être de ces derniers temps en philosophie, nous fait saisir, d’une manière vive et dans un fait visible, l’état des esprits et des âmes dans le monde qui pense ou qui fait profession de penser. C’est l’attention croissante donnée à Spinoza. Certes, la pensée de Taine, pour ne citer qu’un très grand nom, était spinoziste à bien des égards, et par là elle dépassait le positivisme où elle semblait se complaire: malgré une prédilection marquée pour l’expérience, malgré une estime singulière pour Condillac et une théorie des idées générales qui n’est guère qu’un condillacisme rajeuni, la philosophie de Taine est une métaphysique, et une métaphysique où est sensible l’inspiration de Spinoza. Aujourd’hui, le philosophe étudié par les jeunes avec le plus de faveur peut-être, c’est Spinoza, précisément; et l’on en aime tout, et notamment le mysticisme que Taine négligeait. Aussi bien ne se fait-on pas faute de l’interpréter avec toutes les idées et préoccupations contemporaines. Il semble les avoir si bien devancées! Et ne donne-t-il pas satisfaction aux aspirations les plus vives et les plus diverses de notre temps? On trouve chez lui le déterminisme scientifique exprimé avec une étrange énergie, poussé aux dernières limites; il est rationaliste; il est naturaliste, autant qu’on peut l’être; et, avec cela, on a pu dire de lui qu’il est ivre de Dieu. Ajoutons que le dessein de sa philosophie si hardiment, si hautainement spéculative, est d’ailleurs pratique: c’est la conduite de la vie qu’il a en vue, et sa métaphysique est exposée dans un ouvrage qu’il intitule l’Éthique. Mais c’est une morale où le devoir, la responsabilité, la distinction du bien et du mal n’ont pas de valeur. Avec lui donc on a comme une inoffensive revanche de l’intellectualisme , une revanche qui ne coûte rien aux plus chères ambitions du temps présent; et si la vie est pour le penseur l’intérêt suprême, c’est sans donner, d’ailleurs, à une raison pratique impérative une suprématie incommode. Vraiment, on dirait, à certains moments, que, dans ce siècle finissant, Spinoza va remplacer Kant comme maître des intelligences et de la vie.
Cependant la philosophie de la volonté issue de Kant tient bon encore. Et le fait important à noter ici où je me propose, non une revue des doctrines philosophiques, mais la constatation des courants ambiants et des influences dominantes, des plus nouvelles surtout, c’est la forme de plus en plus concrète du problème de la vie chez des penseurs qui, malgré leur aversion pour les doctrines intellectualistes, n’en étaient pas moins des intellectuels. Ainsi c’est bien tout le système des idées et des choses que prétendait embrasser M. Secrétan, à la suite et souvent à la façon de Schelling. Le titre de son grand ouvrage, paru en 1849, renouvelé en 1879, est significatif, c’est une philosophie de la liberté. Cette métaphysique, morale et religieuse, entre dans les profondeurs de la vie, cela va de soi. Néanmoins elle restait surtout une haute spéculation. La voici maintenant qui, de plus en plus, arrive à un détail vif et précis des questions présentes, pressantes, poignantes, et un récent ouvrage de M. Secrétan, la Civilisation et la Croyance, est le témoignage éclatant d’une préoccupation commune aux esprits dont il dit que «non moins dépouillés d’eux-mêmes que les plus purs amants de la vérité, ils s’attachent surtout à la vie». Une philosophie de la liberté encore, mais combien différente! celle de M. Renouvier nous offre une leçon analogue. L’auteur des Essais de Critique générale est sans doute de ceux dont les spéculations sévères, j’allais dire impitoyables, interdisent aux puissances étrangères, si je puis parler ainsi, toute ingérence dans le domaine de la pensée. Sa très remarquable théorie de la certitude, laquelle procède tout à la fois, selon lui, de la raison, du cœur et de la volonté , n’est-elle pas suivie de la théorie du «vertige mental» ? et «visant au rationnel», selon sa propre expression, ne poursuit-il pas avec acharnement tout «illuminisme», toute «mysticité » ? Or, dans un de ses derniers écrits, M. Renouvier nous dit: «L’évolution morale des esprits, que l’évolutionisme soi-disant scientifique n’a pas prévue, pourrait les ramener aux hypothèses de foi et d’espérance, condition nécessaire d’un véritable optimisme qui, en philosophie de même qu’en religion, doit prendre pour sujet, non le tout seulement, mais l’individu et, essentiellement, la personne, le salut de la personne .» Paroles très considérables, que l’importance constante de la personne et de la moralité aux yeux de M. Renouvier prépare sans doute et met en harmonie avec son système, mais où éclate néanmoins un souci de la vie bien moins sensible dans ses autres ouvrages, un souci de la vie assez grand pour émouvoir, en quelque sorte, ce rigoureux esprit et l’incliner, à cause du salut de la personne, vers des hypothèses de foi et d’espoir. Et il venait, dans les lignes immédiatement précédentes, de signaler, à propos du bouddhisme, comme ayant une heureuse signification, l’aveu — «la tradition chrétienne aidant, avec l’histoire de l’homme, — l’aveu du péché inhérent à l’esprit et à la chair de l’humanité.»
Les préoccupations, les déclarations proprement morales avec une certaine nuance religieuse persistent donc, malgré tout, non seulement chez ceux «qui ne font pas profession de philosophie et qui n’en traitent nulle part méthodiquement et en détail», mais chez des philosophes proprement dits, et à la tête particulièrement puissante.
Il reste pourtant un mot à dire au sujet de la vie, un mot que ne disent ni l’Art, ni la Science, ni la Critique, ni aucune philosophie en procédant ou les amalgamant, ni le positivisme, ni le pessimisme, ni ce néo-spinozisme que nous signalions tout à l’heure, ni même la philosophie de la souffrance humaine et de la pitié, ni enfin, malgré son austérité morale, le néo-criticisme. C’est un mot vieilli, démodé, suranné, malsonnant aux oreilles contemporaines. Quelques penseurs le prononcent encore. Il se perd la plupart du temps au milieu du bruit que font tant d’autres mots plus neufs ou paraissant l’être. C’est le mot de dépendance. Il y a des esprits qui estiment que la vie humaine ne se conçoit pas et qu’il n’y en a pas de direction possible si l’on n’admet pas la dépendance de l’homme à l’égard de la loi morale. Le néo-criticisme proclame la loi morale; mais, tout entêté de liberté, si je puis dire, il insiste volontiers sur l’autonomie de la loi morale, et, ne voulant rien d’absolu ni de transcendant, il ne la considère pas comme mettant l’homme dans la dépendance à l’égard de quelque chose de supérieur à lui. Pour les philosophes dont je parle en ce moment, c’est, au contraire, cette dépendance qui seule explique la vie, qui seule nous fournit un principe de direction.
Quelques-uns osent davantage: ils définissent, d’une manière plus précise et surtout plus concrète, la dépendance de l’homme, et ils disent que ce qui explique en définitive la vie et permet de la régler, c’est l’idée de la dépendance de l’homme à l’égard de Dieu.
M. Secrétan parle d’une «tâche proposée à la liberté», et il ajoute: «Il faut que la créature se fonde à la fois en elle-même et en Dieu, qu’elle se recueille en voulant Dieu, c’est-à-dire qu’elle se veuille pour Dieu, qu’elle aime Dieu .»
Un jeune philosophe, dans un très remarquable livre tout récent, écrit: «Au terme, vite atteint, de ce qui est fini, dès la première réflexion, nous voici donc en présence de ce que le phénomène et le néant recèlent et manifestent également, en face de qui l’on ne peut jamais parler de mémoire comme d’un étranger ou d’un absent, devant celui qu’en toutes les langues et en toutes les consciences il y a une parole et un sentiment pour reconnaître, Dieu.» Et plus loin nous lisons: «L’homme aspire à faire le dieu: être dieu sans Dieu et contre Dieu, être dieu par Dieu et avec Dieu, c’est le dilemme.» Et enfin: «Le devoir n’est le devoir que dans la mesure où, d’intention, l’on y obéit à un commandement divin.»
Il y a donc encore des philosophes pour parler de la dépendance de l’homme à l’égard de Dieu, et ce ne sont pas seulement des sortes de revenants, des hommes dont on pourrait dire qu’étant d’un autre temps, ils sont incapables d’avoir prise sur le nôtre. Ce sont de vigoureux esprits, des hommes auxquels les hautes ou profondes spéculations ne font pas peur, des hommes qui ont une influence, d’autres devant qui s’ouvre l’avenir.
Ce grand mot de dépendance à l’égard de Dieu, la Religion le prononce très haut, et avec un accent qui n’est qu’à elle. Aussi est-elle plus contrariante qu’une doctrine philosophique, et plus contrariée mais aussi plus pénétrante.
Elle proclame à haute voix que l’homme est une créature, donc qu’il est dépendant par essence: il dépend du Créateur, qui est aussi le Législateur et le Juge.
Voilà qui est net, décisif, et qui va à l’encontre de toutes les conceptions généralement en faveur aujourd’hui.
Cette idée de la dépendance de la créature à l’égard du Créateur, c’est le fond de l’Hébraïsme; c’est aussi le fond du Christianisme. Mais le Christianisme y ajoute une notion plus profonde du péché de la créature et une notion plus vivante de la bonté du Créateur. Le Christianisme, c’est la religion du Christ, et le Christ, c’est cette merveille, comme disait Descartes: l’Homme-Dieu! L’Homme-Dieu est le Réparateur, le Rédempteur, le Sauveur des hommes. La vie humaine apparaît dès lors comme dominée par l’obligation de la réparation, de l’expiation, du sacrifice: sans quoi on ne fait point son salut. La vie actuelle n’est plus que la préparation à une autre vie qui est la vie pleine, la vie glorifiée. L’au delà ici est précis: c’est le ciel, c’est la vie éternelle; et précise est la formule de la vie présente: Renonce à toi-même, perds ton âme et tu la sauveras, meurs et tu vivras.
Cette vieille doctrine est puissante. Elle se fait entendre de ceux mêmes qui lui refusent leur adhésion. Elle redevient neuve et jeune aux yeux de ceux que tant d’autres conceptions de la vie ont séduits et ensuite déçus. D’aucuns la trouvent si belle qu’ils la voudraient reprendre tout entière, mais sans les dogmes auxquels elle est liée; et ils rêvent d’un christianisme d’où le Christ serait absent pour ne rebuter personne, mais où son esprit demeurerait pour animer, pour diriger tous les hommes, et ceux-là même qui n’admettraient point les vérités chrétiennes et qui iraient jusqu’à douter de l’existence de Jésus-Christ!
Le renoncement, l’abnégation, la mortification, l’esprit de sacrifice, tout ce qui constitue l’ascétisme chrétien va au mépris de la vie présente; mais, comme d’une part cette vie prépare la vie éternelle, comme d’autre part l’homme ne peut mépriser l’homme fait à la ressemblance du Créateur, racheté par le sang du Christ et destiné au ciel, la conception chrétienne de la vie ne saurait être une conception paresseuse: tout en prêchant le mépris de la vie, le Christianisme prêche un emploi sérieux de la vie, et il exige, en particulier, la pratique de la charité, l’amour effectif du prochain pour l’amour de Dieu, le service des pauvres à l’imitation de Jésus-Christ, l’évangélisation des petits et des humbles à l’imitation encore du Sauveur, l’amoureuse et active pitié pour ceux qui souffrent, le travail en vue de soulager les misères humaines. Il prêche donc l’action. Et cette prédication plaît à beaucoup de nos contemporains.
J’ai regardé, j’ai écouté autour de moi. J’ai recueilli ce qui se dit de la vie. Je sais comment on la juge et ce qu’on conseille ou prescrit d’en faire. Les avis sont divers, contradictoires même. Les uns sont indifférents à tout, sauf à la jouissance que leur procure le spectacle des choses. Les autres veulent faire et font quelque chose; ils agissent et combattent. Mais, parmi ceux-ci encore, quelle diversité ! Il y en a qui attendent tout de la science, et ils ne travaillent que pour en préparer le triomphe complet et définitif. Il y en a qui attendent tout de la loi morale mieux pratiquée et de Dieu mieux connu et mieux servi, et tout leur effort tend à rétablir le règne du Bien, le règne de Dieu. Plusieurs terminent tout à l’homme, à l’homme souffrant, et la raison de vivre est pour eux de soulager la misère humaine. Toutes ces conceptions diverses, ces diverses formules se croisent, se heurtent, se mêlent. Et tantôt il semble que l’on crie: Vis, vis le plus que tu pourras; tantôt, au contraire: Meurs le plus que tu pourras, meurs en attendant de vivre dans une vie meilleure; ou encore: Meurs, parce que mourir en se dévouant, c’est vraiment vivre.
Je ne vais pas reprendre les unes après les autres toutes ces manières de répondre à la question de la vie. Ce n’est pas mon objet. Mais il était bon de les considérer; car, avant de m’engager dans une longue investigation sur la vie, il fallait voir ce qui occupe et préoccupe le plus les hommes dans le temps présent. Grâce à cette enquête, je ne risquerai pas de me perdre en des méditations solitaires, sans intérêt. En même temps j’aurai l’avantage de mieux saisir, dans le progrès de ma pensée, les secrets motifs qui me porteront de tel ou tel côté. Je retrouverai donc dans l’occasion ces idées contemporaines dont je viens de considérer le tumultueux et discordant ensemble. Ainsi renseigné par avance sur les divers mouvements d’opinion sur la vie à l’heure présente, je me mets à l’œuvre. La vie est-elle chose vaine, comme tant de gens le prétendent, ou est-elle sérieuse, comme mes premières réflexions me le donnaient à croire? C’est ce que je vais examiner.