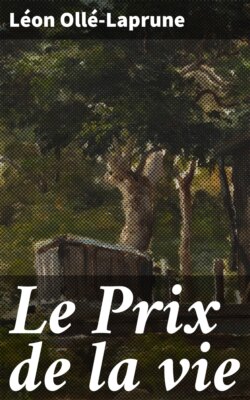Читать книгу Le Prix de la vie - Léon Ollé-Laprune - Страница 15
ОглавлениеLA VERTU PRATIQUE DE L’IDÉE DE L’HOMME
L’idée de l’homme ou de la nature humaine est ce qui justifie nos jugements sur l’homme et sur la vie. C’est aussi ce qui règle la conduite à tenir et dicte l’emploi à faire de la vie.
La nature d’un être vivant, c’est l’ensemble des caractères constitutifs de cet être, c’est aussi la loi de son développement et le principe même du mouvement propre par lequel il se développe. On peut donc considérer la nature d’un vivant soit d’un point de vue tout statique, et alors c’est la forme de son devenir, soit d’un point de vue dynamique, et alors c’est le principe interne de ce même devenir. Dans les deux cas, c’en est la loi.
Mais, comme dans un être quelconque il y a lieu de distinguer ce qu’il est, ce qu’il sera, ce qu’il peut être, ce qu’il faut qu’il soit, ce qu’il conviendrait qu’il fût, la nature de tout être enveloppe dans sa riche complexité et le fait présent et le fait futur, et les virtualités, et les conditions nécessaires d’existence, et enfin les convenances relatives à l’excellence et à la perfection. La nature, c’est tantôt ce qui est exprimé dans le fait actuel, natura ectypa, et tantôt ce qui semble régler le fait, natura archetypa. Là, c’est le fond d’où sort ce qui est, et le type semble se former d’après la réalité donnée; ici, c’est l’idéal auquel essaie de se conformer ce qui devient, et la réalité future ou commençant d’exister se modèle sur le type.
L’être vivant a une forme, celle de son espèce, εἰ̃δoς, qu’il tend et travaille à réaliser par une certaine force qui est en lui. C’est une idée, non pour lui, si nous entendons par là une représentation mentale, quelque chose dont il ait conscience, mais du moins pour nous qui la considérons. C’est l’εἶδoς au sens d’Aristote, εἶδoς non pas transcendant ni séparable, χωρɩστóν, mais εἶδoς τò ϰαὰ τòν λóγoν, expression de l’essence qui rend l’être concevable, expression de toutes les raisons d’être, et, par conséquent, de l’intelligibilité, ou de ce qui rend la chose saisissable à la pensée, à la raison de l’homme. Considérée hors de l’esprit qui la conçoit, et dans ce qui la fonde objectivement, cette idée est, dans l’être même, une sorte de raison immanente, de raison séminale, comme disaient les stoïciens, ou encore une idée dirigeante, une idée directrice, principale aliquid, τò ἡγεμoνɩϰóν présidant au développement de l’être, à l’évolution de la vie. Mais cette idée impliquant pour l’être la possibilité d’être lui-même pleinement et même de se dépasser par une sorte d’abondance et de surabondance, et comme par un excès qui soit excellence, ce n’est plus seulement une impulsion directrice qu’on y remarque, c’est une force propulsive: elle pousse, elle porte en avant, et fait aller toujours plus loin, toujours plus haut, si rien ne l’empêche.
Ainsi dans l’être humain la nature humaine, ainsi l’idée de l’homme. C’est l’idée de l’homme qui, en un sens, fait l’homme, c’est elle qui en chaque homme explique la marche en avant, et c’est elle qui, dans l’ensemble, explique, avec l’hérédité, le progrès de l’humanité.
Cette idée se trahit d’abord par des instincts. Avant d’être reconnue, elle pousse à l’action. Il y a des inclinations, des tendances, des appétits qui lui sont conformes. Naturelle est la tendance à persévérer dans son propre être, naturelle aussi la tendance à aller vers autrui. Naturelles de même sont les exigences de la bête humaine, et naturelles les aspirations de l’homme.
Puis la conscience vient, et enfin la réflexion. On essaie de fixer l’idée, de se représenter la forme de vie qu’elle demande. Alors il y a clairement et expressément, sous le regard de l’homme qui pense, la nature humaine en fait et la nature humaine en idée. Le fait est la réalisation telle quelle de l’idée. L’idée ramène à elle le fait.
Or, encore une fois, cette idée, ce n’est pas seulement l’ensemble des conditions d’existence de l’être, c’est ce qui est requis pour que cet être soit le plus possible et le mieux possible lui-même: c’est ce que son essence exige, et avec un surplus, une sorte d’excès, une perfection, une excellence que cette essence comporte ou appelle. Inconsciente, l’idée directrice, si rien ne l’empêche, pousse l’être à l’épanouissement, à l’éclat, si je puis dire, et au rayonnement. Consciente, elle garde ce caractère propulsif. C’est dire qu’elle est devenue un principe pratique.
Alors apparaît ce que l’on nomme convenance, dignité, beauté de la vie. Il y a une façon d’être qui est noble, qui est bienséante, qui a de la grandeur ou de la grâce, qui est belle. La conception d’une telle vie est attirante, engageante. Elle opère dans l’homme un mouvement d’un genre particulier: elle inspire l’envie de faire quelque chose de généreux, quelque chose de grand; elle invite à agir d’une façon qui lui soit conforme, et elle y aide déjà ; elle imprime à l’être un élan vers elle-même, et elle le dilate, elle lui communique une force expansive, une énergie conquérante pour régler d’après elle la conduite, l’action, la vie. En même temps, et par cela même, elle produit un mouvement de resserrement et de refoulement; car la beauté vue ou entrevue, pressentie, devinée, en attirant à soi, inspire le dégoût pour ce qui la détruirait. On ne peut voir ni même entrevoir la beauté de la vie sans se retenir, sans se contenir, pour arrêter ce qui lui serait contraire. Et ainsi cette idée de la convenance, de la dignité, de la beauté, exerce, par les attraits et les répugnances qui lui sont propres, une influence pratique.
Je ne crois pas en avoir fini avec l’étude de l’idée comme principe pratique. Je n’en suis bien plutôt qu’au commencement. Mais il est bon que je m’arrête ici, car avec ces premiers éléments, je vois se former toute une conception de la vie humaine que c’est le moment d’examiner à fond.