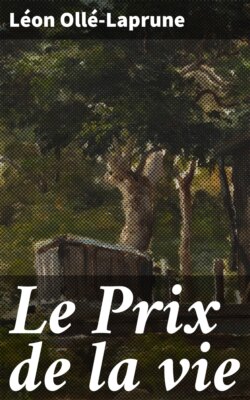Читать книгу Le Prix de la vie - Léon Ollé-Laprune - Страница 14
L’IDÉE DE L’HOMME
ОглавлениеToutes les vues que nous venons d’indiquer supposent des affirmations qu’il faut énoncer d’une manière explicite et examiner scrupuleusement.
L’homme vaut mieux que l’animal: première affirmation. Parmi les facultés humaines, il y en a qui valent mieux que les autres: seconde affirmation. Telle façon d’être homme vaut mieux que telle autre: troisième affirmation.
On prétend donc discerner ce qui convient à l’homme et ce qui ne convient pas; ce qui convient plus et ce qui convient moins; ce qui est digne de l’homme et ce qui ne l’est pas.
C’est donc qu’il y a une certaine idée de l’homme, de l’homme comme il faut qu’il soit, de l’homme complet et parfait, ou, si l’on veut, de l’homme le plus homme et le mieux homme.
C’est ce que je veux examiner maintenant, et examiner à fond.
Dire: ceci vaut mieux que cela, c’est porter un jugement qui peut impliquer bien des choses.
Ceci vaut mieux que cela: est-ce parce que ceci est plus. agréable pour moi que cela? ou est-ce parce que ceci m’est plus utile et plus avantageux? ou encore, est-ce parce que ceci m’apparaît comme plus consistant, mieux fait, plus apte à durer, à garder sa forme?
Si je compare une matière quelconque à une autre matière, une étoffe à une étoffe, un vêtement à un vêtement, un meuble à un meuble, je préférerai ceci à cela pour l’une des trois raisons que je viens de dire. Ce vêtement, par exemple, me plaît plus qu’un autre, sa couleur ou sa forme m’agrée davantage; ou bien je le trouve plus commode, plus chaud, plus facile à porter; ou encore je le juge plus résistant, plus solide, plus propre à durer sans se déformer, sans s’user.
Mais si, en disant qu’une chose vaut mieux qu’une autre, je compare des objets de nature différente, d’ordre différent, si je passe d’une classe à une autre, la comparaison n’est plus si aisée à expliquer et la préférence n’est plus toujours fondée sur l’agrément prévu, sur l’avantage espéré, sur l’aptitude propre des choses à demeurer dans l’existence ou à garder leur forme. Il y a des cas où dire: ceci vaut mieux que cela, a une autre signification encore et une autre portée.
Valoir mieux ne veut plus dire offrir plus d’agrément ni procurer plus d’utilité, ni même avoir en soi de quoi persister davantage dans son être et dans sa forme. C’est l’être même qui est jugé meilleur, c’est la forme aussi qui est jugée meilleure, et ce qui est mieux fait, ou ce qui est mieux, n’est plus seulement ce qui présente plus de garanties de durée et comme de constance avec soi-même et de conformité à sa propre nature ou essence; mais c’est cette nature, c’est cette essence qui est déclarée supérieure à une autre, et cela indépendamment de nous, sans relation avec notre plaisir ou notre avantage, indépendamment aussi de toute condition d’existence extérieure à elle, sans relation avec l’espace et avec le temps où elle est placée, mais en soi, parce qu’elle apparaît comme plus noble, comme plus excellente, selon la raison. Optabilius cum ratione, comme dit quelque part Leibniz. Si, nous qui regardons cette chose, nous nous y intéressons davantage, si nous nous y plaisons plus, si nous l’aimons mieux, si nous jugeons bon qu’elle soit et si nous voulons qu’elle soit, et cela plutôt qu’une autre en cas de conflit, c’est que, prononçant sur sa valeur avec notre raison, nous lui découvrons en effet une sorte de dignité : nous la déclarons donc souhaitable, plus souhaitable qu’une autre, mais par raison, à cause de ce qu’elle a en elle que la raison approuve. Optabilius cum ratione.
Lors donc que je dis que l’homme vaut mieux que le pur animal, et que vous le dites avec moi, car je ne vois personne qui, sérieusement et avec réflexion, osât dire le contraire, que voulons-nous dire? et pourquoi le disons-nous?
Une réponse se présente: L’homme vaut mieux que le pur animal, parce que l’homme pense.
Soit; mais entendons-nous. Il reste à savoir ce que nous prisons dans la pensée et pourquoi nous la prisons. La même question revient: est-ce l’agrément, est-ce l’utilité que nous cherchons dans la pensée? est-ce je ne sais quelle force, je ne sais quelle consistance et persistance que nous y admirons?
Si ce n’est que cela, qu’aurons-nous à répondre à ceux qui nous diront que la pensée est la source de beaucoup de maux? et à ceux qui nous diront que l’homme étant animal par un côté, ils s’en tiennent à ce côté de l’homme, y trouvant des jouissances, des satisfactions qui leur suffisent? Que répondrons-nous encore à ceux qui nous diront que, si la pensée doit à sa nature d’échapper à ce qui corrompt, ruine, détruit les choses matérielles, et paraît ainsi bien autrement apte à durer, et dure en effet à travers les siècles avec une persistance merveilleuse et un immortel éclat: néanmoins, cette consistance tout idéale n’empêche pas qu’elle ne soit chose ténue, délicate, fragile à bien des égards, et que l’on ne lui puisse préférer de plus épaisses et de plus grossières réalités, comme celles où l’animal semble trouver de quoi se satisfaire?
Otez à ces mots valoir mieux toute signification d’excellence, de noblesse, de dignité, on ne comprend plus rien à ce jugement qui paraît si simple et si certain: l’homme vaut mieux que l’animal parce que l’homme pense.
La pensée est le signe d’une vie plus haute, plus noble, ou la préférence qu’on lui accorde n’est pas justifiée. Assurément pour l’être plus noble, la meilleure jouissance et le suprême intérêt seront de vivre d’une façon noble. La vue de cette valeur supérieure ramènera donc la vue de l’agrément et celle de l’utilité, mais la noblesse de l’être une fois supposée, et seulement alors.
Si donc je sais que l’homme vaut mieux que l’animal, et si je sais ce qui vaut mieux pour l’homme, c’est que j’ai une certaine idée de l’homme ou de la nature humaine, à laquelle je compare tous les échantillons que je rencontre. Cette idée renferme ce que la nature humaine exige et ce qu’elle appelle, et par cela même en marque le rang parmi les êtres; l’excellence fonde la dignité, et dès lors, comparant l’homme à l’animal et l’homme à l’homme, je dis que l’homme vaut mieux que l’animal, et aussi que ceci convient à l’homme mieux que cela: deux jugements connexes qui ont dans cette idée de la nature humaine leur raison, leur fondement, leur justification.
Mais il importe d’approfondir ces affirmations et d’en mesurer la portée.
L’idée de l’homme, va-t-on me dire, est le produit de la culture, de la civilisation.
Assurément, répondrai-je. Je ne dis pas qu’elle soit toute faite, et qu’il n’y ait qu’à regarder en soi pour la trouver et qu’à être homme pour la voir en ce sens qu’elle serait en nous comme une étoile au firmament et que la formation en serait possible sans aucun travail de notre part.
Je dis simplement deux choses, et voici ces deux choses.
La première, c’est qu’en fait, au milieu dé toutes les variations tenant aux temps, aux lieux,, au degré de culture, quelques éléments se retrouvent partout et toujours.
La seconde, c’est que la faculté de se faire une. idée de la nature humaine est considérable et mérite une attention particulière.
Partout où il y a des hommes qui comptent, si peu qu’ils comptent, des jugements, des habitudes, des mœurs, des coutumes qui méritent de compter, si peu que ce soit, il y a, dans les esprits, d’une façon plus ou moins vague, et aussi plus ou moins vive, une certaine idée de l’homme le plus homme et le mieux homme, et cet homme idéal apparaît avec deux ou trois traits toujours et partout les mêmes, car ce qui s’en rapproche devient l’objet de l’admiration, de la vénération même, et quiconque aspire à primer tâche de les reproduire en soi autant que possible.
Que l’on considère des races où l’humanité ne semble qu’ébauchée, que l’on en examine d’autres où de pauvres restes et de lamentables débris seuls semblent subsister, s’il y a là quelque chose qui compte, l’homme vraiment homme, l’homme noble, c’est celui qui est fort et qui est généreux. L’homme fort, c’est celui qui peut et qui sait être soi, et partant se conserver, se garder, s’imposer même, qui, pour cela, use de ses forces physiques et aussi de son esprit (πoλυμη̃τɩς Oδυσσεύς), fécond en ressources de toutes sortes, et par là supérieur aux obstacles, capable de se libérer et de vivre respecté. Et en même temps l’homme généreux, c’est celui qui peut et qui sait sortir de soi, agissant pour sauver, pour protéger, pour venger les autres, se dévouant à un chef, à un dieu, se sacrifiant pour un peuple, sachant lutter, sachant souffrir, et, s’il le faut, mourir pour quelque cause étrangère à lui, supérieure à lui, et identifiée avec lui parce qu’elle est l’objet de son estime passionnée, de son amour ardent, de son culte.
Il serait curieux de rechercher et de suivre ces deux traits à travers l’histoire de l’humanité. On les verrait, avec toutes sortes de modifications et de nuances, tantôt grossiers et tantôt raffinés, tantôt presque effacés et tantôt éclatants, mais persistant toujours, dans l’homme sauvage, dans l’homme héroïque et presque fabuleux, dans l’homme des grandes époques historiques, dans le Sémite, dans le Grec, dans le Romain, dans le Barbare; on les retrouverait à l’époque des grandes invasions, au moyen âge, au temps de la Renaissance, au dix-septième siècle, avant, pendant et après la Révolution française. Si l’on avait le temps de faire des monographies, on montrerait ces traits dans le gentilhomme et dans l’homme de cour, comme dans le paysan et l’artisan. Le Christianisme les a profondément modifiés: il ne les a pas détruits. Les événements qui bouleversent le monde depuis cent ans, y ont introduit bien des changements: ils ne les ont pas supprimés.
Certes, voilà une persistance bien digne d’être remarquée. Elle témoigne de l’importance de ces traits.
Mais ce que je veux surtout considérer ici, c’est ce fait que l’homme à toutes les époques, sous toutes les latitudes, à tous les degrés de culture, se fait, dès qu’il compte, une certaine idée de la nature humaine.
Notons-le bien. Il ne s’agit pas ici de la notion-scientifique. Celle-ci est de formation tardive, puis elle est d’une remarquable inefficacité pratique, enfin elle est le résumé de l’expérience, ou, si l’on veut, l’extrait des faits donnés, et c’est précisément ce qui explique pourquoi elle ne se forme que tardivement et pourquoi elle est dépourvue d’efficacité. Savoir les caractères essentiels de l’homme, physiologiquement et psychologiquement, c’est l’ambition du savant. Mais pour vivre, l’homme n’attend pas d’avoir cette science de sa propre nature. Cette science ne vient que tard. Une fois faite, elle ne sert pas à grand’chose pour vivre. Elle résume, dans une formule exacte, les faits observés. Œuvre de raison, puisqu’elle substitue à la multiplicité des détails la généralité de la notion, elle a pourtant pour mesure l’expérience qui sert à la constituer, et, parce qu’elle ne dépasse pas les faits, elle est, par elle-même, sans vertu pratique. Dans le domaine de la nature, savoir c’est pouvoir. Dans le domaine pratique, cela n’est plus littéralement ni directement vrai. Les sources de l’action sont ailleurs.
Ce que je nomme l’idée de l’homme est chose bien différente de la notion scientifique. L’idée ici, c’est l’idée-type, ou encore l’idéal: comparée à la notion, elle est de formation antérieure; elle a une influence pratique; elle procède, elle aussi, de l’expérience, mais d’une certaine façon qui lui est propre, et elle dépasse l’expérience, elle va au delà des faits donnés.
Je ne fais pas de théorie, je constate simplement un fait. C’est un fait que l’idée de l’homme ou de la nature humaine est comme cela, est cela. Ce n’est pas seulement une formule contenant les caractères constitutifs de l’être humain. C’est l’expression, non pas précisément de ce que l’être est, ni même de ce qu’il faut qu’il soit pour être, mais de ce qu’il convient qu’il soit pour être largement et pleinement, et pour être bien.
La distinction entre ce qui est requis pour être et ce qui est requis pour être bien, est une distinction élémentaire que nous faisons sans cesse, à tout propos, en jugeant des produits de l’industrie humaine ou de l’art, en considérant les choses de la nature, les plantes, les animaux. Discerner un cheval des autres bêtes, et puis parler d’un beau ou d’un excellent cheval, c’est fort différent. Le cheval a tout ce qui lui est nécessaire pour être un cheval. C’est clair. Mais le beau ou l’excellent cheval a aussi ce sans quoi ce ne serait plus un cheval. C’est également clair. Seulement celui-ci a tout cela excellemment. Il est cheval, mais plus et mieux que d’autres, il est le plus cheval et le mieux cheval de tous. Si je dis qu’il l’est le plus possible et le mieux possible, l’idée ne sera plus seulement impliquée dans mon jugement, elle sera exprimée. Tout à l’heure, en énumérant les caractères qui font d’un cheval un cheval et en les enfermant dans une formule précise et exacte, j’énonçais la notion scientifique. Maintenant j’énonce l’idée ou l’idéal.
C’est la vérité que donne la notion. L’idée donne l’excellence. Entre la vérité et l’excellence il peut y avoir conflit, mais conflit apparent, non réel, conflit momentané, non durable. Développer trop dans un être tel caractère qui importe à sa beauté, c’est rendre cet être impossible; mais c’est du même coup en détruire la beauté, ou, ce qui revient au même, c’est substituer une beauté de convention, une beauté artificielle et fictive, à la beauté naturelle, à la beauté vraie. Du moins, cela prouve que l’idée n’attend pas, pour se former, la notion scientifique; et, si ensuite elle s’en aide avec raison, elle continue néanmoins à en demeurer distincte.
L’idée devine et met en relief ce qui est le plus propre caractère de l’être; et cela, non pas en supprimant le reste, mais en le subordonnant, comme il convient, à ce point principal, ou plutôt et mieux, en le pénétrant d’un souffle émané de ce point principal.
Voilà ce qu’est l’idée quand elle est saine et forte.
Et il se trouve que la vie à son tour, quand elle est saine, elle aussi, et forte, tend d’elle-même à réaliser ce qui, pour un esprit, serait son idée. La vie, en son développement, en son évolution, aspire à réaliser quelque chose de cette idée d’elle-même, de cet idéal d’elle-même, qu’elle est incapable de saisir par la réflexion.
Volontiers, je me servirais ici de l’admirable expression si connue de Claude Bernard, et je dirais que, dans tout être vivant, ce que je nomme l’idée est idée directrice de l’évolution vitale.
Homme, j’aspire à être homme, c’est ma loi. C’est un instinct.
Si je réfléchis, je me rends compte de mon aspiration. Je vois que je veux être homme le plus possible et le mieux possible, et cela, en étant, s’il le faut, autrement que je me vois et me sais être. L’idée de l’homme, de la nature humaine, de l’œuvre humaine n’est pas tout entière issue de l’expérience. Elle domine, elle dépasse l’expérience. Elle permet de juger des apports de l’expérience, elle les rectifie, elle les épure, elle y opère une sélection. Elle a donc en soi quelque chose par où elle la dépasse. Ou du moins elle suppose dans l’homme même une certaine faculté de concevoir toujours mieux que ce qu’il a, mieux que ce qu’il est. S’il peut augmenter ses qualités, les porter à un degré inconnu de perfection, c’est que rien de ce qu’il a et de ce qu’il est ne le contente; et si rien de ce qu’il est et de ce qu’il a ne le contente, c’est que rien de réel ne répond à cette excellence dont il n’a pas une idée arrêtée, mais que sans cesse il conçoit grandissante et propre à susciter de nouveaux efforts pour la réaliser .
Il y a donc au moins une vis ampliativa inexplicable par la seule expérience, même par l’expérience accumulée des siècles.
Si je ne craignais d’être mal compris, je dirais qu’il y a un certain platonisme indispensable, encore que souvent inaperçu, au fond de toute explication un peu pénétrante de la pensée ou de l’action. La vie humaine suppose une idée de l’homme, une idée de la nature humaine, sans laquelle on ne s’expliquerait ni les jugements les plus simples que nous portons sur la valeur de la vie, ni cette ambition qu’a tout homme qui compte d’être à sa manière le plus et le mieux homme qu’il peut. Et encore une fois je ne prétends encore faire aucune théorie, je ne rattache ces affirmations à aucun système. Je ne veux que constater des faits visibles et tâcher de les faire voir.