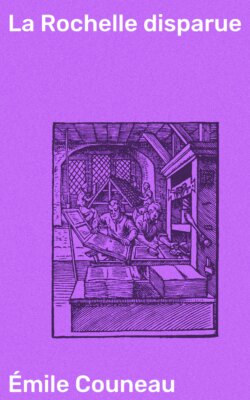Читать книгу La Rochelle disparue - Émile Couneau - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LES PORTES DE VILLE
ОглавлениеLa puissante enceinte qui enclosait la ville, et que nous avons essayé de décrire, était percée d’un certain nombre de portes qui contribuaient à son effet décoratif. La plus ancienne était établie entre deux lourds massifs carrés, formant avant-corps. Elle avait été construite en même temps que la première fortification de Guillaume X, en 1240. C’était la porte Mallevault, ou plus communément du Gros-Seing, ainsi nommée parce qu’à son sommet se trouvait le beffroi communal, dans une tourelle dont le faîtage, recouvert en plomb, surmontait la partie crénelée. Sur la plate-forme supérieure, se tenait le guetteur qui, de ce poste de vigie, donnait l’alarme en sonnant la cloche, signum, pour signaler l’approche de l’ennemi. On l’appelait aussi porte Mauléon, du nom d’un des descendants de la famille des seigneurs de Châtelaillon qui gouvernaient en ce temps le pays d’Aunis.
PORTE MALLEVAULT
«On peut juger — dit Masse — combien les arts estoient peu pratiqués en ce tems-là, comme le fait voir la simplicité de cette porte. Elle a vingt-sept pieds de longueur sur treize et demi de large et onze au milieu, où estoient les fermetures qui paroissoient être qu’avec des herses sarrazines. Les ponts-levis ne paroissoient point être en usage en ce tems».
La porte Mallevault conduisait à l’église Sainte-Marie-de-Cougnes (Notre-Dame), dont le faubourg n’était pas encore compris dans l’enceinte de la ville. Elle se trouvait dans la rue des Bouchers (Gambetta), à peu près au point où celle-ci rencontre aujourd’hui la rue des Cloutiers, du côté nord du marché actuel. Quand les fortifications englobèrent le faubourg de Cougnes et que le premier mur d’enceinte fut démoli, elle ne présentait plus d’intérêt pour la défense. Sa partie supérieure fut abattue, les plombs qui la recouvraient servirent à la toiture de la Grosse - Horloge. «Elle estoit bastie — ajoute Masse — presque toute de pierres de taille et les joints ou costés de la porte estoient anciennement tout massifs; l’on a vidé celui qui est à gauche en sortant, pour y pratiquer des boutiques et logements.» Masse nous a laissé le dessin de cette porte, du côté de la Grande-Boucherie, à l’époque où elle avait perdu sa physionomie primitive. Sa base massive subsistait encore et se trouvait enclavée au milieu des maisons de ce quartier. Ce dernier vestige de la première enceinte de la ville finit par disparaître, quand on construisit le marché aux comestibles.
La porte Rambaud, au nord du château, devait être placée à la jonction de la rue Rambaud et de la petite rue du même nom. Elle ouvrait sur le chenal de Parthenay et faisait partie, elle aussi, de la fortification du XIIe siècle. C’est par elle qu’on accédait l’ancien port et aux routes de Laleu et de Nieul.
A la tête du pont, jeté sur le canal de Parthenay, se trouvait le Châtelet, petite forteresse destinée à couvrir cette entrée de la ville. Cette construction remontait à l’époque où le roi d’Angleterre, qui possédait encore La Rochelle, redoutant les attaques de Louis VIII,. avait ordonné, par une charte du 4 décembre 1222, de fortifier le
«nouveau port, qui devait s’étendre depuis les moulins du Perrot, appartenant aux
«Templiers, jusqu’au Châtelet.»
La porte du Petit-Comte datait de la même époque. Elle existait avant la construction de l’église Saint-Barthélemy. Elle était à l’intersection de la rue Aufrédy et de la rue Saint-Côme. On la désigna plus tard sous le nom de porte Neuve, ou encore Voûte de Charité, parce qu’elle faisait partie des dépendances de l’hôpital de ce nom (Aufrédy)..
LA PORTE DU PETIT-COMTE
Lorsque Louis XIII, après s’être rendu maître de Saint-Jean d’Angély, en 1622, sembla prendre contre La Rochelle une attitude menaçante, les habitants reconnurent la nécessité de fortifier tout le front qui s’étendait de la porte des Deux-Moulins jusqu’au bastion de l’Evangile. Ils couvrirent la porte Neuve d’une demie-lune, qui porta le nom de Fort de l’Assemblée. «Cette porte, à la suite du don que Louis XIII en avait fait aux pères de la Charité, fut bâtie — au dire de Masse — en 1478, et fut couverte, en 1710, par les pères, qui firent au-dessus un logement pour leur infirmerie. Elle fut démolie partiellement, en 1689, pour être reportée plus en dehors. Elle était jolie; il y avait au-dessus le frontispice, un lion enchaîné, qui marquait la captivité de la ville.»
En 1801, le Conseil municipal la jugeant trop étroite pour la circulation, décida qu’elle, serait rasée complètement, ainsi qu’un petit magasin qui était à côté.
Il est question, dans la charte que nous relations plus haut, de deux moulins établis sur le cours d’eau de Parthenay par les Templiers, en avant du chenal de la Verdière. La porte de ville, qui fut construite à l’extrémité de la rue Saint-Jean, à peu près au point où cette rue fait jonction avec celles de la Monnaie et des Fagots, prit alors le nom de porte des Deux-Moulins. Bien que reportée depuis, au point où elle se trouve actuellement, elle n’en a pas moins conservé le même nom.
Les moulins des Templiers, placés à l’entrée du chenal de Lafond, furent une cause d’envasement et d’amoncellement de galets entravant la navigation. Quand le port actuel fut créé et que les bateaux n’eurent plus à remonter le chenal de Parthenay, rien ne s’opposa à ce qu’on jetât un pont sur ce cours d’eau. Un ouvrage de fortification fut alors établi, qu’on nomma le Beau-Fort, relié à un autre ouvrage en forme de tenailles, et donnant accès à la chaussée de la porte des Deux-Moulins qui, elle-même, rejoignait le chemin de Port-Neuf.
En dehors de la porte des Deux-Moulins, à l’endroit où plus tard furent plantées les allées du Mail, avaient lieu les fêtes du Carnaval. Le peuple se livrait à des distractions variées, notamment au jeu de la pelotte. Ceux qui s’étaient mariés dans l’année, devaient payer une contribution pour un magnifique festin et, en outre, trois balles ou pelottes pour le divertissement populaire. Le récit de ces jeux d’adresse et d’agilité se trouve longuement consigné au registre du gouverneur de l’année 1542.
Il est encore question de la porte des Deux-Moulins, lors du passage de François Ier à La Rochelle. Le roi parcourut à pied une partie des murailles, depuis la tour de la Chaîne jusqu’à la tour du Garrot (la Lanterne), «passa plus outre et vint à la porte des Moulins, par devant laquelle est un boulevard merveilleusement fort, qui deffend ceste côte de mer.»
En 1622, cette porte fut pourvue d’un ouvrage à cornes, et au-delà de son fossé on y établit cinq redans, simplement gazonnés, mais fortement fraisés et palissadés. Pendant le siège de 1628, tous ces ouvrages de défense eurent particulièrement à souffrir des batteries du fort Louis.
De toutes les portes de ville, celle de Cougnes fut la plus importante et la plus célèbre.
Lorsque la fortification de Guillaume X devint insuffisante et qu’il y eut nécessité d’enclore le faubourg de Cougnes dans une nouvelle enceinte, une porte, à laquelle venaient aboutir les routes de Périgny et de Dompierre, fut établie au pied de l’église Notre-Dame.
Sa construction primitive remonte à une époque difficile à préciser. Masse la croit bâtie en 1412. Elle était composée de deux fortes tours rondes et pleines; sa plateforme était couronnée de mâchicoulis et de créneaux, auxquels on avait accès par l’ouvrage de défense adossé au chevet de l’église.
VUE CAVALIÈRE DE LA PORTE DE COUGNES
Longtemps la porte de Cougnes fit simplement partie de la fortification, sans ouvrage avancé pour la protéger. Mais le roi, qui ne pouvait soupçonner la résistance que La Rochelle devait, un jour, opposer à ses armées, prit l’initiative de faire fortifier la ville en 1558. Il envoya — dit Baudouin — trois seigneurs de la cour, accompagnés d’un ingénieur italien «lesquels, après avoir visité les endroitz les plus foybles, commencèrent avec grand nombre de manouvriez, à faire dresser hors l’enclos de la dite ville et près des douhes d’icelle. troys grands ballovardz de terre, l’ung au cymetière de Cougnes.....» Un fort bastion fut donc établi en avant de la porte, dans lequel furent pratiquées deux nouvelles percées, qu’il fallait franchir avant de pénétrer dans la ville. «On dressa — dit un vieux document de l’époque — à gauche de la porte, un haut éperon, revêtu de grosses pierres de taille, si grand et si avancé de ses murailles, que les courtines en sont aisément défendues: bon de fossez, du reste, et bien assuré de son rempart, qu’on luy a fasciné au derrière, pour son artillerie & autres commoditez, avec la sentinelle dressée sur le fin bout pour descouvrir en tous endroits. Au reste, ces trois portes se suivaient de droit fil l’une l’autre; mais pour ce que l’expérience a découvert le danger de telles portes, mesmement es retraites passées, on changea la première et la mit-on, pour rentrer dans la ville, tirant sur main droite.»
ARMOIRIES SUR LA PORTE DE COUGNES
Tout en conservant sa masse imposante, la porte de Cougnes fut soumise à certains embellissements. Mervault signale que le maire Guillaume Gendrault fit graver au milieu les armes de France, avec l’inscription suivante: Le bon Roy entretiendra son peuple en paix, exprimant ainsi l’espoir que le roi ne porterait jamais atteinte aux privilèges de la ville. Pour rendre hommage aux défenseurs de ces murailles, qui résistèrent aux attaques du duc d’Anjou, un second écusson, aux armes de la ville, portait cette devise: Dieu m’a béni pour la retraite des siens. Enfin, le maire y avait fait figurer ses armoiries, formées d’un chevron surmonté d’un vol, avec un croissant en pointe, le tout entouré de l’inscription suivante: La crainte du seigneur est d’air le mal. L’ingénieur Masse, qui nous a fort heureusement conservé ces différents écussons que nous avons pu reproduire, dit que ces inscriptions furent mises après que les Rochelais eurent pris le parti des protestants, en 1576.
ARMOIRIES SUR LA PORTE DE COUGNES
ARMOIRIES SUR LA PORTE DE COUGNES
Avec le perfectionnement apporté à l’artillerie, l’art des sièges subit une transformation toute nouvelle. Les vieilles murailles du moyen-âge, toutes droites, flanquées de tours, qui avaient résisté aux armées royales, devenaient désormais insuffisantes. L’augmentation du périmètre des fortifications rendait également inutiles les ouvrages avancés de la porte de Cougnes. Les deux portes extérieures furent donc supprimées; et, en 1613, une seconde porte, dont l’axe était dirigé vers le nord, fut établie tout prés de la première.
LA PORTE DE COUGNES, A LA FIN DU XVIIe SIÈCLE. (D’APRÈS MASSE)
Cette construction monumentale, située à l’entrée de la rue Porte-Murée était fort remarquable. «C’était — dit Masse — un des beaux édifices qui fut à La Rochelle. La façade du costé de la campagne estoit fort magnifique, décorée de pilastres et de colonnes et d’une bonne architecture. Sa façade, du costé de la ville, n’estoit guère moins belle: il y avait deux ordres d’architecture l’une sur l’autre et l’intérieur de ces deux portes estoit vuide; elle estoit revestue de pierres de taille et terminée par un chemin de ronde et les corps de garde au-dessus; elle fut en partie démolie en 1689, pour avoir les matériaux, à cause que l’on estoit fort pressé de mettre la place en estat de deffense, que l’on n’avoit pas le teins d’aller chercher des pierres à la rivière de Charente, ce qui obligea d’abattre divers morceaux des anciennes fortifications qui estoient restées.»
Masse a dessiné la vieille porte de Cougnes, telle qu’elle existait à la fin du XVIIe siècle; une des robustes tours, qui en défendait l’entrée, subsistait encore; l’autre. était déjà noyée dans les constructions qui l’enserrent encore à l’heure actuelle. Sur cette dernière, a été bâti depuis, le nouveau clocher de l’église Notre-Dame.
Dans le front nord se trouvait la porte des Lapins, qui n’était — dit Masse — qu’une petite murette, où il y avait une simple barrière, de même qu’au bout de toutes les rues qui sortaient sur la campagne, pour la conservation des droits d’entrée des fermes du roi.
Le quartier Saint-Nicolas fut le dernier qui fut pourvu de fortifications. La partie est, comme nous l’avons dit, était entourée de murailles flanquées de tours crénelées. «Les maires et les échevins — suivant le chroniqueur Baudouin — commencèrent, en 1505, à renclore le faubourg Saint-Nicolas, du côté de la Moulinette, et à y faire des tours et mâchicoulis depuis la porte Maubec tirant vers Saint-Nicolas.» Cette lignée de murailles suivait à peu près la direction de la rue Sardinerie actuelle. Le bastion du Gabut n’était pas encore construit, si bien que la mer pénétrait jusque sur la Petite-Rive, laissant à découvert, à marée basse, une large surface de vase.
On se contenta donc, à ce moment-là, d’élever un mur partant du pont Saint-Sauveur, dans la direction des maisons qui bordent actuellement le bassin intérieur et allant faire jonction avec la porte Saint-Nicolas. La muraille a disparu; il n’en reste que la tour d’angle, prés de l’écluse Maubec et la porte de Cunarre, ouvrant sur la petite rue qui porte ce nom, et que le peuple a trouvé plus simple d’appeler: rue des Canards.
La large ouverture existant entre la porte et la tour Saint-Nicolas, par laquelle l’ennemi pouvait avoir un accès facile, présentait un réel danger. Le pouvoir royal voyait avec inquiétude le pro-grés que faisait le parti protestant et les Rochelais, redoutant l’intervention des troupes étrangères, songèrent à compléter l’enceinte de leurs murailles du côté de la mer. En 1568, ils constituèrent avec une activité surprenante, de la porte Saint-Nicolas à la grosse tour de l’entrée du port, une forte muraille épaulée par des tours de distance en distance. Plus tard, une de ces tours dut servir pour y établir l’ouvrage de défense que nous avons connu sous le nom de: bastion du Gabut.
VUE CAVALIÈRE DE LA PORTE SAINT-NICOLAS
Les pierres employées pour l’établissement de cet important ouvrage provenaient en partie de la démolition de l’ancien château. Pour les amener à pied d’œuvre, il fallut les transporter par le pont Maubec; c’est de là qu’est venu le dicton populaire: «Le chastel Vauclair a passé par le pont Mauclerc.»
En 1596, pour assurer plus facilement la sécurité de cette nouvelle construction, les Rochelais la firent «terrasser tout le long de la courtine, depuis la tour Saint-Nicolas jusqu’à la porte de Vérité.»
Le bastion du Gabut fut démoli en 1858 et le terrain fut nivelé entre le bassin intérieur et le bassin neuf. La petite portion qui subsiste encore n’a pu disparaître, par suite d’un droit de servitude établi au profit des habitations qui y sont adossées. On retrouve encore quelques-unes de ces casemates, qui servent de caves pratiquées sous l’ancien chemin de ronde de la fortification.
La porte de Vérité, qui attenait au bastion du Gabut, donnait sur la Petite-Rive. Elle avait la même disposition que les autres portes de ville; deux tours crénelées en défendaient l’entrée; on en retrouva les fondations lors de la démolition du Gabut. C’est probablement cette porte que Bournaud a reproduite, sans indication de titre] qui permette de la reconnaître. En 1622, quand on voulut prolonger la terrasse jusqu’au fort Saint-Nicolas, il fallut déplacer cette porte et la transférer en arriére, à l’endroit où se trouve actuellement l’entrée de la rue de la Fabrique.
LE BASTION DU GABUT
De la Tour Saint-Nicolas à la Porte de Vérité
Elevé en 1568.
Imp L Font. Paris.
La porte Saint-Nicolas était, elle aussi, une entrée de ville fort importante. Elle était pourvue d’ouvrages de défense qui en assuraient la sécurité. De chaque côté, se trouvaient deux fortes tours avec fossé, herse et pont-levis, et, en avant, un bastion sur lequel étaient placées des pièces d’artillerie. Pour sortir de la ville, après avoir passé sous la première voûte, il fallait traverser une seconde porte, à l’est de la fortification, puis franchir une troisième issue du côté opposé ; alors on trouvait un talus, battu par la mer, sur lequel était établie la route qui menait à Tasdon. Cette disposition est à peu près restée la même, mais tous les terrains où se trouvent la gare et ses dépendances ont fait l’objet d’une emprise sur la côte.
ANCIENNE PORTE SAINT-NICOLAS
Masse rapporte: «que la troisième porte Saint-Nicolas, qui fut abattue en 1689 pour avoir des matériaux, était fort jolie, dressée d’architecture. Elle avoit été bastie en 1589.»
Dans une quatrième porte, également démolie, se trouvait une tourelle où était établi le bureau des fermes du roi.
Le bastion Saint-Nicolas, refait d’après le système en usage sous Louis XIV, a conservé à peu près la forme de l’ancien, mais la direction en a été sensiblement rectifiée. Une des tours de la première enceinte subsiste encore, à moitié ruinée; l’autre a disparu sous des constructions modernes. Quelques dessins, qui datent de 1840 environ, nous ont permis de reconstituer cette ancienne porte, seule sortie de la ville, à cette époque, dans le front sud. C’est par cet étroit passage que circulaient les lourdes diligences qui se rendaient à Bordeaux.
TROISIÈME PORTE SAINT-NICOLAS
Sous Louis XVI, un pont fut établi à la sortie du bastion; deux fortes piles, sur lesquelles étaient sculptées les armes royales, soutenaient la herse pour la manœuvre du pont-levis.
L’importante redoute appelée «Ouvrage à Cornes», élevée à côte du bastion Saint-Nicolas, ne date que de 1690 et fut achevée en 1694. «Cet ouvrage a beaucoup cousté, étant fondé en partie sur grillage et pilotis, surtout le front du costé des marais de Tasdon; et cet ouvrage devoit estre le modèle de tous les autres dehors qu’on devoit faire autour de la place.» Si la ville eut été flanquée, dans tout son périmètre, d’ouvrages aussi importants, nul doute qu’on ne fût pas arrivé si facilement au déclassement de ses fortifications.
Il existait une porte d’eau sur le canal Maubec. «Il y a des coulisses — dit Masse — pour y mettre des horgues ou passe-lisses pour retenir les eaux. Cette porte estoit terminée par un parapet à mâchicouly. C’est un des morceaux, avec sa partie anciennement bastionnée, qui reste la plus entière: il y a dessus ce canal un corps de garde et on y a fait en 1710 des écluses ou empellements de bois pour retenir les eaux dans le canal Maubec.»
Qu’était cette porte de Saint-Eloy? «qui ne servait que d’ornement; qui fut faite après le razement de La Rochelle, pour distinguer la ville d’avec le faubourg Saint-Eloi; c’était par cette porte que l’on faisait les principales entrées quand il venait quelques seigneurs à La Rochelle. Elle a esté rayée en 1689.»