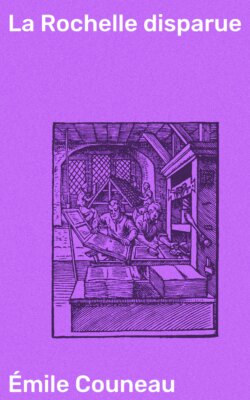Читать книгу La Rochelle disparue - Émile Couneau - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA TOUR DE LA LANTERNE
ОглавлениеLa courtine qui relie la tour de la Chaîne à la tour de la Lanterne était jadis battue par la mer, à chaque marée; le terre-plein du chantier de construction n’existait pas, et la porte qui y mène est toute récente. La muraille primitive date de 1387. Elle était flanquée de plusieurs tours pleines qui assuraient sa solidité et formaient une résistance contre la violence des tempêtes. Plus élevée que la muraille actuelle, elle servait de chemin de ronde à la fortification. On y accédait par un escalier qui fut refait à neuf en 1583 et définitivement reconstruit, comme il est aujourd’hui, en 1615.
A l’extrémité ouest de cette courtine et à l’angle droit que faisait la fortification «formant — dit Masse — une des encoignures de la ville où aboutissaient les murs de la porte Neuve», s’élevait la tour de la Lanterne, dont le pied baignait alors dans la mer. C’était comme un puissant éperon opposé aux fureurs de l’Océan. En avant se trouvait un ouvrage avancé, entouré d’eau, destiné à protéger la porte des Deux-Moulins, établie à cette époque à l’extrémité de la rue Saint-Jean. A ses pieds se déversait le cours d’eau de Parthenay, qui descendait de Lafond, bien plus abondant qu’il ne l’est aujourd’hui.
La tour de la Lanterne est plus récente que celles de l’entrée du port; aussi est-on mieux documenté en ce qui la concerne. On sait qu’elle fut commencée en 1445 et achevée, après une longue interruption, en 1476, sous la mairie de Mérichon, conseiller du roi Louis XI, qui contribua, de ses deniers personnels, à l’achèvement du monument. Elle mesure environ 70 mètres de haut, de sa base au sommet dé la flèche. On l’appelait aussi tour du Garrot, parce qu’elle était pourvue d’un énorme cabestan destiné au désarmement des nefs, qui venaient y faire le dépôt de leurs armes et munitions, avant d’être admis à entrer au port. On la nommait encore: tour des Prêtres, parce que treize prêtres, qui y étaient emprisonnés- pendant les luttes religieuses, y furent égorgés et précipités dans la mer.
Sa forme n’a pas subi de grandes modifications depuis sa construction. Elle se compose d’un énorme fût cylindrique sans ornement, autrefois entouré de créneaux et de meurtrières cruciformes, appuyés sur des consoles saillantes trilobées formant mâchicoulis.
On arrive à la galerie, qui fait le couronnements de cette base trapue, par une tourelle dont le sommet, en forme de pyramide quadrangulaire, porte uné inscription que Jourdan traduit ainsi: «L’an de l’incarnation MCCC sexante huyt, en la mairie de
«Me Jehan Mérichon, sieur d’Huré, Lagord, Le Breuil-Bertin, conseiller du roy et bailly «d’Aulnis, fut parachevée cette tour.» De cette galerie s’élève une flèche élégante, haute de 30 mètres environ, à 8 pans, dont les arêtes saillantes sont pourvues de crochets du style flamboyant, reliés entre eux par une légère moulure qui divise la flèche de 3 mètres en 3 mètres. Au pied de cette flèche, sur chaque face, se trouve une fenêtre trilobée surmontée d’un fronton à angle aigu, accompagné de pinacles sur les côtés. Quelques-unes de ces ouvertures subsistent encore dans leur état primitif; d’autres ont été aveuglées ou mutilées.
ARMOIRIES SUR LA TOUR DE LA LANTERNE
Vers le milieu de la flèche se trouvait une galerie circulaire, également munie de créneaux et dont il ne reste que les consoles. On y accédait par la tourelle qui se trouve au flanc nord, au-dessus de laquelle était placé le fanal qu’on éclairait la nuit et qui fit donner à la tour le nom de: la Lanterne. «Le maire — dit un de nos annalistes — y fait mestre, selon les statutz politics de la ville, un gros cierge ou autre massif flambeau, dans une lanterne de pierre qui est élevée sur un des costéz des hautes galeries de la tour, pour adresse et signal de sécurité à ceux qui, voyageant sur mer, auraient esgaré leur route, et aussi les avertir ayant relasché à cette lumière des bancs, escueils, anses, côtes, sables et autres lieux dangereux, qui avec un grand hazard se rencontrent en ceste mer...» Ce phare, bien primitif et d’une luminosité douteuse, devait être d’un médiocre secours aux navigateurs. Mervault donne de cette lanterne une description très précise: «Elle était en pierre de taille à 6 pans, percée à jour et vitrée, pour empêcher que le vent n’esteignit les flambeaux que l’on mettait dedans, la nuit.» Masse, tout en constatant le fait, dit «qu’il a vu des vieux dessins qui marquent qu’il y avoit d’attaché à cette pyramide un gros fallot attaché à un poteau de fer.» On a mis, depuis, une coupole de pierre à la place de cette élégante lanterne, qui devait produire un si gracieux effet au sommet de cette tourelle.
Quelques-uns prétendent que le jour on brûlait du bois à l’intérieur de la flèche, pour que la fumée servît de signal. M. Violet-Leduc, s’entretenant avec M. Lisch, lui exprimait ses doutes à cet égard et lui rappelait que les anciens phares étaient éclairés par de grands feux de bois. Il ajoutait qu’il ne serait pas éloigné d’admettre que l’aiguille de la tour de la Lanterne ne fût qu’une immense cheminée ouverte autrefois à son extrémité supérieure, et qu’à sa base, au-dessus de la voûte de l’étage supérieur, on allumait un vaste brasier de fagots ou autres matières combustibles; qu’alors les cinq grandes fenêtres de la flèche et aussi les ouvertures plus petites dont elle devait être percée sur chacun de ses pans s’éclairaient d’une vive lumière qui, pendant la nuit, projetait au loin un brillant éclat, tandis que, pendant le jour, l’épaisse fumée qui s’échappait du sommet de la tour pouvait transmettre des signaux à de très grandes distances, soit aux îles voisines, soit aux navires qui étaient en mer. Mais rien n’indique qu’il en fût ainsi. Du reste, Masse nous donne quelques renseignements sur le mode d’éclairage de nos côtes, qui nous font présumer que jamais la tour de la Lanterne n’a été pourvue d’un foyer dont la fumée servait de signal aux bateaux.
FANAL DE LA TOUR DES BALEINES (ILE DE RÉ)
Quand il parle de la tour des Baleines, à l’Ile de Ré — bien plus récente, il est vrai, que la tour de la Lanterne — et qu’il la dessine «en l’état qu’elle était en 1716», il met comme annotation en marge de son dessin: «Cette tour ou far est située à la pointe des Baleines. On y allume tous les soirs un feu dans une lampe ou réchau avec de l’huile, pour éclairer les vaisseaux qui viennent de la mer, et pour leur faire distinguer le pertuis Breton d’avec le pertuis d’Antioche et éviter les écueils qui sont le long des costes de l’Isle de Ré et de l’Isle d’Oléron, dont la plupart sont en partie cachés sous l’eau en basse mer, surtout celui qui part de la pointe des Baleines. Il y a trois fanaux ou fars dans le golfe Aquitanique ou mer de Gascogne. Le principal est la tour de Cordouan, à l’embouchure de la Gironde. Le second est celui de la pointe de Chassiron, ou du Bout du Monde, en l’Isle d’Oléron, et le troisième est celui des Baleines. Les feux sont différents à tous les trois; les deux précédents se font avec du bois, et celui-ci avec de l’huile. Ce fanal a été basti en 1679.»
COUPE DE LA TOUR DE LA LANTERNE
On peut donc conclure, que si la tour de la Lanterne avait été pourvue d’un pareil mode d’éclairage, à une époque quelconque, Masse en eût parlé, puisqu’il nous renseigne sur les diverses façons dont nos côtes étaient éclairées.
L’intérieur de la tour de la Lanterne n’offre aujourd’hui qu’un intérêt secondaire. Le terre-plein qui l’entoure est relativement récent. On entrait autrefois dans l’intérieur par une ouverture pratiquée au niveau du sol. Comme pour la tour Saint-Nicolas, l’entrée actuelle n’était qu’une porte de chemin de ronde, au premier étage. La première salle est heptagone, avec voûtes d’ogive; on y retrouve la trace d’anciennes meurtrières qui commandaient le chenal. A quoi servait ce grand arc inscrit sur la maçonnerie extérieure de la face ouest de la tour? On ne saurait trop le dire. Jourdan prétend que ce pourrait bien être la baie par laquelle s’opérait le désarmement des nefs.
Les deux salles superposées devaient être voûtées comme la première, surtout en admettant qu’on y entretenait un grand feu, comme le suppose M. Violet-Leduc. A l’époque où Masse relevait la coupe et l’élévation de la tour, celle-ci avait déjà subi de profondes modifications. «On avait commencé — dit-il — à la miner pour la faire sauter. Le comte du Doignon y tenait garnison, ç’auroit esté un grand dommage si on avoit détruit cet édifice, qui est un des plus beaux monuments de l’antiquité de La Rochelle.»
Depuis, on a dû y pratiquer des aménagements spéciaux, sans le moindre souci de son caractère archaïque, pour servir de prison à la garnison. Enfin, l’administration du Génie militaire en a encore remanié les dispositions intérieures pour les besoins de ses services.
Les escaliers ont eux-mêmes été modifiés; il ne reste presque rien de celui qui montait à la lanterne et à la galerie supérieure, au milieu de la flèche. Dans l’épaisseur des murs se trouvent quelques petits réduits, avec leurs voûtes en ogive. Le corps de cheminée, dont le tuyau présente un aspect si désagréable, accolé à la flèche, a été détruit; c’est le contraire qu’il eut fallu faire. Les jolies fenêtres ont été murées et fort endommagées. A la base de l’aiguille, quelques appartements ont été disposés pour des usages spéciaux, et du parquet de la dernière salle on n’aperçoit que le vide intérieur de la flèche. Ce cône, frappé plusieurs fois par la foudre, a été refait sans qu’on se soit préoccupé de restituer à son extrémité les ornements qui devaient cadrer avec le reste du monument. «Les murs de la flèche — dit Masse — n’ont que six pouces d’épaisseur et sont fort dégradés, en 1718, et tomberont bientôt si on ne la raccommode.» Ce pronostic ne s’est heureusement pas réalisé, bien qu’aucune réparation n’ait été entreprise depuis cette époque.
ARMOIRIES SUR LA TOUR DE LA LANTERNE
Les archéologues ont essayé de donner quelques explications au sujet des divers blasons qui subsistent encore; mais ces armoiries ont été tellement mutilées qu’il est difficile d’en préciser la signification.
Nous reproduisons, cependant, ceux que nous avons trouvés dans l’Armorial de la ville et aux Archives de la direction du Génie.
Avant que la tour de la Lanterne ne fût classée, avec les tours de l’entrée du port, comme monument historique, l’autorité militaire utilisait cet édifice comme prison pour les soldats de la garnison. Beaucoup de personnes se souviennent encore avoir vu, sur la galerie extérieure, des prisonniers venant prendre l’air pendant leurs heures de captivité. En maintes circonstances, on y avait aussi enfermé, antérieurement, des bourgeois en état de rébellion contre le Corps de ville (1615); des protestants du Poitou, venus pour chercher un refuge à La Rochelle, y furent incarcérés après l’insurrection vendéenne de 1793; les «brigands de la Vendée» furent transportés et jugés à La Rochelle, après avoir été détenus dans la tour de la Lanterne.
ARMOIRIES SUR LA TOUR DE LA LANTERNE
Lorsque la commission des Monuments historiques obtint de l’Etat d’importantes allocations pour la restauration de la tour Saint-Nicolas, on pensait que les subsides accordés chaque année suffiraient, à la longue, pour permettre la reconstitution complète des tours dans leur état primitif; mais il n’en fut rien. Les crédits ont été supprimés et le travail de restauration s’est trouvé arrêté. Cependant, à l’heure actuelle, les travaux de la tour Saint-Nicolas sont repris avec vigueur et arriveront sous peu à un complet Achèvement. Il ne faut guère compter sur une mise en état de la tour de la Chaîne. Ce n est plus qu’une ruine dont le relèvement représenterait une dépense considérable et peu justifiée. Tandis que la tour de la Lanterne — en ce qui concerne tout au moins son aspect extérieur — pourrait, sans trop de frais, être l’objet d’un remaniement facile qui lui reconstituerait à nouveau sa physionomie primitive. Il suffirait de lui restituer sa couronne de créneaux, de rétablir ses élégantes fenêtres et d’ornementer, dans le style de l’époque, l’extrémité de son aiguille et sa gracieuse lanterne.
Maintenant que La Rochelle n’est plus classée comme place forte, quel sort est réservé aux tours de l’entrée du port et de la Lanterne? La ville reprendra-t-elle possession de ces glorieux édifices qu’elle avait fait élever pour sa défense? Il faut en conserver l’espoir. Ce serait alors une équitable restitution faite à la commune rochelaise.
LE MARAIS PERDU
Avant la Construction du Bassin Neuf.
Imp. Fort Paris.