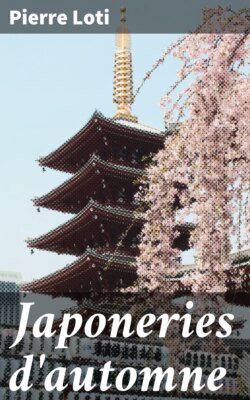Читать книгу Japoneries d'automne - Pierre Loti - Страница 11
IX
ОглавлениеUn reste d’été brille sur tout mon voyage. De bonne heure, le matin, dans ma chambre d’hôtel m’arrive un gai soleil, par ma véranda ouverte. Alors je vois, dans le jardin d’à côté, minauder les deux dames nippones mes voisines; leurs bébés font voler des cerfs-volants très extraordinaires, qui représentent de gros bouddhas ventrus...
Un de mes étonnements, dans cette ville, est de rencontrer un immense temple en construction. Il n’était pas de première nécessité, puisqu’il y en avait déjà trois mille.
Cela implique une contradiction de plus chez ce peuple si subitement affolé de vapeur et de progrès.
Et ce temple nouveau ne le cédera, ni en grandeur ni en magnificence, à ceux du passé. Une forêt de colonnes est là, disposée par terre, et pour chacune d’elles il a fallu choisir à grand frais quelque arbre rare et gigantesque. L’agencement de toutes ces pièces de bois est préparé avec un soin minutieux, une précision d’horlogerie; les mortaises, les tenons finement taillés sont enveloppés dans des étuis provisoires en bois blanc qui en prennent très exactement les contours de peur que la pluie, ou la main des passants, ou le soleil ne nuisent plus tard à leur étonnant ajustage. Et sans doute, quelque part, une armée d’ouvriers cisèle des vases et des girandoles, confectionne des dieux magnifiques ayant les attitudes immuables et les sourires d’il y a mille ans.
Mes djin sont petits, comme tous les Japonais; coiffés, comme presque tous les djin, d’un chapeau large en forme d’ombrelle; habillés d’une veste à manches pagodes, très courte de taille, comme nos plus courts vestons, et bariolée d’une façon saugrenue, ayant dans le dos un tas de choses écrites en grosses lettres nippones. Pas de pantalon ni de chemise; une étroite bande d’étoffe, nouée d’une façon très particulière, joue pour eux l’office confié chez nous aux feuilles de vigne, ou plus anciennement aux feuilles de figuier. Du reste, ces jambes, nues jusqu’aux reins, sont superbes de nerfs et de muscles, absolument sculpturales sous leur peau jaune.
Jamais fatigués, jamais haletants, les djin. Dans les montées seulement, un peu de sueur leur perle sur la poitrine; alors ils enlèvent leur veste. Ils poussent des cris dans les foules, pour avertir que nous passons; mais ils courent toujours, au risque d’accrocher les gens.
Je vis en parfaite intelligence avec Kalakawa, mon djin de flèche; il entre avec moi dans les temples, chez les marchands, et m’explique beaucoup de choses, dans un japonais très clair que je comprends sans peine. Il est très gentil et sait bien l’histoire, la théogonie, les légendes. L’autre, Hamanichi, celui d’entre les brancards, est taciturne et revêche; nos rapports, bien que courtois, sont d’une certaine froideur, même un peu tendus.
Tout s’assombrit, les quartiers deviennent plus déserts et plus morts, à mesure que nous approchons de «Kila-no-tendji», le grand temple shintoïste du Bœuf. C’est très loin, très loin, presque à la campagne, tout au bout d’un long faubourg triste. Une heure au moins de course échevelée en djin-richi-cha, pour arriver à l’entrée.
C’est du vieux Japon, par exemple, ce faubourg, du très, vieux, du vermoulu, du noirâtre. Les maisonnettes de bois ont des aspects branlants et caducs de centenaires; les charpentes saugrenues se gondolent, se fendillent et s’émiettent; tout cela semble abandonné, on n’aperçoit personne nulle part.
On devine cependant l’approche de quelque grand temple, où doivent se célébrer en ce moment même de solennelles cérémonies, car, suivant l’usage consacré pour les fêtes religieuses, on a disposé des deux côtés de ces rues des séries de potences d’où pendent des lanternes. Elles se dressent de deux en deux pas, en files interminables; les lanternes sont d’énormes ballons gris, sur lesquels sont peintes en noir des chauves-souris vues de dos, volant à tire-d’aile. Une si étrange décoration de fête n’égayé en rien ces quartiers; au contraire, toutes ces choses grises, ces alignements de lanternes qui n’en finissent plus, avec leurs bêtes nocturnes en guise de fleurs... on croirait voir les préparatifs de quelque vaste kermesse macabre, dont les invités ne viendront que la nuit.
Nous arrivons sans doute, car devant nous apparaissent, en masses sombres, les hautes ramures séculaires d’un de ces bois qui sont toujours consacrés aux dieux. Puis voici les portiques qui commencent: ils sont en granit fruste, et de ce style religieux très ancien qui se retrouve surtout dans les pagodes des villages, dans les lieux d’adoration perdus au milieu des forêts. La forme a dû en être léguée aux Japonais par une antiquité extrêmement lointaine et disparue, car elle ne leur ressemble pas; elle est sévère, grandiose, et surtout elle est simple; elle frappe comme une chose jamais vue. Mais il faudrait la dessiner, car elle n’est pas descriptible: deux piliers massifs, sortes de cônes s’élargissant par la base, réunis on haut par une première architrave qui est droite, et, un peu au-dessus, par une seconde qui est courbe, débordante, les pointes en l’air comme un croissant de lune; c’est tout, pas le moindre ornement, pas la moindre sculpture; l’ensemble est mystique et farouche: il tient du pylône égyptien et du dolmen celtique; il détonne très étrangement avec les choses compliquées, tourmentées qui l’entourent.
Après les portiques viennent les séries de monstres, rangés des deux côtés du chemin sur des socles de pierre. Les grands arbres étendent au-dessus leur ombre, leurs branchages contournés comme les bras multiples des idoles.
Cela commence par des espèces de tigres énormes en granit, assis sur leur arrière-train, ayant au milieu de la ligure une corne à la rhinocéros et riant d’un rire à faire peur. A leurs grosses pattes sont attachés, noués, des petits bandages blancs, comme s’ils avaient du mal: ce sont des prières qu’on leur a apportées là, sur bandelettes de papier de riz, pour les apaiser.
Cela se continue par des bœufs, un peu plus grands que nature, en granit, en bronze, ou en marbre précieux veiné de nuances rares; puis, par des alignements de tombes, ou de hautes lanternes de pierre ressemblant à des tourelles chinoises.
Au milieu de ces choses extraordinaires, dans la fraîcheur ombreuse de ce bois sacré, des gens se promènent. Plus nous approchons, plus nous rencontrons des groupes serrés; cela nous explique pourquoi ce faubourg était vide: tous les habitants se sont réunis là pour la fête; on a même dû venir de bien plus loin encore, car voici une vraie foule. Foule enfantine et frivole, comme on en voit de peintes sur les éventails ou les tasses à thé, foule qui babille, qui s’agite, et d’où partent des éclats de rire. Elle a beau être bizarre, elle cadre mal avec l’ombre de ce bois, où habitent tant de sinistres bêtes.
Beaucoup de dames souriantes, avec des piquets de fleurs artificielles dans leurs beaux chignons gommés. Tuniques très collantes aux bas de jambes, longues manches pagodes, longues ceintures nouées en pouf. Sur leurs socques en bois qui font du bruit, elles marchent les pieds en dedans, ce qui est la manière élégante. Et minaudent, et roulent leurs petits yeux retroussés, tenant le corps tout penché en avant, tout prêt pour les plus gracieuses révérences.
Des hommes en grande robe bleue; d’autres, jambes nues, montrant leur derrière. Des bonzes à sonnettes, drapés dans un flot de mousseline brune, figures invisibles sous d’immenses chapeaux pointus, marchant à pas lents, la main tendue pour mendier, au bruit continuel de leurs mille petites cloches. Des bandes d’enfants, se tenant tous par la main avec des airs d’importance: petits garçons bien potelés; petites filles habillées déjà comme les dames avec des fleurs et de grosses épingles dans leurs chignons de poupée; toujours jolis, ces bébés japonais, qui deviendront si laids plus tard; et puis très comiques, avec le retroussement exagéré de leurs yeux d’émail, avec l’ampleur de leurs robes bariolées, avec l’imprévu de leurs tonsures de cheveux, laissant par places des petites mèches impayables.
Il y a maintenant des boutiques de marchands de thé, où les familles nippones viennent s’asseoir. Beaucoup de kiosques religieux renfermant toutes sortes de choses. Dans l’un, demeure un gros taureau noir, bête sacrée, qui paraît d’humeur farouche; sa litière est d’une propreté minutieuse, il est attaché par des cordes de soie blanche, et, dans ses naseaux est passé un mors de sûreté incrusté de nacre. Un autre contient une voiture pour les dieux, ciselée magnifiquement; c’est ce taureau noir qui la traîne, m’explique mon djin, lorsque ces dieux sortent, suivis de la longue procession de leurs prêtres. Ailleurs, ce sont des bannières, des cartouches et des hampes d’or, tous les accessoires des grands défilés rituels, qui s’exécutent chaque année d’après une étiquette millénaire et immuable.
La foule devient plus pressée, et nous voici devant le grand temple. Sa haute toiture compliquée se dresse en face de nous en montagne grise, dépassant les branches des vieux arbres, masquant tout le fond du tableau. On monte au sanctuaire par d’immenses gradins qui sont absolument encombrés de Nippons et de Nippones. Ces gens sont pieds nus, ou marchent sur leurs chaussettes blanches à orteil séparé; aussi y a-t-il en bas, sous la surveillance d’un bonze, une incroyable quantité de socques de bois, de sandales de paille; comment tout ce monde s’y reconnaîtra-t-il au départ? Cela me semble un mystère. Je me déchausse aussi, ne craignant aucune confusion pour mes bottines, qui sont là uniques dans leur genre, et je monte, en compagnie de mon ami Kalakawa, poussant un peu, pour arriver plus vite, les groupes nonchalants et stationnaires. Beaucoup de figures jaunes, à petits yeux en amande, se retournent pour me regarder avec une curiosité bienveillante; un léger murmure d’étonnement parmi les mousmés, même quelques révérences à mon adresse, qui s’ébauchent au passage, et auxquelles je réponds par des petits saluts de tête avec une envie de rire.
En haut, une longue véranda à colonnes, sur laquelle le temple est complètement ouvert. On s’assied sur des nattes blanches, très encombrées par les petites boîtes à fumer des dames. Une balustrade, qui coupe le temple en son milieu, sépare les fidèles des bonzes; ceux-ci se tiennent accroupis dans la partie intérieure, déjà un peu obscure et mystérieuse, qui leur est réservée; ils sont vêtus de blanc, et coiffés d’un casque noir. Derrière eux, une seconde balustrade, au-dessus de laquelle brillent, sur des étagères d’au moins cinquante mètres de long, des amoncellements de vases sacrés et d’emblèmes. C’est bien un temple du cul te shintoïste pur; on n’aperçoit nulle part aucune figure bouddhique, aucune représentation humaine ni animale, et cela repose et change, après ces prodigieuses débauches d’idoles auxquelles on était habitué ailleurs; parmi les brûle-parfums et les vases, aucune tête grimaçante; rien que ces miroirs ronds, en acier poli, qui symbolisent la vérité.
Comme les autres fidèles, je jette dans l’enceinte des bonzes quelques pièces de monnaie; il y en a tant déjà, que les nattes en sont jonchées, couvertes; mais les prêtres, qui les ramasseront ce soir avec des râteaux, ne semblent pas les voir. Mon offrande fait bien dans le public; on échange autour de moi quelques mots d’approbation: «Cet étranger est vraiment un bon jeune homme.»
Tous les assistants murmurent à voix basse de longues prières et, de temps à autre, frappent dans leurs mains pour rappeler autour d’eux les Esprits distraits. Quelquefois un prêtre se lève, va tout au fond du temple, monte un précieux escalier de laque rouge, et salue, là-haut, le plus grands des miroirs qui pose sur une gerbe de fleurs d’argent. Alors, tous les autres bonzes tombent la face contre terre; derrière chacun d’eux, traînent la queue de sa robe blanche et les deux pointes de ses manches pagodes; ainsi aplatis sur le sol, ils ressemblent à de grandes bêtes ailées, dont on ne comprend plus la structure. Là-bas, dans la demi-obscurité, on voit courir sur les étagères, parmi les vases et les symboles, des petites choses grises, empressées, furtives, qui sont des rats et des souris.
Et pendant tout l’office, un prêtre, au moyen d’une bande d’étoffe blanche qui descend d’en haut, agite une sorte de monstrueux grelot de cuivre pendu à la voûte; il en sort un bruissement voilé, lointain, inconnu, qui semble le bourdonnement d’une énorme mouche...
Très loin de ce temple et de ce faubourg triste, fonctionnent les théâtres, groupés tous ensemble dans le quartier le plus central et le plus bruyant de la ville, au milieu des étalages de laques, d’étoffes éclatantes et de porcelaines. Ce sont de très hautes maisons de bois, construites légèrement, comme à faux frais. Elles disparaissent sous les banderoles multicolores, les papiers peints, les tableaux encadrés de dorures, les miroirs: un bariolage de saltimbanque, d’un goût inférieur. De plus, tout autour, sont plantés des bambous d’une hauteur démesurée, d’où pendent des oriflammes qui flottent au vent.
A l’intérieur, des boiseries grossières, un aspect de foire. Dans des loges de tribune se tiennent les personnes comme il faut. Par terre, sur des nattes, est assise la foule rieuse des gens communs, avec des centaines de petites boites à fumer, de petits réchauds, de petites pipes.
On joue là dedans du matin au soir des drames qui durent jusqu’à huit jours, et d’un réalisme atroce, avec du vrai sang qui coule. A l’orchestre, des gongs, des claque-bois, des guitares, des flûtes; tout cela grince, gémit, détonne, avec une étrangeté inouïe et une tristesse à faire frémir.
Comme chez nous, ce n’est plus guère qu’au théâtre qu’on retrouve encore les splendides costumes, les armures, le luxueux cérémonial des temps passés. Les acteurs déclament du gosier, lentement, distinctement, en chantant presque, avec une monotonie de mélopée. Comme chez nous toujours, il en est pour qui l’on se passionne, et la plupart d’entre eux font payer leur luxe par quelque belle dame qui minaude aux tribunes.
Quant aux actrices, elles ont beau être gentilles, avoir des voix douces, des airs câlins, il ne faut pas s’y laisser prendre: ce ne sont jamais que des hommes, grimés et portant perruque.
Les planches sont une plaque tournante, en très grand comme celles des chemins de fer. Une cloison, qui supporte le décor et forme le fond de la scène, est bâtie sur cette plaque et la partage en son milieu, de manière à n’en laisser visible que la moitié. Et quand l’acte est fini, toute la vaste machine commence avec lenteur, au bruit des gongs, son mouvement circulaire; alors on voit tourner et fuir ensemble le décor et le groupe final subitement immobilisé dans son dernier geste. Peu à peu la cloison centrale découvre au public son autre face, à laquelle est accroché le décor suivant; du même coup, l’autre moitié de la plaque amène les nouveaux acteurs, tout prêts, tout posés, servis comme sur un plateau.
Pendant un intermède, je visite les dessous, les loges d’acteurs, les coulisses. Une vieille dame noble, magnifiquement parée, a joué son rôle avec une distinction extrême et de beaux accents de tendresse maternelle. Alors j’ai désiré la voir de près.
Elle me reçoit avec un engageant sourire. Mais elle est un homme, naturellement, une espèce de mauvais drôle d’un âge ambigu, qui, pour changer de costume pendant cet entr’acte, étale la laideur de son corps jaune, s’est mis nu comme un sauvage, gardant toutefois son chignon monumental piqué d’épingles et sa figure de vieille dame...
En passant dans la rue, si l’on entend sortir d’une maison un bruit de guitares jouant en lièvre comme les czardas hongroises, on peut entrer pour voir: c’est un entrepôt de guéchas (musiciennes et danseuses de profession) qui se louent le soir pour les dîners et les fêtes. Presque toutes sont jolies, fines, distinguées, nerveuses, avec des mains exquises. On les a triées dès l’enfance parmi les bébés les plus réussis; c’est ensuite à Yeddo, au collège des guéchas, qu’elles ont été formées, comme au Conservatoire. De très bonne heure on les a dressées à n’être qu’un objet de luxe et de plaisir. Elles font toutes les danses que l’on veut, gracieuses, mystiques, obscènes ou terribles, à visage découvert. ou avec des masques. Il y en a parmi elles qui ont bien dix ans à peine, très charmantes petites poupées sans âme, caressantes comme des chattes, drôlement costumées, drôlement peintes, sentant bon, ayant des amours de petites mains frêles.