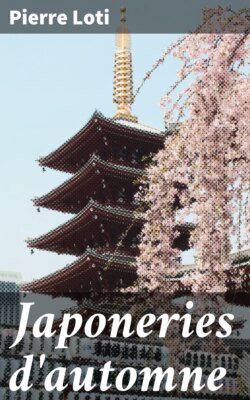Читать книгу Japoneries d'automne - Pierre Loti - Страница 5
IV
ОглавлениеKioto! C’est la vieille dame qui me réveille, très souriante, en me frappant sur les genoux.
Okini arigato, okami-san! (Grand merci, madame!) et je saute à terre, un peu ahuri au sortir de ce sommeil.
Alors me voilà assailli par la pléiade des djinrichi-san. Étant le seul en costume européen parmi cette foule qui débarque, je deviens leur point de mire à tous. (A bord, nous avons coutume de dire simplement des djin; c’est plus bref et cela va bien à ces hommes coureurs, toujours en mouvement rapide comme des diablotins.)
C’est à qui m’emportera, on se dispute et on se pousse. Mon Dieu, cela m’est égal à moi, je n’ai aucune préférence, et je me jette dans la première voiture venue. Mais ils sont cinq qui se précipitent, pour s’atteler devant, s’atteler en côté, pousser par derrière... Ah! non, c’est beaucoup trop, et deux me suffisent. Il faut parlementer longtemps en ayant l’air de se fâcher, pour se débarrasser des autres. A la fin c’est compris: un djin, entre les brancards, un djin attelé en flèche par une longue bande d’étoffe blanche, et nous partons comme le vent.
Quelle immense ville, ce Kioto, occupant avec ses parcs, ses palais, ses pagodes, presque l’emplacement de Paris. Bâtie tout en plaine, mais entourée de hautes montagnes comme pour plus de mystère.
Nous courons, nous courons, au milieu d’un dédale de petites rues à maisonnettes de bois, basses et noirâtres. Un air de ville abandonnée. C’est bien du vrai Japon par exemple, et rien ne détonne nulle part. Moi seul je fais tache, car on se retourne pour me voir.
Ha! ha! ho! hu! Les djin poussent des cris de bête pour s’exciter et écarter les passants. Assez dangereuse, cette manière de circuler dans un tout petit char d’une légèreté excessive, emporté par des gens qui courent, qui courent à toutes jambes. Cela bondit sur les pierres, cela s’incline dans les tournants brusques, cela accroche ou renverse des gens ou des choses. Dans certaine avenue très large, il y a un torrent qui roule, encaissé entre deux talus à pic, et tout au ras du bord nous passons ventre à terre. A toute minute, je me vois tomber là dedans.
Une demi-heure de course folle pour arriver à l’hôtel Yaâmi dont j’ai donné l’adresse à mes djin. C’est, paraît-il, un vrai hôtel, tout neuf, qu’un Japonais vient de monter à la manière anglaise, pour loger les aimables voyageurs venus d’Occident. Et il faut bien aller là pour trouver quelque chose à manger, la cuisine japonaise pouvant servir d’amusement tout au plus.
Il est situé d’une façon charmante, à cinquante mètres de haut dans les montagnes qui entourent la ville, parmi les jardins et les bois. On y monte par des escaliers fort mignons, par des pentes sablées avec bordure de rocailles et de fleurs, tout cela trop joli, trop arrangé, trop paysage de potiche, mais très riant, très frais.
L’hôte, en longue robe bleue, me reçoit au perron avec des révérences infinies. A l’intérieur, tout est neuf, aéré, soigné, élégant: des boiseries blanches et légères, d’un travail parfait. Dans ma chambre on m’apporte tant d’eau claire que j’en puisse désirer pour mes ablutions; mais cela se passe sans le moindre mystère; porte ouverte, l’hôte, les garçons, les servantes, entrent pour m’aider et pour me voir; de plus, les fenêtres donnent sur le jardin d’une maison voisine, et là, deux dames nippones qui se promenaient dans des allées en miniature s’arrêtent pour regarder aussi.
Un premier repas léger, servi tout à fait à l’anglaise, avec accompagnement de thé et de tartines beurrées, et puis je fais comparaître deux djin que je loue au prix fixé de soixante-quinze sous par tête et par jour; pour cette somme-là ils courront du matin au soir à ma fantaisie, sans s’essouffler ni gémir, en m’entrainant avec eux.
Ces courses en djin sont un des souvenirs qui restent, de ces journées de Kioto où l’on se dépêche pour voir et faire tant de choses. Emporté deux fois vite comme par un cheval au trot, on sautille d’ornière en ornière, on bouscule des foules, on franchit des petits ponts croulants, on se trouve voyageant seul à travers des quartiers déserts. Même on monte des escaliers et on en descend; alors, à chaque marche, pouf, pouf, pouf, on tressaute sur son siège, on fait la paume. A la fin, le soir, un ahurissement vous vient, et on voit défiler les choses comme dans un kaléidoscope remué trop vite, dont les changements fatigueraient la vue.
Comme c’est inégal, changeant, bizarre, ce Kioto! Des rues encore bruyantes, encombrées de djin, de piétons, de vendeurs, d’affiches bariolées, d’oriflammes extravagantes qui flottent au vent. Tantôt on court au milieu du bruit et des cris; tantôt c’est dans le silence des choses abandonnées, parmi les débris d’un grand passé mort. On est au milieu des étalages miroitants, des étoffes et des porcelaines; ou bien on approche des grands temples, et les marchands d’idoles ouvrent seuls leurs boutiques pleines d’inimaginables figures; ou bien encore on a la surprise d’entrer brusquement sous un bois de bambous, aux tiges prodigieusement hautes, serrées, frêles, donnant l’impression d’être devenu un infime insecte qui circulerait sous les graminées fines de nos champs au mois de juin.
Et quel immense capharnaüm religieux, quel gigantesque sanctuaire d’adoration que ce Kioto des anciens empereurs! Trois mille temples où dorment d’incalculables richesses, consacrées à toutes sortes de dieux, de déesses ou de bêtes. Des palais vides et silencieux, où l’on traverse pieds nus des séries de salles tout en laque d’or, décorées avec une étrangeté rare et exquise. Des bois sacrés aux arbres centenaires, dont les avenues sont bordées d’une légion de monstres, en granit, en marbre ou en bronze.