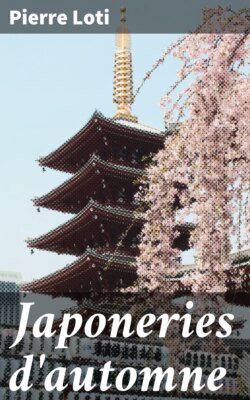Читать книгу Japoneries d'automne - Pierre Loti - Страница 13
XI
ОглавлениеC’est le soir, déjà un peu au crépuscule, que je me dirige vers la gare pour partir, traîné toujours par les mêmes fidèles coureurs, Mais une seconde djin-richi-cha suit la mienne, portant, dans des caisses, de vieilles choses extraordinaires, surtout des choses religieuses que j’ai ramassées çà et là sous la poussière des bric-à-brac, aux environs des temples.
Mon plus grand embarras est un bouquet de grands lotus bouddhiques en bois doré, acheté à la dernière heure, et que je tiens à la main par les tiges comme on porterait des fleurs véritables. Mes djin m’ont promis de rencontrer en route un emballeur pour ce bouquet-là; mais je m’inquiète, car nous roulons déjà dans les rues plus pauvres et plus désertes du faubourg qui avoisine le chemin de fer.
Tout à coup, Kalakawa pousse un cri d’oiseau, auquel mon petit char s’arrête net, avec un soubresaut très dur; au fond d’une échoppe encombrée de planchettes de sapins, il vient d’apercevoir le bonhomme qu’il me faut.
Alors je me présenté là dedans, tenant toujours en main ces grands lotus. Un vieux Nippon se précipite, empressé, avec des révérences, qui prend mes fleurs, les compte, les mesure, combine de rapides calculs; ça va me coûter douze sous pour la caisse: de plus, il faudra au moins trois autres sous pour l’ouate, ce qui fera bien quinze!
Et il me regarde, anxieux, se demandant si je ne vais pas me révolter de ce vol exorbitant. Mon Dieu, non; je suis même tellement satisfait de la rencontre de ce bonhomme que j’accepte d’un air gracieux, en recommandant de faire au plus vite. Alors c’est une joie dans toute la famille; pendant que la chose se scie, se cloue, se confectionne au moyen de petits instruments primitifs avec une prestesse de singe, on m’apporte des coussins pour m’asseoir, une tasse de thé, et les deux tout petits mouskosde la maison, qui sont des bébés joyeux, jolis et propres. En même temps, dans la rue, un rassemblement de mousmés s’est formé pour me voir. D’abord elles font mine de se cacher en riant chaque fois que leurs yeux rencontrent ceux de l’étranger qui les regarde; ensuite, très vite apprivoisées, elles se rapprochent et commencent à questionner: si je suis Français ou Anglais, quel est mon âge, ce que je suis venu faire tout seul, et ce que j’emporte dans mes caisses?
Un étonnement me vient tout à coup de pouvoir entendre ce qu’elles me disent, et de savoir, sans trop chercher, faire des réponses qu’elles comprennent; c’est encore si récent, si peu classé dans ma tête, ce Japon et ce langage japonais; il y a six mois à peine, c’était un recoin de la terre (le dernier, je crois bien) où les hasards de ma vie ne m’avaient pas conduit, un pays que j’ignorais. Et je ne reconnais plus le son de ma voix dans ces mots nouveaux que je prononce, il me semble n’être plus moi-même.
Ce soir, je les trouve presque jolies, ces mousmés; c’est sans doute que déjà je m’habitue à ces visages d’extrême Asie. C’est surtout qu’elles sont très jeunes, des petites figures aux traits vagues, comme inachevées, et au Japon le charme de la première jeunesse, de l’enfance, n’est pas contestable. Seulement cette fleur mystérieuse du commencement de la vie se fane plus vite qu’ailleurs; avec les années tout de suite cela se décompose, grimace, tourne au vieux singe.
Elles forment un groupe à peindre, les mousmés, avec leurs petites tournures un peu précieuses, les couleurs fraîches et heurtées de leurs costumes, et leurs larges ceintures nouées en coques bouffantes. La nuit tombe tout à fait, et le temps s’est voilé de gris avec un air d’hiver; dans l’encadrement sombre de la porte, elles apparaissent très éclairées; tout ce qui reste de lumière s’est concentré sur elles, bizarrement. Au delà de leurs têtes, on voit fuir la petite rue déserte; ses maisonnettes de bois noirâtre découpent, en séries de festons et de pointes, leurs toitures débordantes sur le gris crépusculaire de ce ciel où des chauves-souris passent. Au moment de quitter cette ville où je ne reviendrai certainement jamais, une mélancolie m’arrive je ne sais d’où, avec la conscience d’être si seul et d’être si loin.
C’est déjà fini, l’emballage habile de ce vieux. Alors je paye, je dis à la ronde un sayanara (adieu) pour l’éternité, et nous recommençons à courir, emportant la nouvelle caisse des lotus d’or.
Il était écrit sans doute que je n’en finirais pas avec ce Kioto; voici, au détour d’une rue, dans le clair-obscur, une physionnomie tellement attirante que, d’un coup d’évantail dans le dos d’Hamanichi mon premier djin, j’arrête encore mes équipages. J’ai été absolument captivé: une fascination, un coup de foudre, tout de suite j’ai senti que nos destinées était unies pour jamais. C’est, à la porte d’un marchand d’objets de piété, un dieu de grande taille humaine assis les jambes croisées; un très vieux dieu Amiddah, à six, bras, cinq yeux; gesticulant, ricanant, féroce; un dieu d’une espèce rare sur les marchés, une vraie trouvaille. Justement celui-ci est dans des prix doux, que je ferai rabattre encore de moitié; c’est décidé, je l’emmène. Alors on s’agite, me voyant si pressé; on va confectionner à la hâte une caisse énorme et procéder à la mise en bière. Non, pas du tout, je suis déjà en retard, nous manquerions le train; j’appelle tout simplement une troisième djin-richi-cha, ou le dieu prend place comme une personne naturelle. Nous repartons ventre à terre, ayant maintenant six djin qui poussent des cris, et les Nippons s’ébahissent en route de voir cet Amiddah qui fuit en voiture, enlevé par un Européen.
Quelques contestations avec les employés de la gare, que surprend ce colis imprévu, moitié voyageur, moitié bagage. On finit par s’entendre, et on l’assied comme un homme sur des malles, en me promettant de veiller sur lui tout le long du chemin.
Nous arrivons par un train de minuit à Kobé, où un canot de mon bateau doit m’attendre au quai, à l’heure convenue. Même cortège qu’à Kioto: une voiture pour moi, une seconde pour le dieu, une troisième pour nos bagages. Comme au départ, il faut traverser certain quartier indicible, où nos matelots sont en plein dans leur fête joyeuse. Ceux de mon bord me reconnaissent, malgré mon costume inusité: «Ah! voilà le capitaine de manoeuvre qui revient de son voyage!» et ils m’ôtent leur bonnet. Mais ce compagnon que je ramène, rouge comme le diable, avec son geste multiple, son air féroce qui saute aux yeux même la nuit, qui ça peut-il bien être? Étant déjà un peu gris, ils ne comprennent vraiment pas du tout.
D’autant moins que nous passons très vite, nos djin courant à toutes jambes vers la mer...