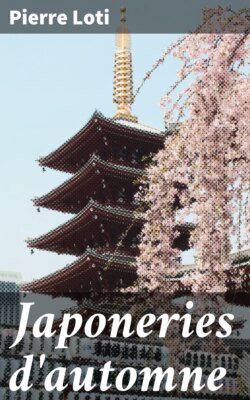Читать книгу Japoneries d'automne - Pierre Loti - Страница 8
VI
ОглавлениеA l’hôtel Yaâmi, les repas sont ordonnés d’une manière très correctement britannique: morceaux de pain minuscules, rôtis tout rouges et pommes de terre bouillies.
Du reste, les seuls voyageurs en ce moment sont quatre touristes anglais, deux gentlemen grisonnants, aux allures comme il faut, et deux misses d’un âge mûr. Hautes de six pieds, et d’une extrême laideur, elles sont habillées, dans des espèces de guérites en mousseline blanche qui laissent saillir tout autour de leur taille des baleines rétives. A mes yeux déjà habitués aux gentilles guenons japonaises, elles apparaissent comme deux grands singes mâles qu’on aurait costumés pour quelque représentation à la foire.
Il y a pour moi dans cet hôtel une heure assez charmante; c’est après le dîner de midi quand je suis seul assis sous la véranda d’où l’on domine la ville, fumant une cigarette dans un demi-sommeil de l’esprit. Au premier plan est le jardin, avec son labyrinthe en miniature, ses toutes petites rocailles, son tout petit lac, ses arbustes nains, dont les uns ont des feuilles, les autres des fleurs seulement, toujours comme dans les paysages sur porcelaine. Par-dessus ces gentilles choses, maniérées à la japonaise, se déploie dans les grands lointains toute la ville aux milliers de toits noirs, avec ses palais, ses temples, sa ceinture de montagnes bleuâtres. Toujours la légère vapeur blanche de l’automne flottant dans l’air, et le tiède soleil éclairant tout de sa lumière pure. Et la campagne toute remplie de la musique éternelle des cigales.
Mon Dieu! voici les deux misses échappées de leur appartement qui viennent folâtrer dans les allées du jardin, avec des gaietés enfantines de babies et des grâces d’orang-outang! Ah! non, alors, la position n’est plus tenable ici.
–Monsieur Yaâmi, je vous en prie, qu’on fasse vite avancer mes djin, et en route... pour le palais de Taïko-Sama!
Pour la dix ou vingtième fois nous devons traverser ce large torrent qui coupe en deux la ville. (En ce moment, il est à peu près desséché, étalant au soleil son grand lit de cailloux.)
Mais celui des ponts de bois que nous voulions prendre aujoud’hui vient précisément de s’écrouler en son milieu. Alors il faut descendre, par une échelle improvisée, dans ce lit du fleuve, tandis que mes djin me suivent portant ma voiture sur leurs épaules. Du reste, une quantité de djin qui couraient par derrière nous, traînant des dames de qualité, imitent notre manoeuvre et voici les belles passant à gué, troussées, trébuchant sur leurs hautes chaussures de bois, avec un grand tapage d’exclamations et d’éclats de rire.
Sur l’autre rive, un grouillement de pauvres et une affreuse pouillerie. C’est la foire des marchands à la toilette; c’est la friperie, la guenille. Des deux côtés de la rue sont entassées sur les pavés d’incroyables loques, traînées, déchirées, sordides, quelques-unes ayant été somptueuses, et encore éclatantes; vieux matelas, vieilles couvertures, vieilles chaussettes à doigts de pieds séparés; belles ceintures de dames, en satin multicolore, belles robes de soie brodées de cigognes, de papillons, de fleurs; un vieux chapeau haut de forme européen, qui a dû avoir un roman bien semé d’aventures, est même là à vendre, affaissé sur ces débris japonais. Il y aurait peut-être des trouvailles à faire, mais c’est repoussant à fouiller. Passons vite, tout cela sent la race jaune, la moisissure et la mort.
Après, viennent des revendeurs de ferrailles: un pêle-mêle d’ustensiles baroques, où gisent même, dans la poussière grise, de vieilles lampes de pagodes et des colliers d’idoles. Les dames de qualité, qui sont aussi remontées en voiture, courent derrière moi; j’ai l’air de traîner ce sérail à ma suite et, en file indienne, nous traversons à toutes jambes cet immense bric-à-brac.
Les rues s’élargissent, les quartiers changent d’aspect. Maintenant ce sont des avenues larges plantées d’arbres, des places. Et voici le palais de Taïko-Sama qui montre au-dessus de la verdure ses hauts toits sombres et superbes.
Une enceinte de grands murs. Mes djin s’arrêtent devant un premier portique d’un style ancien sévère et religieux: colonnes massives à base de bronze; frise droite, sculptée d’ornements étranges; toiture lourde et énorme.
Alors je pénètre à pied dans de vastes cours désertes, plantées d’arbres séculaires, dont on a étayé les branches comme on met des béquilles aux membres des vieillards. Les immenses bâtiments du palais m’apparaissent d’abord dans une espèce de désordre où ne se démêle aucun plan d’ensemble. Partout de ces hautes toitures monumentales, écrasantes, dont les angles se relèvent en courbes chinoises et se hérissent d’ornements noirs.
Ne voyant personne, je me dirige au hasard. Ici s’arrête absolument le sourire, inséparable du Japon moderne. J’ai l’impression de pénétrer dans le silence d’un passé incompréhensible, dans la splendeur morte d’une civilisation dont l’architecture, le dessin, l’esthétique me sont tout à fait étrangers et inconnus.
Un bonze gardien qui m’a aperçu se dirige vers moi en faisant la révérence, puis me demande mon nom et mon passeport.
C’est très bien: il va me faire visiter lui-même le palais entier à condition que je veuille bien me déchausser et ôter mon chapeau. Il m’apporte même des sandales en velours, qui sont à l’usage des visiteurs. Merci, je préfère marcher pieds nus comme lui, et nous commençons notre promenade silencieuse dans une interminable série de salles tout en laque d’or, décorées avec une étrangeté rare et exquise.
Par terre, c’est toujours et partout cette éternelle couche de nattes blanches, qu’on retrouve aussi simple, aussi soignée, aussi propre, chez les empereurs, dans les temples, chez les bourgeois et chez les pauvres. Aucun meuble nulle part, c’est chose inconnue au Japon, ou peu s’en faut; le palais entièrement vide. Toute la surprenante magnificence est aux murailles et aux voûtes. La précieuse laque d’or s’étale uniformément partout, et sur ce fond d’aspect byzantin tous les artistes célèbres du grand siècle japonais ont peint des choses inimitables. Chaque salle a été décorée par un peintre différent, et illustre, dont le bonze me cite le nom avec respect. Dans l’une, ce sont toutes les fleurs connues; dans l’autre, tous les oiseaux du ciel, toutes les bêtes de la terre; ou bien des chasses et des combats, où l’on voit des guerriers, couverts d’armures et de masques effrayants, poursuivre à cheval des monstres et des chimères. La plus bizarre assurément n’est décorée que d’éventails: des éventails de toutes les formes, de toutes les couleurs, déployés, fermés, à demi ouverts, jetés avec une grâce extrême sur la fine laque d’or. Les plafonds, également laqués d’or, sont à caissons, peints avec le même soin, avec le même art. Ce qu’il y a de plus merveilleux peut-être, c’est cette série de hautes frises ajourées qui règne autour de tous les plafonds; on songe aux générations patientes d’ouvriers qui ont dû s’user pour sculpter dans de telles épaisseurs de bois ces choses délicates, presque transparentes: tantôt ce sont des buissons de roses, tantôt des enlacements de glycines, ou des gerbes de riz; ailleurs des vols de cigognes qui semblent fendre l’air à toute vitesse, formant avec leurs milliers de pattes, de cous tendus, de plumes, un enchevêtrement si bien combiné, que tout cela vit, détale, que rien ne traîne ni ne s’embrouille.
Dans ce palais, qui n’a aucune fenêtre, il fait sombre; une demi-obscurité favorable aux enchantements. La plupart de ces salles reçoivent une lumière frisante par les vérandas du dehors, sur lesquelles un de leurs quatre côtés, composé seulement de colonnes laquées, est complètement ouvert; c’est l’éclairage des hangars profonds, des halles. Les appartements intérieurs, plus mystérieux, s’ouvrent sur les premiers par d’autres colonnades semblables, et en reçoivent une lumière plus atténuée encore; ils peuvent être fermés à volonté par des stores de bambou d’une finesse extrême, dont le tissu imite par transparence les dessins de la moire, et que relèvent aux plafonds d’énormes glands de soie rouge. Ils communiquent entre eux par des espèces de portiques dont les formes sont inusitées et imprévues: tantôt des cercles parfaits dans lesquels on passe debout comme dans de grandes chatières; tantôt des figures plus compliquées, des hexagones ou des étoiles. Et toutes ces ouvertures secondaires ont des encadrements de laque noire qui tranchent avec une élégance distinguée sur le ton général des ors, et que renforcent à tous les angles des ornements de bronze merveilleusement ciselés par des orfèvres d’autrefois.
Les siècles aussi se sont chargés d’embellir ce palais, en voilant un peu l’éclat des choses, en fondant tous ces ensembles d’or dans une sorte d’effacement très doux; avec ce silence et cette solitude, on dirait la demeure enchantée de quelque «Belle au bois dormant», princesse d’un monde inconnu, d’une planète qui ne serait pas la nôtre.
Nous passons devant des petits jardins intérieurs qui sont, suivant l’usage japonais, des réductions en miniature de sites très sauvages. Contrastes inattendus au milieu de ce palais d’or. Là encore le temps a passé, verdissant les petits rochers, les petits lacs, les petits abîmes; effritant les petites montagnes, donnant un air réel a tout cela qui est minuscule et factice. Les arbres, créés nains par je ne sais quel procédé japonais, n’ont pas pu grandir; mais ils ont pris un air de vétusté extrême. Les cycas sont devenus à plusieurs branches, à force d’être centenaires; on dirait des petits palmiers à tronc multiple, des plantes antédiluviennes; ou plutôt de massifs candélabres noirs, dont chaque bras porterait à son extrémité un frais bouquet de plumes vertes.
Ce qui surprend aussi, c’est l’appartement particulier qu’avait choisi ce Taïko-Sama, qui fut un grand conquérant et un grand empereur. C’est très petit, très simple, et cela donne sur le plus, mignon, le plus maniéré de tous les jardinets.
La salle des réceptions, qu’on me montre une des dernières, est la plus vas te et la plus magnifique. Environ cinquante mètres de profondeur et, naturellement, toute en laque d’or, avec une haute frise merveilleuse. Toujours pas de meubles; rien que les étagères de laque sur lesquelles les beaux seigneurs, en arrivant, déposaient leurs armes. Au fond, derrière une colonnade, l’estrade où, à l’époque déjà reculée de notre Henri IV, Taïko-Sama donnait ses audiences. Alors on songe à ces réceptions, à ces entrées de seigneurs étincelants dont les casques étaient surmontés de cornes, de muffles, d’épouvantails; à tout le cérémonial inouï de cette cour. On y songe, à tout cela, mais on ne le voit pas bien revivre. Non seulement c’est trop loin dans le temps, mais surtout c’est trop loin dans l’échelonnement des races de la Terre; c’est trop en dehors de nos conceptions à nous et de toutes les notions héréditaires que nous avons reçues sur les choses. Il en est de même dans les vieux temples de ce pays; nous regardons sans bien comprendre, les symboles nous échappent. Entre ce Japon et nous, les différences des origines premières creusent un grand abîme.
–Nous allons traverser encore une autre salle, me dit le bonze, et ensuite une série de couloirs qui nous mèneront au temple du palais.
Dans cette dernière salle, il y a du monde, ce qui est une surprise, toutes les précédentes étant vides; mais le silence reste le même. Des gens accroupis tout autour des murailles paraissent très occupés à écrire: ce sont des prêtres qui copient des prières, avec des petits pinceaux, sur des feuilles de riz, pour les vendre au peuple. Ici, sur les fonds d’or des murailles, toutes les peintures représentent des tigres royaux un peu plus grands que nature, dans toutes les positions de la fureur, du guet, de la course, de la câlinerie ou du sommeil. Au-dessus des bonzes immobiles ils dressent leurs grosses têtes expressives et mérchantes, montrant leurs crocs aigus.
Mon guide salue en entrant. Comme je suis chez le peuple le plus poli de la terre, je me crois obligé de saluer aussi. Alors la révérence qui m’est rendue se propage en traînée tout autour de la salle, et nous passons.
Des couloirs encombrés de manuscrits, de ballots de prières, et nous voici dans le temple. Il est, comme je m’y étais attendu, d’une grande magnificence. Murailles, voûtes, colonnes, tout est en laque d’or, la haute frise représente des feuillages et des bouquets d’énormes pivoines très épanouies, sculptées avec tant de finesse qu’on les dirait prêtes à s’effeuiller au moindre souffle, à tomber en pluie dorée sur le sol. Derrière une colonnade, dans la partie sombre, se tiennent les idoles, les emblèmes, au milieu de toute la richesse amoncelée des vases sacrés, des brûle-parfums et des lampadaires.
Justement c’est l’heure de l’office (culte bouddhique). Dans une des cours, une cloche, aux sons graves de contrebasse, commence à tinter avec une extrême lenteur. Des bonzes, en robe de gaze noire avec surplis vert, font une entrée rituelle dont les passes sont très compliquées, puis viennent s’accroupir au milieu du sanctuaire. Il y a peu de fidèles; à peine deux ou trois groupes, qui paraissent perdus dans ce grand temple. Ce sont des femmes, étendues sur les nattes; ayant apporté leurs petites boîtes à fumer, leurs petites pipes, elles causent tout bas, étouffant des envies de rire.
Cependant la cloche commence à tinter plus vite et les prêtres à faire de grands saints à leurs dieux. Plus vite encore, les vibrations du bronze se précipitent, tandis que les prêtres se prosternent tout à fait la face contre terre.
Alors, dans les régions mystiques, quelque chose se passe qui me paraît ressembler beaucoup a l’élévation de la messe dans le culte romain. En dehors, la cloche, comme exaspérée, sonne à coups rapides, ininterrompus, frénétiques.
Je crois bien que j’ai tout vu maintenant dans ce palais; mais je continue à n’avoir pas compris l’agencement des salles, le plan d’ensemble. Seul, je me perdrais là dedans comme dans un labyrinthe.
Heureusement, mon guide va me reconduire, après m’avoir rechaussé lui-même. A travers de nouvelles cours silencieuses, en passant auprès d’un vieil arbre gigantesque, qui est miraculeux, paraît-il, et qui depuis plusieurs siècles protège ce palais contre les incendies, il me ramène à cette même porte par laquelle je suis entré, et où mes djin m’attendent.
Je me fais conduire au Gos-Sho, l’ancien palais impérial que les Mikados ont délaissé. C’est très loin au milieu d’esplanades désertes, de terrains vagues. Mais cette interminable muraille massive, inclinée comme un rempart, me tente beaucoup à franchir.
Là, comme je le craignais, avec mille formes aimables, on me refuse l’entrée. C’est à peu près interdit en tout temps, m’assure-t-on. En ce moment surtout c’est impossible: on se hâte de faire de grands préparatifs pour recevoir la vieille impératrice mère, qui veut revenir dans sa capitale d’autrefois.
Quel dommage en vérité de ne pouvoir être présenté à cette douairière! Comme ce doit être drôle à voir, à étudier, dans la vie privée, dans le secret du gynécée, une vieille impératrice nippone!
Bien que cela m’intéresse assez peu, il faut cependant visiter aussi ces fabriques de porcelaine, qui fonctionnent depuis tant de siècles, ayant semé par le monde d’innombrables milliers de tasses et de potiches. Là, rien de moderne n’est encore venu. On est surpris de la manière simple, primitive, dont tout cela se pétrit, se tripote, se tourne, se fait cuire, comme il y a mille ans. Entre deux cuissons, une armée de peintres enlumine ces choses avec une prestesse prodigieuse, recopiant toujours ces mêmes cigognes, ces mêmes poissons, ces mêmes belles dames, qu’on était pourtant agacé d’avoir déjà tant vus.
Ces peintres des fabriques sont payés en moyenne dix sous par jour; exceptionnellement, on en donne jusqu’à quarante ou cinquante à ceux qui sont tout à fait célèbres, qui décorent les pièces précieuses destinées à être vendues très cher.
On ne peut s’empêcher d’admirer cependant la sûreté avec laquelle s’exerce cet art industriel. Aussi vite que nous griffonnerions une lettre, eux groupent des bonshommes appris par cœur; en deux coups de pinceau, les colorient, sans jamais dévier d’une ligne; puis, négligemment, tracent des filets de la précision la plus rigoureuse. Il a fallu sans doute une longue hérédité de calme et de tempérance pour former ces virtuoses à main si posée. Bientôt, quand le Japon sera tout à fait lancé dans le mouvement moderne, et ses ouvriers, dans l’alcool, ce sera fini à tout jamais de ces petits peintres-là.