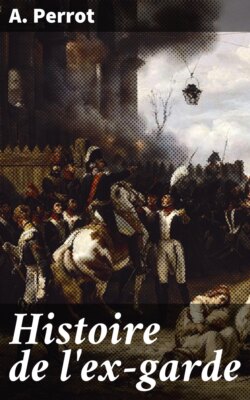Читать книгу Histoire de l'ex-garde - A. M. Perrot - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCTION.
ОглавлениеTable des matières
QUELLE tâche glorieuse que celle de retracer aux siècles à venir les hauts faits de ces soldats, à juste titre nommés invincibles, de ces héros, l’élite d’une armée que son seul aspect rendit maîtresse du monde, et qui illustra à jamais le nom français. Déroulons donc aux yeux étonnés les fastes glorieux de ces généreux guerriers ensevelis sous les lauriers. Honorons la mémoire des braves, et les braves naîtront en foule.... Dans Athènes, les plus grands orateurs célébraient le courage des vainqueurs de Salamine et de Marathon. Rien n’exalte plus l’âme des guerriers, que les témoignages éclatans de l’estime publique. On ne saurait donc trop imiter Pindare, lorsqu’au retour des Grecs victorieux des Perses, il employait les expressions les plus énergiques, les figures les plus brillantes, et semblait emprunter la voix du tonnerre pour dire aux Grecs assemblés: «Ne laissez pas éteindre le
» feu divin qui embrase nos cœurs, excitez
» toutes les espèces d’émulations,
» honorez tous les genres de mérite, n’attendez
» que des actes de courage et de
» grandeur de celui qui ne vit que pour
» la gloire.» L’exemple de ces anciens s’est conservé parmi nous: c’est avec admiration, avec reconnaissance, que nous rendons hommage à ces hommes célèbres qui de tout temps ont ennobli leur carrière, en élevant à la valeur des monumens plus durables que l’airain. C’est ainsi que les écrivains du siècle de Louis XIV, par des ouvrages qui attestent sa grandeur, l’ont couvert d’une gloire immortelle! L’historien du siècle présent célèbre vingt-cinq ans de victoires: unissons-nous donc à lui, et essayons de réunir les précieux débris d’un corps immortel. Ce n’est point comme orateur, mais comme citoyen, que nous rendons hommage à cette garde valeureuse.
A une époque de la révolution où la France était sur le point d’être envahie, parut un homme qui, secondant le vœu national ( celui de repousser une ligue ennemie ), eut le génie de rassembler en peu de temps toutes les forces dispersées, et, par un talent digne des plus grands éloges, d’en composer une armée qui, sous ses ordres, débuta par des actions qui présagèrent la renommée qu’elle devait atteindre, en triomphant d’une partie de l’Europe.
Lorsque la convention voulut se créer une garde, ce fut dans les rangs de cette armée victorieuse qu’elle fit choix des braves qui devaient la composer. Passant ensuite à la garde du directoire, elle devint, par la création du consulat, garde consulaire, et fut appelée dès lors à partager les dangers du chef de l’état. En 1804, par un nouvel ordre de choses, elle prit enfin le titre de garde impériale. C’est à partir de cette époque que commence l’histoire de cette garde, qui, uniquement attachée à son chef, n’en a pas moins rendu d’éclatans services à la patrie, en versant son sang pour elle.
C’est en partie du sein de cette garde que sont sortis ces hommes qui, par leurs exploits, sont parvenus aux grades les plus élevés. Nourris dans les camps, ils ne durent point cette élévation à ces intrigues obscures qui avilissent toujours ceux qui les mettent en usage; mais à leur mérite, à leur loyauté, et surtout à cette noble audace qui caractérise la bravoure des soldats français, qui tous portent dans leur cœur cette devise immortelle, Honneur et Patrie! Honneur et Patrie! J’aime à redire ces mots, qui ont enfanté ces traits d’héroïsme qui tiennent du prodige, et qui placent désormais les noms de nos modernes capitaines à coté de ceux des Bayard, des Gaston, des Vauban, des Luxembourg, des Vendôme, des Catinat, des Villars, etc. Oui, la postérité redira avec orgueil les noms des Kléber, des Desaix, des Hoche, des Joubert, des Bonaparte, des Lannes, des Masséna, des Beauharnais, des Kellermann, des Moncey, des Brune, des Soult, des Gouvion-Saint-Cyr, et de tant d’autres généraux dont la France s’honore.
Parmi les généraux que la révolution vit éclore, il en est un qui mérite une mention particulière: le génie militaire présida à la naissance de Bonaparte, puisqu’à peine à la fleur de l’âge, ses talens le placèrent à la tête d’une armée qui bientôt se glorifia de l’avoir pour général. On sait que, dès sa plus tendre jeunesse, ce général cultiva l’art qui le mit à la tête de nos phalanges, et le rendit maître de l’Europe. Mais ne nous arrêtons pas à son éducation que contestent ses détracteurs. Il y en a une pour le vulgaire: pour l’homme de génie, il n’en est point d’autre que celle qu’il se donne lui-même, et qui se développe suivant les circonstances. Aussi l’histoire, sous ce rapport, n’offre rien qui puisse être comparé à Bonaparte, à cet homme extraordinaire qui, plein d’audace dans la conception, calme dans les projets les plus hardis, sut dans toutes les occasions devancer le succès. Son génie actif lui fit concevoir des plans qui étonnèrent ses ennemis, et les forcèrent de reconnaître en lui un des plus grands capitaines du siècle. Est-il un parti qui puisse refuser de lui payer le tribut d’éloges que tant de fois on a cru devoir à ses brillans travaux? Non sans doute: si Bonaparte, devenu chef d’un gouvernement, a commis des erreurs, ou des fautes, le temps en fera justice: les erreurs d’un homme qui s’éleva par son mérite jusqu’à se revêtir de la pourpre, ont toujours quelque chose de grand qui éclaire et frappe l’esprit humain, et qui, par cette raison, doivent servir de leçon aux siècles à venir().
Comme capitaine, peut-on lui contester ses brillans exploits, pourra-t-on jamais effacer son nom de la liste de ceux de nos plus illustres généraux, puisque tous furent appelés constamment à combattre sous ses yeux, et à exécuter les ordres qu’ils recevaient de celui qui les étonnait par la grandeur de ses vues; comme capitaine, qui cherchera à avilir ses trophées, puisqu’ils ont relevé l’éclat du nom français? Aussi le temps ne pourra qu’ajouter à sa gloire, en retraçant ses succès à nos neveux, qui auront peine à croire à la rapidité avec laquelle les événemens militaires se sont succédés sous cet invincible chef().
Nos guerriers, habitués à le suivre à la victoire, lui témoignaient la plus grande confiance. L’affection que Napoléon marquait à la garde ne pouvait rendre l’armée jalouse, puisque chacun des soldats qui la composaient avait l’espoir d’en faire partie. Cette perspective le portait à fixer l’attention de son chef; aussi, lorsqu’il fallait extraire des régimens de la ligne des hommes pour compléter ceux de la garde, le choix devenait extrêmement difficile; car tous étaient également dignes d’y figurer.
La vue de cette garde dans la capitale inspirait toujours une vive émotion. A la tenue la plus régulière, ces vieux soldats joignaient une conduite qui les faisait estimer de tous ceux qui avaient quelque rapport avec eux(): soumis à une discipline non-seulement sévère, mais quelquefois dure, aucun d’eux ne s’en plaignait, parce que, si la moindre faute était punie, une belle action ne restait jamais sans récompense.
L’intérieur de leurs casernes offrait l’image d’une nombreuse famille: la plus franche amitié régnait entre eux. Jamais la moindre offense, parce que tous étaient braves, et que les braves savent s’estimer. Cette garde abandonnait-elle la capitale pour se rendre à l’armée, là on la voyait chercher et braver les dangers avec un sang-froid digne des anciens Romains; on la voyait, l’arme au bras, recevoir le feu de l’ennemi sans faire le moindre mouvement; plus loin, forcer des retranchemens, monter à l’assaut, enlever des redoutes, et, par mille traits d’une valeur infatigable, décider du succès de mille batailles().
C’est par de tels exploits que cette garde, la terreur de l’ennemi, est devenue l’orgueil et l’admiration de la France. Elle s’était trop élevée pour que l’envie ne s’attachât point à ses pas. Des hommes aussi lâches que perfides, sans patrie, étrangers à l’honneur, se vantant chaque jour des actions d’éclat de leurs ancêtres, et incapables de les imiter, contestèrent à ces braves des braves la portion de gloire qu’ils payèrent de leur sang. Vous que l’on vit fuir sans avoir combattu, écoutez Marius dire aux grands de Rome: «Vous m’enviez ma
» gloire, enviez-moi donc aussi mes travaux,
» mes dangers, mes combats:
» enviez-moi le sang que j’ai versé pour
» la patrie!»
Ces mêmes hommes ont frappé d’anathème quelques-uns de ces soldats qui ont marqué des regrets en quittant les trois couleurs, parce que ces couleurs étaient celles de Napoléon. Étrange erreur! Depuis 90, elles étaient celles de la nation; Louis XVI lui-même les avait reconnues(). C’est sur l’assentiment de cet auguste chef que chaque militaire les accepta, en jurant de les défendre jusqu’à la mort. Il était permis à de vieux soldats, qui depuis vingt-quatre ans les avaient couvertes de lauriers, d’y donner quelques larmes, surtout ne croyant les quitter que par la seule volonté de nos ennemis qui nous imposèrent des conditions trop facilement acceptées, puisqu’elles devaient entraîner le licenciement d’une armée qui pouvait encore prouver à ces fiers étrangers qu’elle n’était pas vaincue.
On ne peut blâmer d’avoir fait reprendre à nos braves la couleur du panache de Henri IV; les faits d’armes de ce héros, surnommé à juste titre, le père du soldat et du peuple, méritent d’être placés près de ceux qui ont illustré notre patrie. Mais telles sont la force et la nature de l’esprit national que, si l’on eût maintenu l’étendard adopté depuis vingt-quatre ans, nos soldats auraient vu dans cette concession qu’on leur tenait compte de leurs nombreuses victoires. Le soldat français a l’âme fière: c’est en cherchant à lui contester ses succès, à briser les trophées de sa gloire, à lui ravir l’honneur pour lui plus cher que la vie, que l’on est parvenu à faire naître des regrets justement rendus, puisque chaque jour on ne craint pas de disputer à des hommes d’une valeur éprouvée, les droits qu’ils ont acquis à la reconnaissance de leurs concitoyens.
Parmi ces nombreux guerriers, le nom de Cambrone fera époque dans les annales militaires: digne émule de Bayard, ainsi que lui, il a mérité le surnom de sans peur et sans reproche. Moins heureux, il n’a pu éviter l’envie. Un parti qui ne rougit peint de professer hautement des sentimens tout autres que ceux de leur souverains(), a osé nier l’existence d’un fait qui immortalise la garde. Des journaux dignes interprètes de ces hommes qui ne peuvent souffrir ce qui se rattache à l’honneur de nos armes, ont, a près trois ans d’un silence absolu, démenti ces mots qui peignent si bien le caractère français, ces mots qui suivront Cambrone à la postérité : La garde meurt; elle ne se rend pas!!! Digne compagnon du brave Cambrone, généreux Berton, l’armée s’honore de compter parmi ses frères d’armes un général qui, par une défense aussi franche que loyale, s’est acquis de nouveaux droits à son estime.()
Cette vieille garde, si injustement humiliée, était loin de penser, lorsque les puissances rendaient un témoignage éclatant à sa valeur, qu’une horde de vampires lui réservait pour récompenses de ses nobles travaux, le mépris, les persécutions, l’indigence, et peut-être une mort obscure, loin de son pays.
On lui a fait un crime de sa fidélité , lorsqu’on ne devait lui donner que des éloges. Cette garde n’a jamais démenti par une conduite indigne d’elle, le caractère qui l’a guidée partout où il y avait de la gloire à acquérir: en un mot, elle ne fut fidèle qu’à l’honneur.
C’est en vain que, par d’insidieuses paroles, on a cherché à la flétrir pour avoir servi sous Napoléon. Elle a prouvé , en 1814, que, si l’on se fut conduit franchement avec elle, en ne soupçonnant pas sa loyauté , la France aurait vu autour du trône ses soldats en devenir les plus fermes soutiens. Mais laissons parler un de ces soldats sur leur retour à Paris, le 3 mai: sa noble franchise peindra mieux que nous ne pourrions l’exprimer, la conduite héroïque de cette vieille garde: «Le chef
» de l’état venait d’être nommé : Louis,
» en s’attachant à la cause de la nation,
» nous enchaînait à la sienne; aussi, lorsque
»le monarque français fit son entrée
» dans la capitale, plusieurs détachemens
» de notre garde lui servirent d’escorte.
» Les témoignages de satisfaction qu’on
» daigna partout prodiguer sur notre passage,
» nous assurèrent que la France nous
» trouvait encore dignes d’elle. Notre tenue
» triste et sévère convenait à notre
» situation: nous venions de quitter un
» chef qui nous avait toujours conduits à
» la victoire, et, pour la première fois, la
» la garde voyait ses ennemis sans les faire
» trembler.»
Ce passage subit d’un ordre de choses à un autre, avec une soumission qui n’a pas d’exemple dans l’histoire, devait être un sûr garant que cette garde serait fidèle au prince qui la rappelait près de lui. L’enthousiasme que fit éclater le peuple, lorsqu’il revit ces vieux défenseurs, couverts de blessures à peine cicatrisées, faire partie du cortége, devait, je le répète, leur servir de garantie, et les préserver pour l’avenir de toute espèce de calomnie; cependant on a vu, à la honte de leurs auteurs, des écrits dictés par la passion la plus effrenée; des hommes, faisant abnégation de tout sentiment d’honneur, donner le nom de BRIGANDS à ces soldats qui, de tout temps furent dévoués à la gloire de leur pays, à ces soldats qui, marchant à l’ennemi, guidés par d’invincibles chefs, n’aspiraient qu’à l’honneur, n’avaient qu’un seul but en combattant, celui d’assurer la prospérité de la France.
Mais pourquoi chercher à justifier nos généraux et leurs dignes soldats? Les lauriers qu’ils cueillirent à Marengo, à Austerlitz, à Jéna, à Friedland, à Eylau, à Wagram, à la Moscowa, à Bautzen, à Craonne, au Mont-St.-Jean, oui au Mont-Saint-Jean, car ils n’y furent pas vaincus, sont autant de boucliers où viennent se briser les traits lancés par l’Envie, jalouse d’une gloire sans tache.
Magnanimes soldats, reposez-vous sur le temps. Lui seul fait juger les hommes, et leur assigne la place qu’ils doivent occuper dans l’histoire; il détruit les prétentions, relève les erreurs, et force d’admirer après leur mort ceux que la haine et l’esprit de parti avaient cherché à flétrir de leur vivant: le temps, en découvrant la vérité, fait honorer le génie des hommes illustres que leur siècle a méconnus: le temps, confondant toutes les classes, n’admet de différence entre les grands et les plébéiens que celles établies par les talens et les vertus.
Tel on voit le phénix renaître de sa cendre, tels, Français, nous verrons nos guerriers renaître de leur gloire.