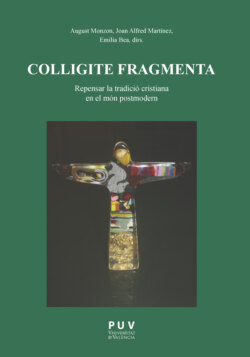Читать книгу Colligite Fragmenta - AA.VV - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLES GRANDES RELIGIONS AVEC, APRES OU CONTRE LA MODERNITE[1]
Jean-Louis Schlegel
Consell de redacció de la revista Esprit (París)
Le sujet de mon intervention a un grand avantage et un grand inconvénient. L’avantage, c’est que je n’ai pas eu besoin de chercher une construction: elle est déjà là, en trois parties, comme dans une bonne dissertation classique. Mais je me permettrai de changer un peu l’ordre du titre, en traitant d’abord «les religions avec», puis «les religions contre», et enfin «les religions après» la modernité. Mais mon sujet a aussi un grand inconvénient: il est immense, presque sans limites. Il me faut donc préciser ses frontières: je vais parler surtout du christianisme, et je retiendrai seulement ce qui me paraît pertinent dans notre sujet pour le judaïsme et l’islam, ainsi que pour les religions de l’Asie. Toutes les religions du monde ont un rapport complexe, et une histoire compliquée avec l’Occident et avec la modernité, et d’un autre côté, la civilisation occidentale, si on peut parler ainsi, et la modernité ont un rapport complexe, mais central avec le christianisme.
Chaque religion est un continent, au propre et au figuré. Mais ce qu’on appelle les temps modernes fait aussi l’objet de nombreuses discussions. Je me concentrerai sur un point: il y a une dialectique de la modernité, un conflit interne dans la raison moderne elle-même, dont, au XXe siècle, l’Ecole de Francfort en particulier a tenté de rendre compte. On pourrait exprimer ce conflit ainsi: à mesure qu’elle avance dans la conquête et la maîtrise de la nature et de l’histoire comme liberté, la raison moderne s’est révélé aussi comme une raison instrumentale, une raison qui a aussi une face obscure de déraison, une raison finalement destructrice, et donc décevante par rapport à ses promesses. Le monde qu’elle crée –avec la démocratie et les libertés politique, les avancées sociales en faveur de l’égalité et de la justice, la technologie qui transforme les conditions du vivre ensemble–, le monde moderne donc crée de nouvelles aliénations, de nouvelles souffrances individuelles et sociales. Le socialisme n’a pas plus apporté l’émancipation que le marché capitaliste. Par rapport au moment où Horkheimer, Adorno et leurs collègues de l’Ecole de Francfort écrivaient leurs analyses, des années 30 aux années 60, on peut dire, au moins selon une certaine vision des choses, que la globalisation, ou la mondialisation libérale, a encore accentué quantitativement et qualitativement la présence de ce que Marcuse avait appelé l’Homme unidimensionnel.
Je n’insiste pas, il y aurait d’autres analyses possibles de la réalité moderne contrastée. Par exemple, Max Weber déjà, à travers la célèbre image de la «cage d’acier», évoquait la perte de sens et la perte de liberté qui frappe les individus modernes marqués par la séparation et la «rationalisation» des sphères de la vie moderne. D’autres analyses du moderne –je pense par exemple au sociologue américain Christopher Lasch– ont insisté les contradictions profondes de l’individualisme moderne ou post-moderne. Plus personne ne peut croire à un «progrès» linéaire, comme on le pensait au XIXe et encore au XXe siècle. Or, dans leur attitude face à la modernité, les grandes religions du monde –qui sont aussi des civilisations (c’est le rappel le plus important de la thèse de Huntington sur le «choc des civilisations»)– sont forcément influencées par la dialectique de l’Aufklärung. Elles peuvent en adopter, au moins dans des limites, le côté conquérant et sûr de lui, les «avancées» comme le prétendent les gens de progrès. Elles peuvent aussi rejeter cette modernité comme néfaste, destructrice pour les religions, certains estimant même que modernité et religions sont irréconciliables, et donc que la première doit être combattue par les secondes. Dans la troisième partie, je reprendrai avec plus de distance sociologique la question des «religions après la modernité».
1. LES RELIGIONS AVEC LA MODERNITÉ
Je fais allusion ici aux efforts des grandes religions pour être à la hauteur du monde, pour s’y «adapter», selon les dires de certains. Comme vous le savez, à partir de l’Aufklärung et de la Révolution française, c’est une histoire conflictuelle qui s’ouvre d’abord, à la fois au niveau intellectuel et pratique (et il y a lieu de distinguer fortement la confrontation intellectuelle et l’adaptation pratique, appelée aussi «sécularisation»). De façon très schématique, on pourrait dire qu’au temps des Lumières et encore après, il n’y a pas de dialogue possible: d’un côté, les philosophes, dont beaucoup restent croyants, ne voient plus de salut dans les religions révélées et leurs Ecritures, qui apparaissent comme un fatras d’inepties et un tissu d’incohérences, de surcroît intolérantes; le personnage de Jésus, les dogmes sur le Christ lui-même ne leur parlent plus. Par rapport à la Raison universelle, toutes les révélations sont particulières, et à ce titre dangereuses quand elles prétendent régenter les consciences. L’Eglise catholique est en première ligne dans ces critiques, pour des raisons théologico-politiques évidentes, mais les Eglises de la Réforme n’y échappent pas. D’autre part, ceux qu’on appelle les «Libertins» anticipent dès le XVIe siècle une attitude d’émancipation morale par rapport au rigorisme catholique et protestant. L’intolérance des Eglises, appuyée sur le pouvoir politique, accentue encore ce phénomène.
Ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle qu’il y a une prise de conscience religieuse de la modernité. Le grand nom est Schleiermacher, mais on pourrait y ajouter Kant, Hegel et d’autres, aussi les Romantiques finalement. La meilleure façon de comprendre la nouveauté de ces théologiens et philosophes consiste peut-être à dire ceci: ils posent la question du sens de l’existence dans la modernité, et de la traduction de la théologie voire de Dieu dans le langage de la modernité. Ceux qu’on appelle les «théologiens libéraux» du XIXe siècle ne font pas autre chose, d’autant plus qu’ils sont interrogés ou stimulés par la recherche historico-critique très provocante sur la Bible. Je passe ensuite sur la longue histoire, protestante et catholique, de résistance et de soumission, comme dit Dietrich Bonhoeffer, jusqu’au XXe siècle et même, pour l’Eglise catholique, jusqu’à la seconde partie du XXe siècle, avec l’aggiornamento et la réconciliation qu’a représenté le Concile Vatican II. Il faudrait parler ici non seulement de toutes les réflexions de théologie et de spiritualité qui ont dialogué implicitement ou explicitement avec la modernité, mais aussi de toutes les actions «sur le terrain», où les croyants chrétiens participent avec d’autres hommes, agnostiques, non croyants ou athées déclarés, à la construction de la Cité terrestre.
Une partie de l’histoire du christianisme moderne est donc celle de la réconciliation et de la conciliation avec la modernité des Lumières, on pourrait presque dire: avec le premier moment de la dialectique de la modernité, avec ses espérances démesurées de maîtrise de la nature et de l’histoire. Je pourrais l’exprimer avec l’expression du Père de Lubac: c’est une discussion avec l’«humanisme athée», à la fois intellectuel et pratique. Il est frappant, en tout cas pour le Français que je suis, de voir que presque simultanément, après la Seconde Guerre Mondiale, Jean Paul Sartre, Henri Lefebvre et Jacques Maritain ont élevé la prétention que l’existentialisme, le marxisme et le christianisme étaient un humanisme. Et cela veut dire dans le cas de Maritain –il n’était pas le seul– qu’il voulait élever le christianisme à la hauteur de l’humanisme non pas du XVIe siècle, mais du XXe siècle. On pourrait en dire autant de Teilhard de Chardin ou de Mounier. D’une certaine manière, Teilhard, même s’il a été seulement accueilli au Concile Vatican II, symbolisa sinon la réconciliation, du moins le dialogue, avec les sciences de la nature moderne. Il essaie de construire une formulation théologique qui soit acceptable après une découverte particulièrement difficile à concilier avec la tradition chrétienne de la Création: celle de l’évolution. De son côté, Emmanuel Mounier est le philosophe de l’engagement chrétien dans le monde moderne: pour plusieurs générations de militants, en France et dans divers pays du monde, Mounier signifie que la chrétienté est finie et qu’il faut s’engager dans la cité politique moderne qui n’est plus chrétienne, où il y a du «désordre» mais où il y a aussi à construire. Nous avons l’impression aujourd’hui que Mounier a été trop sensible aux désordres de la démocratie bourgeoise, ou qu’il était plus sensible aux désordres qu’aux avantages de la démocratie, mais peu importe. Comme Unamuno finalement, Mounier pense qu’il y a une «agonie» au double sens d’une fin du christianisme comme chrétienté, mais aussi un combat spirituel possible du chrétien pour rendre la Cité humaine plus ordonnée, plus juste. Ce faisant, il est peut-être moins attentif que les théologiens protestants, Karl Barth y compris, à la crise que représente la sécularisation, ou la culture sécularisée, pour le christianisme et la foi.
Il faudrait évoquer ici les autres religions, mais ce serait trop long. On peut au moins rappeler que quand les juifs accèdent à la modernité, à partir de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, cette modernité imaginée au XVIIIe siècle par Mosès Mendelsohn va se traduire de plus en plus par l’assimilation, que ce soit par l’entrée remarquable dans la modernité scientifique et rationaliste, ou par le baptême. Les juifs participeront plus d’une fois, là où ils sont, aux nationalismes européens. En France, à la fin du XIXe et dans la première moitié du XXe siècle, ils seront, sous l’appellation d’«Israélite» (qui est pratiquement abandonné aujourd’hui), de véritables piliers de la République laïque. Je rappelle aussi que les juifs sécularisés ou assimilés ont été présents en grande quantité dans le mouvement socialiste au sens large, que ce soit dans l’internationale socialiste, dans la Révolution bolchévique ou encore dans l’engagement marxiste.
Pour l’islam, il faudrait parler des «réformistes», c’est-à-dire de ceux qui ont tenté de penser un islam compatible avec les idées de la modernité éclairée. La Nahda, le mouvement de réforme du XIXe siècle, fait l’objet d’appréciations diverses aujourd’hui; il y a des jugements parfois sévères parce que, dit-on, les «réformateurs», quand on y regarde bien, restaient finalement très traditionnels. Je crois quand même que les tentatives de réforme de l’islam ont été des tentatives intéressantes pour rejoindre la modernité des Lumières, donc toujours ce premier moment «éclairé», sûr de lui et conquérant de la modernité.
2. LES RELIGIONS CONTRE LA MODERNITÉ
Les religions ont résisté diversement à la modernité. Comme chacun le sait, le catholicisme a été en première ligne dans la critique des philosophes des Lumières, mais le protestantisme, en Angleterre surtout, n’a pas été épargné. Il me semble surtout qu’il faut tenir compte de la grande coupure qu’a représenté la Révolution française. À cause des épisodes de conflit très violents qu’ont représenté en 1790 la Constitution civile du Clergé, les «massacres de septembre» 1792 (1300 prisonniers religieux, hommes et femmes, tués à l’arme blanche dans les prisons de Paris) et enfin les tentatives de déchristianisation en 1793-94, à quoi il faudrait ajouter la Terreur, c’est-à-dire la Révolution se dévorant elle-même, la mémoire de la Révolution française est restée double. Pour les peuples opprimés, elle peut être le symbole de toutes les libérations et de toutes les émancipations, le symbole du «pays des droits de l’homme», comme on aime le rappeler en France. Mais le cours de la Révolution explique que l’Eglise romaine entière se soit retrouvée contre-révolutionnaire. Il explique le retard de l’Eglise catholique dans la perception des droits de l’homme et des droits de la conscience, ainsi que des libertés et de l’égalité. L’Eglise catholique du XIXe siècle est intransigeante et intégraliste: intransigeante par rapport aux libertés des modernes en général, et intégraliste en refusant toute autonomie aux réalités humaines. Toute la vie, publique et privée, des croyants doit intégrer la foi, mettre en œuvre les principes de la foi. Le document antimoderne par excellence sera le célèbre Syllabus –une liste des erreurs modernes en 80 articles, publiée par Pie IX en 1864– et qu’on peut résumer avec l’article 80, le dernier: «Ceux qui pensent que le Pontife Romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne sont anathèmes». On peut commenter à bon droit les tenants et les aboutissants de cette déclaration, on peut la resituer dans une histoire: elle n’en reste pas moins le symbole du refus par l’Eglise, et finalement par les religions, de la raison moderne. Ce refus se concrétise dans l’idée de créer une sorte de contre-société, de contre révolution sociale et politique, de restaurer l’Ancien Régime. L’idée que l’Etat et la religion puissent être séparés est restée longtemps inconcevable en pays catholique, alors que dans les pays anglo-saxons et dans beaucoup d’autres pays la séparation du religieux et du politique s’amorce déjà très fortement dès le XIXe siècle. Disons que d’une façon générale, l’Eglise veut continuer à régenter la vie publique, avec l’idée sincère qu’une «société sans Dieu» serait une société anarchique et qu’elle s’écroulerait. Il y a évidemment des aspects apocalyptiques dans cette vision de l’histoire et dans ce pessimisme envers les temps modernes.
On pourrait dire que le Concile Vatican II, là encore, a fermé la période de la réaction intégraliste –intransigeante de l’Eglise catholique. Auparavant déjà, dans les pays libres et démocratiques d’Europe en tout cas, l’Eglise avait dû accepter de gré ou de force la séparation, ou des formes de séparation, avec l’Etat. Au Concile Vatican II, elle a semblé admettre l’autonomie des Modernes à travers le thème de l’«autonomie des réalités terrestres»: dans la vie publique, le chrétien pouvait faire librement ses choix démocratiques; dans la vie privée, il pouvait envisager de prendre ses responsabilités sur certains points. Mais très vite après le Concile, la position intransigeante s’est réaffirmée pour la conduite de la vie privée, sur laquelle l’Eglise catholique tient un discours normatif très important, un discours qui s’apparente à un rigorisme moral dans les domaines de la bioéthique et de la vie sexuelle et conjugale. Mais ces positions sur la vie privée ont des incidences publiques dans la mesure où l’Eglise catholique prétend influer sur les législations qui accordent de nouvelles libertés aux individus. Tous les pays démocratiques sont sollicités pour autoriser et ont déjà autorisé des «lois qui permettent» (et non pas des «lois permissives», comme on le dit vite) et qui contredisent la norme morale de l’Eglise catholique. Celle est parfois accusée d’un «fondamentalisme catholique» spécifique, fondé sur une fidélité littérale, pour ainsi dire, à la Tradition (plus qu’à l’Ecriture). Ce discours rigoriste, qui s’oppose fortement aux valeurs «libertaires» des sociétés actuelles, rejoint pourtant des courants traditionnalistes (je ne dis pas intégristes), très fortement identifiés au pape et à «Rome», parfois contre les Eglises locales ou contre les conférences épiscopales, mais en ajoutant que ce que je viens de dire pose la question bien connue: Vatican II a-t-il été une simple éclaircie «libérale» pour une Eglise catholique qui serait par essence intransigeante et intégraliste?
L’évocation d’un fondamentalisme catholique m’amène tout naturellement au protestantisme. La réaction protestante à la modernité a été et reste avant tout le fondamentalisme biblique, depuis la fin du XIXe siècle environ. Et ceci pour des raisons intrinsèques. N’a-t-on pas dit que dans le principe de la sola scriptura et de la sola fides du XVIe siècle, il y avait déjà un trait fondamentaliste? Quoi qu’il en soit, la recherche historique et critique sur la Bible, au XIXe siècle, a eu pour effet la critique du miracle. Il y a eu d’autres conséquences, mais celle-là est centrale. Pour des esprits scientifiques, le miracle, exception aux lois de la nature, pose au minimum une question, quand il n’est pas tout simplement exclu. Or La Bible, et le Nouveau Testament en particulier, regorgent de miracles. Lors de la crise moderniste dans le catholicisme au début du XXe siècle, il n’est en tout cas pas étonnant que la figure principale qui sera visée par les condamnations romaines soit Alfred Loisy, un exégète et un spécialiste du christianisme primitif. Mais dans le protestantisme, c’est un mouvement de «protestation» à la base qui se développe à la fin du XIXe siècle, aux Etats-Unis surtout, pour sauver les «fondamentaux» de la Bible. La Bible, est-il rappelé, est «Parole de Dieu» et non parole humaine. Les fondamentalistes accentuent les aspects littéraux voire «miraculeux» du texte, considéré comme écrit par le doigt de Dieu. Et eux aussi auront des prétentions politiques, puisqu’ils tentent d’imposer dans l’enseignement public leurs théories, celle du créationnisme par exemple. Comme on le sait, un refus leur fut opposé en 1926, ensuite ils disparurent un peu de la scène publique, mais depuis les années 1970, ils ont de nouveau le vent en poupe et marquent fortement la vie politique américaine, de la base jusqu’au sommet.
Je dirai ici encore juste un mot de l’islam et du judaïsme. Le refus de la modernité par l’islam se traduit par un fondamentalisme très puissant. L’islam wahhabite, celui d’Arabie Saoudite, a déteint sur tous les pays d’islam et fait dériver tout le continent musulman vers un rigorisme qui ne laisse pratiquement plus de place aux réformes intérieures de l’islam –je veux dire que les adaptations qui peuvent se faire se font contraintes et forcées (je pense par exemple à quelques libertés accordées aux femmes). Enfin, dans le judaïsme de la deuxième moitié du XXe siècle, on constate un mouvement très net vers l’orthodoxie ou l’ultra-orthodoxie. Mais l’analyse du judaïsme dans la modernité est compliquée par la Shoah. Au moins pour les juifs ashkénazes originaires d’Europe, c’est sans doute un filtre plus important que la seule modernité pour comprendre leur devenir récent. Je rappelle d’ailleurs que certaines analyses, par exemple en France celles de Shmuel Trigano, relient la Shoah et la modernité, la seconde étant considérée comme une cause importante de la première.
3. LES RELIGIONS APRÈS LA MODERNITÉ
J’ai tenté de décrire l’attitude des religions –surtout du christianisme et très brièvement du judaïsme et de l’islam– face à la modernité, mais les religions étant chaque fois particulières (c’est justement un thème des Lumières!), c’est aussi un regard particulier. Si on regarde le problème de l’autre côté, à partir de la modernité, donc au-delà des religions particulières, on peut avoir une évaluation plus englobante. D’abord, j’aurais parlé plutôt de sécularisation, que je n’ai fait qu’évoquer. Quels que soient les débats sociologiques sur le sens et la validité de ce concept, on peut être d’accord sur le fait que la modernité signifie un recul social des religions, voir une sortie sociale de la religion (Marcel Gauchet): sortie de l’image religieuse du monde, rationalisation et spécialisation des domaines, séparation, en particulier, du religieux et du politique (mais le mot «séparation» en général pourrait être compris comme un quasi-synonyme du mot «modernité»). Il faut bien le reconnaître. Malgré tous les efforts de la foi, et en particulier les efforts chrétiens ou pour s’opposer à la modernité, ou pour relever le défi de la modernité, ou pour dialoguer de manière constructive avec la modernité, le résultat deux siècles après est décevant pour les grandes confessions de la tradition chrétienne. En particulier, elles semblent toujours agir avec un «temps de retard» sur l’événement. L’exemple le plus éclatant, pour moi, est justement le Concile Vatican II. Au concile, l’Eglise catholique tente de faire son aggiornamento, de dialoguer et de se réconcilier avec les «hommes de ce temps», comme le dit la Constitution Gaudium et Spes. Mais elle le fait quand la modernité entre en crise et quand s’installe très vite ce qu’on appelle la «postmodernité». Il y a beaucoup de définition du «post-moderne», mais on pourrait dire que si la modernité signifie le «désenchantement du monde», selon l’expression de Max Weber, la postmodernité est «le désenchantement du désenchantement», ou un «désenchantement second qui achève le premier». «Ce qui expliquerait que dans un paysage d’incertitude généralisée les questions religieuses puissent occuper une place centrale et qu’à l’enseigne du postmoderne on puisse ranger à la fois le ‘retour de Dieu’ et la ‘mort de Dieu’, à la fois l’allégresse un peu forcée des nouvelles religiosités et le pessimisme esthétisant du nihilisme».[2] Je suis obligé de résumer ce tournant de la sécularisation postmoderne, qui est aussi un tournant pour les religions, en cinq points.
• La postmodernité lève d’abord un doute sur le sens de la sécularisation. Elle oblige à en complexifier l’analyse: la sécularisation ne signifie pas exclusivement recul, perte, sortie…, mais fragmentation, pluralisation, éparpillement, dissémination du religieux. Les religions de la tradition historique peuvent rester très majoritaires numériquement, elles peuvent garder une immense place dans la culture, mais elles n’en perdent pas moins «le monopole du religieux», elles cessent d’être le seul religieux légitime. C’est évidemment encore plus sensible dans les pays (et ils sont nombreux) où une religion historique a été longtemps majoritaire et seule légitime. Mais ce n’est pas seulement d’une pluralisation externe qu’il est question. On assiste aussi à une pluralisation interne, à un «éclatement» (Michel de Certeau), qu’aucune autorité ni aucun dogme ne peuvent contenir, car les sociétés démocratiques postmodernes ont aussi développé un considérable individualisme, une propension au choix personnel de la conscience en fonction de critères personnels de réalisation, de désirs d’autonomie accrue… (cet individualisme post-moderne est lui-même très discuté: pour faire bref, est-ce un nouvel «humanisme» ou un «déclin» des démocraties fatiguées?). Quoi qu’il en soit, les choix religieux sont nombreux, les appartenances sont multiples, les passages sont nombreux, et ils sont sans doute accentués par la mondialisation ou par les possibilités nouvelles de communication réelle ou virtuelle.
• Cette pluralisation n’est pas contradictoire avec une réaffirmation des identités religieuses, celles-ci pouvant prendre différentes colorations: identités «sectaires», «intégristes», «radicales» pourrait-on dire, ou seulement identification plus forte par retour à des traditions rituelles par exemple, des pratiques de dévotion qu’on croyait révolues, aussi par des résistances morales à la société ou à des législations perçues comme inacceptables moralement, non conformes à la tradition religieuse. Alors que certains défis de la raison moderne semblaient en voie de règlement pour ainsi dire, la liberté des postmodernes effraie, terrorise même certains esprits religieux. Comme au XIXe siècle, s’exprime l’idée que les sociétés livrées à l’anarchie des comportements éthiques personnels (permis par la loi) vont s’écrouler. Pour certains postmodernes, en particulier laïques, ces peurs sont non seulement imaginaires, mais elles cachent surtout le désir politique des religions de régenter la société, de maintenir leur pouvoir politico-religieux, ou leur primauté comme instance éthique. Si on se place aux dimensions du monde, on pourrait ajouter que la globalisation qui d’un côté détruit les identités ou des traditions culturelles de toutes sortes provoque et conforte au contraire des identités ou des réidentifications religieuses. Ou encore, pour reprendre les analyses d’Olivier Roy,[3] la globalisation accélère la disjonction entre cultures/territoires et foi religieuse: la «foi pure», sans culture, augmente et s’affirme partout.
• Cette dernière remarque attire l’attention sur un point important: la nouvelle visibilité, ou la visibilité accrue des religions dans l’espace public. Je sais bien que le cas de la France est particulier, et qu’il faut faire la part de l’histoire politique de chaque pays. Mais il se peut que dans la période précédente de confrontation avec la modernité, il y ait eu parfois une retenue, ou une prudence, dans l’affirmation ou l’affichage public des convictions; au contraire, on assiste aujourd’hui à des manifestations plus fortes de visibilité dans l’espace public où toutes les paroles sont permises. Les groupes religieux aussi veulent avoir leur place, leur mot à dire, pouvoir témoigner ouvertement de convictions. Ceux qui ne sont pas voix au chapitre dans nos sociétés postmodernes parlent volontiers de discriminations, d’atteinte à l’égalité des droits.
• Mais cette dernière remarque doit être nuancée, car les groupes et les individus non religieux –incroyants, agnostiques– ou encore les individus et les groupes laïques affirment tout aussi fortement leurs droits à la non discrimination, à la «liberté religieuse». D’où les procès divers en cours dans divers pays européens, par exemple à propos des signes religieux dans l’espace public (les croix par exemple, ou l’habit religieux dans les espaces publics de l’Etat). Il faut remarquer cependant que les «incroyants» ou les «laïques» ne forment pas un seul bloc. Ils aussi sont pluriels, ou pluralisés. En outre, la tradition politique laïque, là où elle existe, se heurte elle aussi à une sorte de sécularisation postmoderne de la laïcité, à une laïcisation de la laïcité idéologique, et on assiste alors à des phénomènes similaires à ceux des religions: ignorance du passé et phénomènes identitaires. En France, on évoque même un «intégrisme» laïque, représenté par exemple par une interprétation très dure de la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat et par la renaissance d’une laïcité de combat.
• Un dernier point: le mot «religion» est devenu parfois, en France en tout cas, péjoratif. Beaucoup d’individus préfèrent parler de «spiritualité». Ils peuvent encore appartenir formellement aux groupes religieux historiques, mais aussi en être détachés. L’insistance est alors mise sur les expériences religieuses, sur les ressources «énergétiques» en quelque sorte, ou les ressources de sens, qu’offrent les traditions religieuses les plus diverses, y compris et parfois surtout celles de l’Asie, mais aussi les textes mystiques des traditions monothéistes. Là où les spiritualités sont évidemment en lien très fort avec certains aspects de la postmodernité, en particulier avec l’individualisme postmoderne, la vie pratique. Les spiritualités ont leur correspondant dans les sagesses pratiques sans Dieu, les sagesses philosophiques, qui sont proposées par des auteurs à succès dans divers pays.
Je termine en m’excusant du côté panoramique de ce survol, qui pose sans doute plus de questions qu’il ne donne de réponses. Un exposé plus circonstancié aurait permis de mieux justifier certaines affirmations, de présenter mieux la discussion sociologique actuelle. On aurait aussi pu mieux contrôler ou vérifier certains arguments en prenant des exemples actuels. D’innombrables questions restent en suspens: le devenir de l’islam, l’évolution et le rôle du fondamentalisme protestant dans le monde entier, l’avenir, dans les décennies qui viennent, du catholicisme en Europe, le poids des religions dans les sociétés et dans la politique.
Cette question de l’avenir est inévitable, mais elle demeure toujours risquée. Il y a eu beaucoup de prophéties au XXe siècle sur l’avenir de la religion au XXIe, mais beaucoup de prédictions se sont révélées fausses, ou très partielles. J’ai au mieux des hypothèses personnelles, mais je préfère les garder pour moi, en vous priant d’excuser ma prudence.
Notes:
[1] Ponència llegida el 18 d’octubre de 2011 al IV Congrés d’Estudis Personalistes «Colligite Fragmenta. Repensar la tradició cristiana en el món postmodern».
[2] Robert Scholtus, Esprit, juin 1997, p. 79.
[3] Olivier Roy, La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture, Paris, Seuil, 2008.