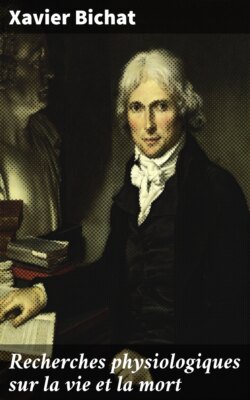Читать книгу Recherches physiologiques sur la vie et la mort - Bichat Xavier - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеARTICLE QUATRIÈME.
Table des matières
Différences générales des deux vies, par rapport à la durée de leur action.
Je viens d’indiquer un des grands caractères qui distinguent les phénomènes de la vie animale d’avec ceux de la vie organique. Celui que je vais examiner n’est pas, je crois, d’une moindre importance; il consiste dans l’intermittence périodique des fonctions externes, et la continuité non interrompue des fonctions internes.
§ I. Continuité d’action dans la vie organique.
Table des matières
La cause qui suspend la respiration et la circulation, suspend et même anéantit la vie, pour peu qu’elle soit prolongée. Toutes les sécrétions s’opèrent sans interruption, et si quelques périodes de rémitence s’y observent, comme dans la bile, hors le temps de la digestion, dans la salive, hors celui de la mastication, etc. ces périodes ne portent que sur l’intensité et non sur l’entier exercice de la fonction. L’exhalation et l’absorption se succèdent sans cesse; jamais la nutrition ne reste inactive, le double mouvement d’assimilation et de désassimilation dont elle résulte, n’a de terme que celui de la vie.
Dans cet enchaînement continu des phénomènes organiques, chaque fonction est dans une dépendance immédiate de celles qui la précèdent. Centre de toutes, la circulation est toujours immédiatement liée à leur exercice; si elle est troublée, les autres languissent; elles cessent quand le sang est immobile. Tels dans leurs mouvemens successifs, les nombreux rouages de l’horloge s’arrêtent-ils dès que le pendule qui les met tous en jeu, est lui-même arrêté. Non-seulement l’action générale de la vie organique est liée à l’action particulière du cœur, mais encore chaque fonction s’enchaîne isolément à toutes les autres: sans sécrétion, point de digestion; sans exhalation, nulle absorption; sans digestion, défaut de nutrition.
Nous pouvons donc, je crois, indiquer comme caractère général des fonctions organiques, leur continuité et la mutuelle dépendance ou elles sont les unes des autres.
§ II. Intermittence d’action dans la vie animale.
Table des matières
Considérez, au contraire, chaque organe de la vie animale dans l’exercice de ses fonctions, vous y verrez constamment des alternatives d’activité et de repos, des intermittences complètes, et non des rémittences comme celles qu’on remarque dans quelques phénomènes organiques.
Chaque sens fatigué par de longues sensations, devient momentanément impropre à eu recevoir de nouvelles. L’oreille n’est point excitée par les sons, l’œil se ferme à la lumière, les saveurs n’irritent plus la langue, les odeurs trouvent la pituitaire insensible, le toucher devient obtus, par la seule raison que les fonctions respectives de ces divers organes se sont exercées quelque temps.
Fatigué par l’exercice continué de la perception, de l’imagination, de la mémoire ou de la méditation, le cerveau a besoin de reprendre, par une absence d’action proportionnée à la durée d’activité qui a précédé, des forces sans lesquelles il ne pourroit redevenir actif.
Tout muscle qui s’est fortement contracté, ne se prête à de nouvelles contractions, qu’après être resté un certain temps dans le relâchement. De là les intermittences nécessaires de la locomotion et de la voix.
Tel est donc le caractère propre à chaque organe de la vie animale, qu’il cesse d’agir par-là même qu’il s’est exercé , parce qu’alors il se fatigue, et que ses forces épuisées ont besoin de se renouveler.
L’intermittence de la vie animale est tantôt partielle, tantôt générale: elle est partielle quand un organe isolé a été long-temps en exercice, les autres restant inactifs. Alors cet organe se relâche; il dort tandis que tous les autres veillent. Voilà sans doute pourquoi chaque fonction animale n’est pas dans une dépendance immédiate des autres, comme nous l’avons observé dans la vie organique. Les sens étant fermés aux sensations, l’action du cerveau peut subsister encore; la mémoire, l’imagination, la réflexion y restent souvent. La locomotion et la voix peuvent alors continuer aussi; celles-ci étant interrompues, les sens reçoivent également les impressions externes.
L’animal est maître de fatiguer isolément telle ou telle partie. Chacune devoit donc pouvoir se relâcher, et par-là même réparer ses forces d’une manière isolée: c’est le sommeil partiel des organes.
§ III. Application de la loi d’intermittence d’action à la théorie du sommeil.
Table des matières
Le sommeil général est l’ensemble des sommeils particuliers; il dérive de cette loi de la vie animale qui enchaîne constamment dans ses fonctions, des temps d’intermittence aux périodes d’activité, loi qui la distingue d’une manière spéciale, comme nous l’avons vu, d’avec la vie organique: aussi le sommeil n’a-t-il jamais sur celle-ci qu’une influence indirecte, tandis qu’il porte tout entier sur la première.
De nombreuses variétés se remarquent dans cet état périodique auquel sont soumis tous les animaux, Le sommeil le plus complet est celui où toute la vie externe, les sensations, la perception, l’imagination, la mémoire, le jugement, la locomotion et la voix sont suspendus: le moins parfait n’affecte qu’un organe isolé ; c’est celui dont nous parlions tout à l’heure.
Entre ces deux extrêmes, de nombreux intermédiaires se rencontrent: tantôt les sensations, la perception, la locomotion et la voix, sont seules suspendues, l’imagination, la mémoire, le jugement restant en exercice; tantôt, à l’exercice de ces facultés qui subsistent, se joint aussi l’exercice de la locomotion et de la voix. C’est là le sommeil qu’agitent les rêves, lesquels ne sont autre chose qu’une portion de la vie animale, échappée à l’engourdissement où l’autre portion est plongée.
Quelquefois même trois ou quatre sens seulement ont cessé leur communication avec les objets extérieurs: telle est cette espèce de somnambulisme où, à l’action conservée du cerveau, des muscles et du larynx, s’unit celle souvent très-distincte de l’ouïe et du tact.
N’envisageons donc point le sommeil comme un état constant et invariable dans ses phénomènes. A peine dormons-nous deux fois de suite de la même manière; une foule de causes le modifient en appliquant à une portion plus ou moins grande de la vie animale, la loi générale de l’intermittence d’action. Ses degrés divers doivent se marquer par les fonctions diverses que cette intermittence frappe.
Le principe est par-tout le même, depuis le simple relâchement qui dans un muscle volontaire succède à la contraction, jusqu’à l’entière suspension de la vie animale. Par-tout le sommeil tient à cette loi générale d’intermittence, caractère exclusif de cette vie; mais son application aux différentes fonctions externes varie infiniment.
Il y a loin sans doute de ces idées sur le sommeil, à tous ces systèmes rétrécis où sa cause, exclusivement placée dans le cerveau, le cœur, les gros vaisseaux, l’estomac, etc. présente un phénomène isolé, souvent illusoire, comme base d’une des grandes modifications de la vie.
Pourquoi la lumière et les ténèbres sont-elles, dans l’ordre naturel, régulièrement coordonnées à l’activité et à l’intermittence des fonctions externes? C’est que, pendant le jour, mille moyens d’excitation entourent l’animal, mille causes épuisent les forces de ses organes sensitifs et locomoteurs, déterminent leur lassitude, et préparent un relâchement que la nuit favorise par l’absence de tous les genres de stimulans. Aussi dans nos mœurs actuelles, où cet ordre est en partie interverti, nous rassemblons autour de nous, pendant les ténèbres, divers excitans qui prolongent la veille, et font coïncider avec les premières heures de la lumière, l’intermittence de la vie animale, que nous favorisons d’ailleurs en éloignant du lieu de notre repos tout moyen propre à faire naître des sensations.
Nous pouvons, pendant un certain temps, soustraire les organes de la vie animale à la loi d’intermittence, en multipliant autour d’eux les causes d’excitation; mais enfin ils la subissent, et rien ne peut, à une certaine époque, en suspendre l’influence. Épuisés par une veille prolongée, le soldat dort à côté du canon, l’esclave sous les verges qui le frappent, le criminel au milieu des tourmens de la question, etc. etc.
Distinguons bien, au reste, le sommeil naturel, suite de la lassitude des organes, de celui qui est l’effet d’une affection du cerveau, de l’apoplexie ou de la commotion, par exemple. Ici les sens veillent, ils reçoivent les impressions, ils sont affectés comme à l’ordinaire; mais ces impressions ne pouvant être perçues par le cerveau malade, nous ne saurions en avoir la conscience. Au contraire, dans l’état ordinaire, c’est sur les sens, autant et même plus que sur le cerveau, que porte l’intermittence d’action.
Il suit de ce que nous avons dit dans cet article, que, par sa nature, la vie organique dure beaucoup plus que la vie animale. En effet, la somme des périodes d’intermittence de celle-ci est presque à celle de ses temps d’activité, dans la proportion de la moitié ; en sorte que sous ce rapport nous vivons au dedans presque le double de ce que nous existons au dehors.