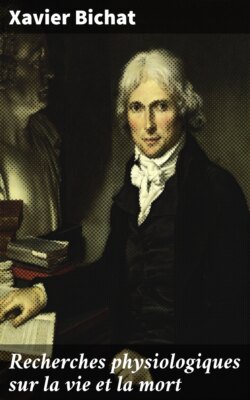Читать книгу Recherches physiologiques sur la vie et la mort - Bichat Xavier - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ IV. Du centre épigastrique; il n’existe point dans le sens que les auteurs ont entendu.
ОглавлениеTable des matières
Les auteurs n’ont jamais varié sur le foyer cérébral; tous les mouvemens volontaires ont toujours été envisagés par eux comme un effet de ses irradiation. Mais ils ne sont pas également d’accord sur le foyer épigastrique; les uns le placent dans le diaphragme, d’autres au pylore, quelques-uns dans le plexus solaire du grand sympathique .
Tous me semblent errer sur ce point, en ce qu’assimilant le second au premier foyer, ils croient que les passions, comme les sensations, se rapportent constamment à un centre unique et invariable.
Ce qui les a conduits à cette opinion, c’est le sentiment d’oppression qui se fait sentir au voisinage du cardia dans les affections pénibles.
Mais remarquons que dans les organes internes, le sentiment né de l’affection d’une partie est toujours un indice infidèle du siège et de l’étendue de cette affection: par exemple, la faim porte son influence sur la totalité de l’estomac, et cependant le cardia semble seul nous en transmettre la sensation. Une large surface enflammée dans la plèvre ou le poumon, ne donne lieu le plus souvent qu’à une douleur concentrée sur un point. Combien de fois à la tête, à l’abdomen, etc. une douleur fixe et occupant un petit espace, ne coïncide-t-elle pas avec une affection largement disséminée, et ayant même un siège tout différent de celui que nous présumons! Il ne faut donc jamais considérer le lieu où nous rapportons le sentiment, comme le sûr indice du lieu précis qu’occupe l’affection, mais seulement comme un signe qu’elle se trouve là, ou dans le voisinage.
Il suit, d’après cela, que pour juger l’organe avec lequel telle ou telle passion est en rapport, on doit recourir, non pas au sentiment, mais à l’effet produit dans les fonctions de l’organe, par l’influence de la passion. Or, en partant de ce principe, il est aisé de voir que ce sont tantôt les organes digestifs, tantôt le système circulatoire, quelquefois les viscères appartenant aux secrétions, qui éprouvent un changement, un trouble dans nos affections morales.
Je ne reviendrai pas sur les preuves qui établissent cette vérité ; mais, en m’appuyant sur elle, comme étant démontrée, je dirai qu’il n’y a point pour les passions, de centre fixe et constant, comme il en existe un pour les sensations; que le foie, le poumon, la rate, l’estomac, le cœur, etc. tour à tour affectés, forment tour à tour ce foyer épigastrique si célèbre dans nos ouvrages modernes; que si nous rapportons, en général, dans cette région l’impression sensible de toutes nos affections, c’est que tous les viscères importans de la vie organique s’y trouvent concentrés; que si la nature eût séparé ces viscères par deux grands intervalles, en plaçant, par exemple, le foie dans le bassin, l’estomac au cou, le cœur et la rate restant à leur place ordinaire, alors le foyer épigastrique disparoîtroit, et le sentiment local de nos passions varieroit suivant l’organe sur lequel elles porteroient leur influence.
Camper, en déterminant l’angle facial, a donné lieu à de lumineuses considérations sur l’intelligence respective des animaux. Il paroît que non-seulement les fonctions du cerveau, mais toutes celles en général, de la vie animale, qui y trouvent leur centre commun, ont à peu près cet angle pour mesure de perfection.
Il seroit bien curieux d’indiquer aussi une mesure qui, prise dans les parties servant à la vie organique, pût fixer le rang de chaque espèce sous le rapport des passions. Pourquoi le sentiment est-il porté à un si haut point chez le chien? pourquoi la reconnoissance, la tristesse, la joie, la haine, l’amitié, etc. l’agitent-elles avec tant de facilité ? c’est, de ce côté, qu’il est supérieur aux autres animaux: a-t-il dans la vie organique quelque chose de plus parfait? Le singe nous étonne par son industrie, sa disposition à l’imitation, son intelligence; c’est par la supériorité de sa vie animale qu’il laisse loin de lui les espèces les mieux organisées? D’autres animaux, comme l’éléphant, nous intéressent par leur attachement, leurs affections, leurs passions, et nous charment par leur adresse, l’étendue de leur perception, de leur intelligence. Chez eux le centre cérébral et les fonctions intérieures ou organiques sont perfectionnés au même degré ; la nature semble avoir également reculé les bornes de leurs deux vies.
Un rapide coup d’œil jeté sur la série des animaux, nous montrera, ainsi, tantôt les phénomènes relatifs aux sensations prédominant sur ceux qui naissent des passions, tantôt ceux-ci l’emportant sur les premiers, quelquefois l’équilibre étant établi entr’eux, et suivant ces diverses circonstances, la vie organique et animale supérieures, inférieures, ou égales l’une à l’autre.
Ce que nous observons dans la longue chaîne des êtres animés, nous le remarquons dans l’espèce-humaine prise isolément. Chez l’un, les passions qui dominent, sont le principe du plus grand nombre des mouvemens; l’influence de la vie animale, à chaque instant surpassée par celle de l’organique, laisse naître sans cesse des actes auxquels la volonté est prequ’étrangère, et qui, trop souvent, entraînent après eux les regrets amers, qui se font sentir lorsque la vie animale reprend son empire. Dans l’autre, c’est cette vie qui est supérieure à la première; alors tous les phénomènes relatifs aux sensations, à la perception, à l’intelligence, semblent s’agrandir aux dépens des passions qui restent dans un silence auquel l’organisation de l’individu les condamne. Alors la volonté préside à tout; les muscles locomoteurs sont dans une continuelle dépendance du cerceau, tandis que dans le cas précédent ce sont principalement les organes gastriques et pectoraux qui les mettent en jeu.
L’homme dont la constitution est la plus heureuse et en même temps la plus rare, est celui qui a ses deux vies dans une espèce d’équilibre, dont les deux centres, cérébral et épigastrique, exercent l’un sur l’autre une égale action, chez qui les passions animent, échauffent, exaltent les phénomènes intellectuels, sans en envahir le domaine, et qui trouve dans son jugement un obstacle qu’il est toujours maître d’opposer à leur impétueuse influence.
C’est cette influence des passions sur les actes de la vie animale, qui compose ce qu’on nomme le caractère, lequel, comme le tempérament, appartient manifestement à la vie organique: aussi en a-t-il les divers attributs, tout ce qui en émane est, pour ainsi dire, involontaire. Nos actes extérieurs forment un tableau dont le fond et le dessin sont à la vie animale, mais sur lequel la vie organique répand la nuance et le coloris des passions. Or, cette nuance, ce coloris, c’est le caractère.
Tous les philosophes ont presque remarqué cette prédominance alternative des deux vies, Platon, Marc-Aurèle, Saint-Augustin, Bacon, Saint-Paul, Leibnitz, Vanhelmont, Buffon, etc. ont reconnu en nous deux espèces de principes; par l’un nous maîtrisons tous nos actes moraux, l’autre semble les produire involontairement. Qu’est-il besoin de vouloir, comme la plupart d’entr’eux, rechercher la nature de ces principes? observons les phénomènes, analysons les rapports qui les unissent les uns aux autres, sans remonter à leurs causes premières.