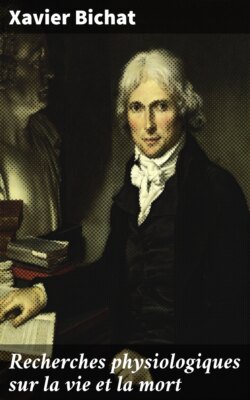Читать книгу Recherches physiologiques sur la vie et la mort - Bichat Xavier - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ III. Comment les passions modifient les actes de la vie animale, quoiqu’elles aient leur siége dans la vie organique.
ОглавлениеTable des matières
Quoique les passions soient l’attribut spécial de la vie organique, elles ont cependant sur les mouvemens de la vie animale une influence qu’il faut examiner. Les muscles volontaires sont fréquemment mis en jeu par elles; tantôt elles en exaltent les mouvemens, tantôt elles semblent agir sur eux d’une manière sédative.
Voyez cet homme que la colère, la fureur agitent; ses forces musculaires doublées, triplées même, s’exercent avec une énergie que lui-même ne peut modérer: où chercher la source de cet accroissement? elle est manifestement dans le cœur.
Cet organe est l’excitant naturel du cerveau par le sang qu’il lui envoie, comme je le prouverai fort au long dans la suite de cet ouvrage, en sorte que, selon que l’excitation est plus ou moins vive, l’énergie cérébrale est plus ou moins grande, et nous avons vu que l’effet de la colère est d’imprimer à la circulation une extrême vivacité, de pousser par conséquent vers le cerveau une grande quantité de sang dans un temps donné. Il résulte de là un effet analogue à celui qui survient toutes les fois que la même cause se développe, comme dans les accèsde fièvre ardente, dans l’usage du vin à un certain degré, etc.
Alors, fortement excité, le cerveau excite avec force les muscles qui sont soumis à son influence; leurs mouvemens deviennent, pour ainsi dire, involontaires: ainsi la volonté est-elle étrangère à ces spasmes musculaires déterminés par une cause qui irrite l’organe médullaire, comme une esquille, du sang, du pus dans les plaies de tête, le manche du scalpel ou tout autre instrument dans nos expériences.
L’analogie est exacte; le sang abordant en plus grande quantité qu’à l’ordinaire, produit sur le cerveau l’effet de ces excitans divers. Il est donc, pour ainsi dire, passif dans ces divers mouvemens. C’est bien de lui que partent, comme à l’ordinaire, les irradiations nécessaires; mais ces irradiations y naissent malgré lui, et nous ne sommes pas maîtres de les suspendre.
Aussi, remarquez que dans la colère, un rapport constant existe entre les contractions du cœur et celles des organes locomoteurs: quand les unes augmentent, les autres s’accroissent; si l’équilibre se rétablit d’un côté, bientôt nous l’observons de l’autre. Dans tout autre cas, au contraire, aucune apparence de ce rapport ne se manifeste; l’action du cœur reste la même au milieu des nombreuses variations du système musculaire locomoteur. Dans les convulsions ou les paralysies, dont ce système est le siège, la circulation ne s’accélère ni ne se ralentit jamais.
Nous voyons dans la colère le mode d’influence qu’exerce la vie organique sur la vie animale. Dans la crainte où, d’une part, les forces du cœur affoiblies poussent au cerveau moins de sang, et par-là même y dirigent une cause moindre d’excitation; où, d’autre part, on remarqué un affoiblissement d’action dans les muscles extérieurs, nous saisissons aussi l’enchaînement de la cause à l’effet. Cette passion offre au premier degré le phénomène que présentent au dernier les vives émotions qui, suspendant tout à coup l’effort du cœur, déterminent une cessation subite de la vie animale, et par-là même la syncope.
Mais comment appliquer les modifications mille fois variées qu’apportent à chaque instant les autres passions dans les mouvemens qui appartiennent à cette vie? comment dire la cause de ces nuances infinies qui se succèdent si souvent avec une inconcevable rapidité dans le mobile tableau de la face? comment expliquer pourquoi, sans que la volonté y participe, le front se ride ou s’épanouit, les sourcils se froncent ou se déploient, les yeux s’enflamment ou lauguissent, brillent ou s’obscurcissent, la bouche se relève ou s’abaisse, etc....?
Tous les muscles, agens de ces mouvemens, reçoivent leurs nerfs du cerveau, et sont ordinairement volontaires. Pourquoi, dans les passions, cessent-ils donc de l’être? pourquoi rentrent-ils dans la classe des mouvemens de la vie organique, qui tous s’exercent sans que nous les dirigions, ou même que nous en ayons la conscience? voici, je crois, l’explication la plus probable de ce phénomène.
Des rapports sympathiques nombreux unissent tous les viscères internes avec le cerveau ou avec ses différentes parties. Chaque pas fait dans la pratique nous offre des exemples d’affections de cet organe, nées sympathiquement de celles de l’estomac, du foie, des intestins, de la rate, etc. Cela posé, comme l’effet de toute espèce de passion est de produire une affection, un changement de force dans l’un de ces viscères, il sera aussi d’exciter sympathiquement, ou le cerveau en totalité, ou seulement quelques-unes de ses parties, dont la réaction sur les muscles qui en reçoivent des nerfs, y détermineront les mouvemens qu’on observe alors. Dans la production de ces mouvemens, l’organe cérébral est donc pour ainsi dire passif, tandis qu’il est actif lorsque la volonté préside à ses efforts.
Ce qui arrive dans les passions est semblable à ce que nous observons dans les maladies des organes internes, qui font naître sympathiquement des spasmes, une foiblesse, ou même la paralysie des muscles locomoteurs.
Peut-être les organes internes n’agissent-ils pas sur les muscles volontaires par l’excitation intermédiaire du cerveau, mais par des communications nerveuses directes; qu’importe le comment? ce n’est pas de la question tant agitée du mode des communications sympathiques qu’il s’agit ici.
Ce qui est essentiel, c’est le fait lui-même: or, dans ce fait, voici ce qui est évident: d’une part, affection d’un organe intérieur par les passions; de l’autre, mouvement déterminé à l’occasion de cette affection, dans des muscles sur lesquels cet organe n’a aucune influence dans la série ordinaire des phénomènes des deux vies. C’est bien là sûrement une sympathie; car entre elle et celles que nous présentent les convulsions, les spasmes de la face, occasionnés par la lésion du centre phrénique, par une plaie à l’estomac, etc. la différence n’est que dans la cause qui affecte l’organe interne.
L’irritation de la luette, du pharynx, agite convulsivement le diaphragme; l’action trop répétée des liqueurs fermentées sur l’estomac donne des tremblemens: pourquoi ce qui arrive dans un mode d’affection des viscères gastriques, n’arriveroit-il pas dans un autre? Que l’estomac, le foie, etc. soient irrités par une passion ou par une cause matérielle, qu’importe? c’est de l’affection, et non de la cause qui la produit, que naît la sympathie.
Voilà donc, en général, comment les passions arrachent à l’empire de la volonté des mouvemens naturellement volontaires, comment elles s’approprient, si je puis m’exprimer ainsi, les phénomènes de la vie animale, quoiqu’elles aient essentiellement, leur siège dans la vie organique.
Quand elles sont très-fortes, l’affection très-vive ds eroganes internes produit si impétueusement les mouvemens sympathiques des muscles, que l’action ordinaire du cerveau est absolument nulle sur eux. Mais la première impression étant passée, le mode ordinaire de locomotion revient.
Un homme apprend, par lettre et devant une assemblée, une nouvelle qu’il a intérêt de cacher; tout à coup son front se ride, il pâlit, ou ses traits s’animent suivant la passion qui est mise en jeu: voilà des phénomènes sympathiques nés de quelques viscères abdominaux subitement affectés par cette passion, et qui, par conséquent, appartiennent à la vie organique. Bientôt cet homme se contraint; son front s’épanouit; sa rougeur renaît ou ses traits se resserrent, quoique le sentiment intérieur subsiste: c’est le mouvement volontaire qui l’a emporté sur le sympathique; c’est le cerveau dont l’action a surmonté celle de l’estomac, du foie, etc.; c’est la vie animale qui a repris son empire.
Il y a dans presque toutes les passions, mélange ou succession des mouvemens de la vie animale à ceux de la vie organique, en sorte que, dans presque toutes, l’action musculaire est en partie dirigée par le cerveau, suivant l’ordre naturel, et a en partie son siége dans les viscères organiques, comme le cœur, le foie, l’estomac, etc. Ces deux foyers, tour à tour prédominés l’un par l’autre, ou restant en équilibre, constituent, par leur mode d’influence, toutes les variétés nombreuses que nous présentent nos affections morales.
Ce n’est pas seulement sur le cerveau, mais encore sur toutes les autres parties, que les viscères affectés par les passions exercent leur influence sympathique: la peur affecte primitivement l’estomac, comme le prouve le resserrement qu’on ressent alors dans cette région. Ainsi affecté, l’organe réagit sur la peau avec laquelle il a tant de rapport, et celle-ci devient alors le siège d’une sueur froide et subite, si fréquente dans cette affection de l’ame. Cette sueur est de la nature de celles qu’on détermine par l’action d’une substance qui, comme le thé, agit d’abord sur l’estomac, lequel réagit ensuite sympathiquement sur l’organe cutané. Ainsi un verre d’eau froide, un air très-frais suppriment-ils cette excrétion, par le rapport qu’il y a entre cet organe et les surfaces muqueuses de l’estomac ou des bronches. Il faut bien distinguer les sueurs sympathiques, de celles dont la cause agit directement sur la peau, comme la chaleur, l’air, etc.
Quoique le cerveau ne soit pas, d’après cela, le but unique de la réaction des viscères internes affectés par les passions, il est cependant le principal, et sous ce rapport on peut toujours le considérer comme un foyer toujours en opposition avec celui que représentent les organes internes.