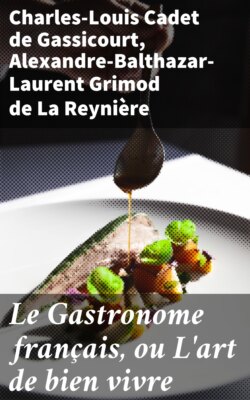Читать книгу Le Gastronome français, ou L'art de bien vivre - Charles-Louis Cadet de Gassicourt - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Volailles, poissons, coquillages et végétaux servant à la nourriture des anciens.
ОглавлениеLES anciens connaissaient presque tous nos mets, et nous n’avons conservé de quelques-uns des leurs que le nom. Le cas que faisaient les gourmands du phénicoptère parmi les volailles, de l’attagen d’Ionie parmi les oiseaux, de l’oursin entre les coquillages, du scarus, de l’acipenser et du congre entre les poissons, prouve que nous n’avons rien qui leur soit comparable.
Les naturalistes ont vainement prétendu nous faire connaître des analogues; leurs recherches ne nous laissent que des regrets et la preuve de leur impuissance. Quand verrons-nous les antiquaires, cessant de courir à la découverte infructueuse d’une pierre insensible et d’une médaille rongée, s’appliquer à des travaux vraiment utiles, et mériter la reconnaissance de leurs semblables? Hélas! les ruines d’Herculanum ne renferment que des squelettes desséchés, des débris sans saveur, des inutilités antiques.
Qui nous rendra les murènes siciliennes, les anguilles flottées, les thons du promontoire de Raquien, les cabris de l’île de Mélos, les mulets de Simète, les coquillages de Pélore, les harengs de Lipare, les raves de Mantinée, les navets de Thèbes? etc., etc.
Voilà, voilà les monumens précieux de l’antiquité dont les connaisseurs sont avides! La plupart de ces choses existent; la nature est toujours féconde, la terre et la mer toujours fertiles; c’est notre insouciance qui a laissé se perdre l’art de les choisir, de les apprécier, de les faire valoir!
Si du moins les méthodes des anciens cuisiniers étaient parvenues jusqu’à nous, nous pourrions suppléer à ce qui nous manque: le cuisinier de Nicomède composait des harengs en Bithynie; celui de Trimalcion, avec de la chair de cochon, du beurre et une certaine herbe, faisait des poissons, des pigeons ramiers, des poulardes, et presque tout ce qu’on voulait.
A la table de Lucullus les œufs de paon, les foies de sanglier, les têtes d’agneau, les ventres de truie étaient des mets divins. Le génie de l’ordonnateur de ses repas faisait des miracles avec le cumin, le silphium, le thym, l’oximel, le sésame, l’origan, et autres aromates inconnus de nos jours.
Nous avons perdu jusqu’à la manière de mêler le fromage, les carottes, l’oignon, l’ail, le poivre et la menthe aux viandes grossières et vulgaires qui viennent des boucheries. On faisait avec du persil, de la coriandre, du vinaigre, du fenouil, de l’huile, du miel et de la chair de poule, un ragoût délicieux nommé myma.
Qu’est devenue cette recette, celle du mattya, et de tant d’autres mets dont le nom seul nous reste? Nous croyons-nous plus riches avec le gingembre et les dindons, que les Grecs et les Romains avec tant de richesses qui nous sont inconnues? Dédaigneux par ignorance, nous méprisons le congre dont ils savaient faire un manger exquis; nous négligeons la pintade, cette perdrix numidique qui faisait l’honneur des tables les plus somptueuses,
Veut-on avoir une idée de leur supériorité sur nous, qu’on lise seulement la nomenclature des gâteaux qu’ils savaient faire. L’art des Le Sage, des Félix, des Thomas, des Leblanc, des Rouget et des Rats doit s’humilier devant cette fécondité, ou plutôt il doit s’enflammer d’une nouvelle ardeur, car c’est en imitant l’antique que l’art atteint à la perfection.
L’enchyton, l’amès, le diaconion, l’amphiphon, le basynias, le coccara, le strèple, le neclata, l’épichyton, l’attanitès, le creion, le glycinus, les enchridès, etc., étaient autant d’espèces de pâtisseries qui différaient par la forme, par le goût et par les ingrédiens: dans les uns on mettait de la viande comme dans nos petits pâtés; dans les autres entraient des épices ou du miel; le vin même payait tribut à l’art du pâtissier.
Le libum, le placenta, le scriblita, le sphærita, le crastulum, le cratsinionum siculum valaient mieux que nos gâteaux de Nanterre, nos échaudés, nos pets de nonne, nos croquettes de riz, et toutes ces pâtes apprêtées qu’un gourmet antique, accoutumé aux merveilles du succulent artocréas , aurait trouvées fades ou mal conçues.
Sans prétendre rabaisser le mérite de nos artistes nourriciers, je les invite, au nom des Gourmands, au nom de leur gloire et du dieu Cornus, à se faire expliquer, par les savans en us et en os, la signification de tant de mots friands. Peut-être, à force de travail, et en joignant une dégustation réfléchie aux études théoriques, parviendront-ils à découvrir la source de tant de trésors. Quelles que soient nos possessions en ce genre, que de choses ne pouvons-nous pas acquérir! Ne dussions-nous retrouver que le xiphias, le pagre, ou la sardine de Phalère, nous n’aurions pas inutilement parcouru les mers.
M. Barthélemy a mis à la portée de tous la description du magnifique repas donné par Dinias. On trouve dans Hérodote celui que donna le thébain Attagine à Mardonius et aux généraux perses. Le père D. de Montfaucon, dans ses Antiquités, et Athénée, ont écrit assez longuement de la cuisine pour guider dans cette voie glorieuse quiconque se sentira assez de courage et de génie pour la parcourir.
Il est du moins quelques préceptes que tous les lecteurs peuvent apprécier, et dont M. Balaine a fait souvent l’application; par exemple:
Il était de règle qu’un poisson de chair ferme fût saupoudré de fromage râpé, et arrosé de vinaigre; s’il était d’une chair délicate, on n’y mettait que de l’huile et du sel; ou bien, enveloppé dans des feuilles de figuier, on le faisait cuire sous la cendre.
Avec les poissons bouillis ou rôtis on mettait une sauce de fromage, vinaigre, ail, oignons et poireaux hachés. Si l’on voulait que cette sauce fût moins forte, elle n’était composée que d’huile, de jaunes d’œufs, de poireaux, d’ail et de fromage. La voulait-on plus douce encore, on y ajoutait du miel, des dattes et du cumin.
Il était rare qu’une grosse pièce se servît isolée: le poisson se farcissait ordinairement de gibier, de menue volaille, d’huîtres et de coquillage; le gibier, de poissons, d’œufs et d’aromates. Ainsi l’amateur retrouvait partout quelque nuance de ce qu’il aimait le plus dans le règne animal ou végétal.
Il s’était conservé dans le moyen âge quelque souvenir de ces apprêts ingénieux. Dans les galas que les princes et les grands seigneurs donnaient au peuple en Allemagne et en Italie, on avait coutume de servir pour plat du milieu un bœuf entier, proprement préparé, lequel contenait un cerf, aussi tout entier, vidé et accommodé : ce cerf, était farci de volailles et de gibier dont le ventre était rempli de cailles, d’ortolans, de petits poissons, sans os et sans arêtes, le tout mêlé de graisses diverses, d’épices, et d’ingrédiens savoureux.
Mais cette image imparfaite des raffinemens antiques ne peut donner une idée exacte des inventions de la cuisine grecque, perse et romaine.
Un nommé Massialo, qui en 1730 a fait imprimer un livre en trois volumes sur l’art alimentaire, donne aux cuisiniers modernes le procédé dont se servaient les anciens pour accommoder un cochon de lait à demi-rôti et à demi-bouilli; on le vidait par un petit trou à l’épaule, on le lavait soigneusement avec du vin, et on le remplissait d’ingrédiens qu’on insinuait par la gueule. Massialo traduit ce mets par le titre de cochon à la Perdouillet.
Ab uno disce omnes.
Les nombreuses découvertes qui vont être le fruit de nos études réfléchies sur la cuisine des anciens, stimuleront sans doute le zèle des artistes, et feront fermen ter leurs têtes. Puisse bientôt une école publique s’ouvrir à de nombreux disciples! Quand nous verrons au milieu de dix fourneaux ardens trente suivans de Comus agiter la casserole, faire pétiller la graisse, hacher les viandes et les herbes, tenter tous les jours de nouvelles expériences, et proclamer par semaine un procédé nouveau renouvelé des Grecs, alors nous espérerons voir renaître les beaux jours des Trimalcion, des Apicius et des Ésope romains.
Mais tant que nous verrons les restaurateurs indolens suivre leurs routines vulgaires, nous ne cesserons d’évoquer les mânes de leurs rivaux, et de leur reprocher l’oubli de tant de mets divins qu’un gourmand du dix-neuvième siècle est réduit à envier aux anciens.