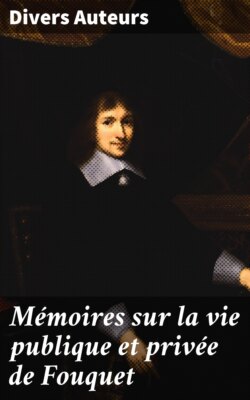Читать книгу Mémoires sur la vie publique et privée de Fouquet - Divers Auteurs - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE VI
ОглавлениеTable des matières
MAI-JUIN 1652
Condé s'empare de la ville de Saint-Denis (11 mai), qui est bientôt reprise par l'armée royale (13 mai).—les princes s'adressent au duc de Lorraine, qui s'avance jusqu'à Lagny à la tête d'une petite armée.—Son arrivée à Paris (1er juin).—Caractère de ce duc et de ses troupes.—Frivolité apparente du duc de Lorraine.—Ses temporisations affectées.—Il négocie avec la cour par l'intermédiaire de madame de Chevreuse et de l'abbé Fouquet.—Intimité de l'abbé Fouquet avec mademoiselle de Chevreuse.—Lettre de l'abbé Fouquet à Mazarin (4 juin) sur les négociations de madame de Chevreuse avec le duc de Lorraine.—Lettre de Mazarin à madame de Chevreuse (5 juin).—Traité signé avec le duc de Lorraine (6 juin).—Part qu'y a la princesse du Guéménée (Anne de Rohan).—Le duc de Lorraine s'éloigne de Paris.—Misère de cette ville.—Procession de la châsse de sainte Geneviève (11 juin).—Conduite du prince de Condé à cette occasion.—Murmures et menaces contre le parlement.—Violences exercées contre les conseillers (21 juin).—Mazarin encourage l'abbé Fouquet à exciter le peuple contre le parlement.—Tumulte du 23 juin.—Danger que court le procureur général Nicolas Fouquet.—Les deux armées se rapprochent de Paris.
Les troupes royales, campées à Saint-Germain, s'étaient avancées jusqu'au pont de Saint-Cloud, dans l'espérance de s'en emparer sans résistance. A cette nouvelle, Condé se hâta de se porter vers le bois de Boulogne, et les Parisiens le suivirent en grand nombre[155].[T.I pag.96] Mais déjà les troupes royales s'étaient retirées, sur un ordre venu de Saint-Germain. Condé, voulant profiter de l'ardeur des soldats et des bourgeois qui l'avaient accompagné, les mena à Saint-Denis, qui n'était défendu que par un petit nombre de Suisses. Cette ville fut enlevée sans difficulté (11 mai); mais deux jours après un des généraux de l'armée royale, Miossens, qui devint plus tard le maréchal d'Albret, la reprit aussi aisément. La bourgeoisie parisienne sortit pour le combattre, mais à la première charge de la cavalerie ennemie elle tourna le dos[156]. On ne fit que rire à Paris de cette expédition, et les bourgeois qui jouaient au soldat devinrent l'objet de railleries, dont Loret s'est fait l'écho dans sa Muse historique du 19 mai:
...Étant dans leurs familles
Avec leurs femmes et leurs filles,
Ils ne disaient parmi les pots
Que mots de guerre à tous propos:
Bombarde, canon, couleuvrine,
Demi-lune, rempart, courtine...
Et d'autres tels mots triomphants,
Qui faisaient peur à leurs enfants.
Avec de pareils soldats, Condé ne pouvait espérer soutenir son ancienne gloire militaire. Quant à sa véritable armée, elle était bloquée à Étampes et vivement pressée par Turenne. Dans cette situation critique, il s'adressa à un prince étranger, Charles IV, duc de Lorraine, beau frère du duc d'Orléans. Charles de Lorraine, dépouillé depuis longtemps de ses États par Richelieu, menait la vie errante d'un aventurier à la tête[T.I pag.97] d'une petite armée, composée de vieux et bons soldats. Il s'empressa de répondre à l'appel des princes, s'avança jusqu'à Lagny, à la tête de huit cents hommes[157], y fit camper ses troupes, et se rendit lui-même à Paris (1er juin). Il trouva sur la route le duc d'Orléans et le prince de Condé, qui étaient venus jusqu'au Bourget pour le recevoir. A Paris, le peuple manifesta la joie la plus vive de l'arrivée de ce belliqueux auxiliaire. Sur le pont neuf, ce n'étaient que mousquetades en l'honneur des Lorrains[158]. Le bon peuple de Paris ne se doutait guère du caractère des alliés qu'il fêtait. Le duc de Lorraine, habitué depuis longues années à la vie des camps, affichait dans sa conduite et dans ses paroles un cynisme effronté. Il cachait, sous une légèreté moqueuse, l'ambition et l'avidité d'un chef de mercenaires; se jouait de sa parole et négociait avec Mazarin en même temps qu'avec les princes. Ses soldats, habitués aux horreurs de la guerre de Trente-Ans, étaient des pillards impitoyables[159], et il ne fallut pas longtemps au peuple des campagnes pour en faire la triste expérience.
Quant au duc, on prit d'abord ses façons brusques et libres pour la franchise originale d'un soldat. Les dames surtout s'y laissèrent séduire[160]. Le duc de Lorraine logea au palais du Luxembourg, qu'habitaient son beau-frère et sa sœur, Gaston d'Orléans et Marguerite de Lorraine. Après quelques jours donnés aux plaisirs,[T.I pag.98] les princes voulurent aller au secours d'Étampes; mais leur allié prenait tout sur un ton de raillerie, chantait et se mettait à danser, «de sorte, dit mademoiselle de Montpensier[161], que l'on était contraint de rire.» Le duc d'Orléans l'ayant envoyé chercher un jour que le cardinal de Retz était dans son cabinet, et voulant lui parler d'affaires, il répondit: «Avec les prêtres, il faut prier Dieu; que l'on me donne un chapelet[162].» Quelque temps après arrivèrent mesdames de Chevreuse et de Montbazon, renommées par leur beauté et leur galanterie. Comme on tenta encore de parler de choses sérieuses, le duc de Lorraine prit une guitare, et leur dit: «Dansons, mesdames; cela vous convient mieux que de parler d'affaires[163].» Pour échapper aux instances de mademoiselle de Montpensier, il affectait un amour passionné pour madame de Frontenac, une des maréchales de camp de la princesse.
Cette apparence de frivolité couvrait, comme nous l'avons dit, beaucoup de finesse, d'astuce et même de duplicité. Le duc de Lorraine n'avait pas tardé à voir où était la force réelle. Du côté des princes, il n'y avait que divisions. Gaston d'Orléans était jaloux du prince de Condé; la duchesse d'Orléans détestait sa belle-fille, mademoiselle de Montpensier, et servait le parti de la cour. Au contraire, la cause royale, dirigée par Mazarin, présentait plus d'unité dans les vues, et des espérances[T.I pag.99] plus solides. La personne qui servit, dans cette circonstance, à gagner complétement Charles IV fut madame de Chevreuse; depuis près d'une année, elle s'était ralliée à la cause royale et la servait avec zèle et habileté. Elle était entourée de Mazarins; Laigues, qui la gouvernait à cette époque ([164]), était dévoué au cardinal, et l'abbé Fouquet, qui s'était introduit dans son intimité, exerçait un grand empire sur mademoiselle de Chevreuse, Charlotte de Lorraine([165]). Madame de Chevreuse obtint d'abord que le duc, bien loin de marcher en toute hâte au secours d'Étampes, traînerait en longueur. Dès le 4 juin, l'abbé Fouquet en avertit Mazarin: «Madame de Chevreuse a tiré parole de M. de Lorraine qu'il serait six jours dans sa marche; qu'après-demain il séjournerait tout le jour, et qu'aujourd'hui il ne ferait partir de Lagny que la moitié de son armée, quoiqu'il lui fût aisé de faire partir le tout. Si dans l'intervalle on pouvait achever l'affaire d'Étampes (s'en emparer), il en serait ravi, car il est tout à fait dans les intérêts de la reine. Mais, si on ne le peut en ce temps-là, il pense qu'il sera aisé de faire une proposition pour la paix générale de concert avec lui, et il s'engage à servir la reine comme elle le pourra souhaiter. Madame de Chevreuse dit qu'il serait bon que [T.I pag.100]la reine l'en remerciât par écrit. Elle pense que, si l'on envoyait Laigues avec une résolution certaine sur Vie et Moyenvie (places que réclamait le duc de Lorraine), on aurait contentement; il est nécessaire de donner une réponse précise au plus tôt. Il faut que Votre Éminence, si elle veut songer à cette affaire, fasse témoigner à M. de Lorraine qu'elle servira ses enfants. C'est là tout son désir. Il serait bon que Votre Éminence écrivit à madame de Chevreuse pour la remercier. Elle a gagné deux jours sur l'esprit de M. de Lorraine.» Cette lettre confidentielle prouve que le cardinal de Retz, qui parle dans ses Mémoires de la négociation de madame de Chevreuse ([166]), n'en connaissait pas les détails. Il est vrai qu'il avoue qu'à cette époque il ne fréquentait plus guère l'hôtel de Chevreuse, et il laisse percer, malgré lui, son dépit de n'avoir été «du secret ni de la mère ni de la fille ([167]).» Mazarin s'empressa de profiter de l'ouverture de l'abbé Fouquet, et la lettre qu'il adressa à madame de Chevreuse prouve quel cas il faisait de ses services: «Le sieur de Laigues, lui écrivait-il le 5 juin, vous dira toutes choses pour ce qui regarde les affaires générales. A quoi je n'ajouterai rien; mais je ne puis m'empêcher de vous témoigner moi-même par ces lignes la satisfaction que j'ai de tout ce que vous avez fait avec M. de Lorraine. Je n'ai point douté que vous ne fissiez plus d'impression que personne sur son esprit; je suis ravi de vous voir entièrement disposée pour le service du roi, et pour mon intérêt particulier. J'espère une bonne[T.I pag.101] suite de cette négociation, et qu'elle se terminera avec beaucoup de gloire et d'avantage pour M. de Lorraine, avec le rétablissement du repos de la France, et peut-être de toute la chrétienté. Je vous prie de l'assurer bien expressément de la continuation de mon estime et de mon amitié, et de le remercier, de ma part, de tous les sentiments qu'il vous a déclaré si obligeamment avoir pour moi.»
L'ancien garde des sceaux, Châteauneuf, qui était toujours resté en relation avec madame de Chevreuse, fut chargé de régler les conditions du traité avec le duc de Lorraine. Tout fut terminé dès le lendemain 6 juin, et, le même jour, Châteauneuf écrivait à la reine: «M. de Lorraine est venu céans sur les dix heures, et nous sommes convenus des articles que j'envoie à Votre Majesté; ils sont à peu près selon l'intention de Sa Majesté et le pouvoir qu'Elle m'a donné. L'armée, qui est devant Étampes, peut tout tenter jusqu'à mardi, quatre heures du matin; car, encore que le jour du lundi[168] soit exprimé dans le traité, j'ai retiré de M. de Lorraine un écrit particulier que ce mot de lundi s'entend tout le jour, et il suffit que l'armée se retire le mardi à quatre heures du matin; ainsi elle a le lundi tout entier. Je n'ai fait la suspension d'armes que pour dix jours; et, si l'armée des princes sort d'Étampes, celle de Votre Majesté la peut suivre toujours à quatre lieues près. Si elle est suivie, elle est perdue en l'état qu'elle est, et, cela cédé, M. de Lorraine obligera les princes à[T.I pag.102] se soumettre à telles conditions qu'il plaira à Votre Majesté. Aussitôt que le siège d'Étampes sera levé, M. de Lorraine fait état d'aller saluer Vos Majestés, et leur proposer son entremise pour la paix d'Espagne et celle des princes. Après quoi, dit-il, il suppliera Vos Majestés de lui donner la sienne et le recevoir à votre service envers tous, excepté les Espagnols. Il m'a dit que jusqu'ici ni Monsieur ni M. le Prince ne savaient rien de ces articles; qu'il voulait sortir de Paris, et que de son camp il leur en donnerait part. Je doute de cela, et la suite nous le fera connaître. J'ai promis d'ici à demain, qui est le 7, de lui donner la ratification des articles, si Votre Majesté les a agréables.»
Ainsi, les conditions arrêtées étaient: 1° la levée du siège d'Étampes qui devait avoir lieu le 10 juin; 2° une suspension d'armes de dix jours, pendant laquelle les années resteraient à une distance d'au moins quatre lieues l'une de l'autre; 3° la retraite du duc de Lorraine, qui devait s'effectuer en quinze jours, par une route déterminée à l'avance, et sans qu'il fût inquiété par les troupes royales. Les conditions furent exécutées au grand étonnement des Frondeurs, qui s'aperçurent trop tard qu'ils avaient été joués par le duc de Lorraine. «Tout Paris, dit mademoiselle de Montpensier ([169]), était dans des déchaînements horribles contre les Lorrains; personne ne s'osait dire de cette nation de peur d'être noyé.»
Outre la duchesse de Chevreuse, la cour avait em[T.I pag.103]ployé dans cette négociation une autre dame également renommée pour sa beauté et sa galanterie. C'était madame de Guéménée (Anne de Rohan), que les Mémoires de Retz font parfaitement connaître. L'abbé Fouquet entretenait aussi des relations avec cette dame, et ce fut sans doute lui qui la détermina à servir la cour. On cacha à madame de Chevreuse cette nouvelle intrigue; mais elle est parfaitement constatée par les lettres de Mazarin. Il écrivait le 9 juin à l'abbé Fouquet: «Je vous fais seulement ces trois mots pour vous dire dans la dernière confidence que M. de Lorraine m'a écrit, et a fait dire à la reine que madame la princesse de Guéménée a fort bien agi, et comme une personne tout à fait servante de Sa Majesté et de mes amies particulières. La reine serait bien aise qu'elle pût trouver quelque prétexte de venir ici pour y être en même temps que M. de Lorraine, qui y sera demain, au moins à ce qu'il m'a promis. Je recevrai beaucoup de joie d'avoir l'honneur de l'entretenir. Sur tout, je vous prie, si elle veut prendre cette peine, qu'elle fasse la chose en sorte que madame de Chevreuse ne puisse point pénétrer qu'on l'ait invitée d'ici à y venir, et le secret en ceci est fort important.»
Tout réussit, comme le cardinal l'avait espéré, et le duc de Lorraine, après avoir fait quelques démonstrations pour secourir Étampes, s'éloigna de Paris, laissant les campagnes désolées. Mazarin a bien soin, dans ses lettres, de rejeter ces calamités sur les princes. Il écrivait à l'abbé Fouquet: «Vous aurez déjà su, je m'assure, à Paris, ce qui s'est passé avec M. de Lorraine, et[T.I pag.104] avec combien de sincérité on a procédé avec lui, puisque M. de Turenne pouvant lui faire courir grand risque, comme lui-même et le roi d'Angleterre ([170]) l'avoueront, il a préféré à cet avantage l'exécution des ordres de la cour, qui lui défendaient d'attaquer ledit sieur duc; mais il demanda qu'il voulût rompre son pont, séparer ses troupes d'avec celles des princes et se retirer à la frontière, comme il s'est engagé de faire. Il ne parle point de venir à la cour; mais il assure qu'il est plus résolu que jamais d'achever son accommodement particulier, étant bien persuadé de l'avantage qu'il y trouvera, et que l'on veut traiter à la cour de bonne foi. Les environs de Paris ne perdront pas à son éloignement, et il sera bon de faire valoir que j'y ai contribué.»
La misère des campagnes fut en effet un peu allégée par le départ du duc de Lorraine; mais la situation de Paris était toujours déplorable. Le nombre des pauvres s'y accroissait d'une manière effrayante. On eut recours, dans ces calamités, à sainte Geneviève, patronne de la capitale. La châsse de cette sainte fut promenée dans la ville le 11 juin avec un cérémonial dont les Mémoires du temps nous ont laissé une ample description ([171]). Le prévôt des marchands demanda et obtint, pour cette [T.I pag.105]procession, l'autorisation du chapitre de Notre-Dame et des religieux de Sainte-Geneviève, puis s'adressa au parlement, qui fixa l'époque de la cérémonie. Après un jeûne de trois jours, les religieux de Sainte-Geneviève descendirent la châsse à une heure après minuit. Le lieutenant civil d'Aubray, le lieutenant criminel, le lieutenant particulier et le procureur du roi[172] la prirent en leur garde, en répondirent à la communauté, et se tinrent pendant la procession autour de la châsse. La marche était ouverte par les quatre ordres de religieux mendiants, savoir: les cordeliers ou franciscains, les jacobins ou dominicains, les augustins et les carmes. Venait ensuite le clergé des principales paroisses subordonnées à Notre-Dame, avec les châsses célèbres de saint Magloire, saint Médéric ou saint Merry, de saint Landry, sainte Avoie, sainte Opportune, saint Marcel, et enfin la châsse de sainte Geneviève portée par des bourgeois de Paris. L'abbé de Sainte-Geneviève et les religieux, pieds nus, marchaient à la droite de la châsse. A gauche se trouvait le clergé de Notre-Dame. Le parlement suivait; on y remarquait les présidents de Bailleul, de Nesmond, de Maisons, de Mesmes et le Coigneux. Le maréchal de l'Hôpital, gouverneur de Paris, marchait entre les deux premiers présidents. Le parquet, composé du procureur général, Nicolas Fouquet, et des avocats généraux, Bignon et Talon, figura aussi à cette cérémonie, ainsi que la chambre des comptes,[T.I pag.106] la cour des aides, le prévôt des marchands, les échevins et le conseil de ville.
«Pendant cette pieuse action, dit madame de Motteville[173], M. le Prince, pour gagner le peuple et se faire roi des halles aussi bien que le duc de Beaufort, se tint dans les rues et parmi la populace, tandis que le duc d'Orléans et tout le monde était aux fenêtres pour voir passer la procession. Quand les châsses vinrent à passer, M. le Prince courut à toutes avec une humble et apparente dévotion, faisant baiser son chapelet et faisant toutes les grimaces que les bonnes femmes ont accoutumé de faire. Mais, quand celle de Sainte-Geneviève vint à passer, alors comme un forcené, après s'être mis à genoux dans la rue, il courut se jeter entre les prêtres; et, baisant cent fois cette sainte châsse, il fit baiser encore son chapelet et se retira avec l'applaudissement du peuple. Ils criaient tous après lui, disant: «Ah! le bon prince, et qu'il est dévot!» Le duc de Beaufort, que M. le Prince avait associé à cette feinte dévotion, en fit de même, et tous deux reçurent de grandes bénédictions, qui, n'étant pas accompagnées de celles du ciel, leur devaient être funestes sur la terre. Cette action parut étrange à tous ceux qui la virent. Il fut aisé d'en deviner le motif qui n'était pas obligeant pour le roi; mais il ne lui fit pas grand mal.»
Le peuple de Paris avait été un instant distrait de sa misère par ces cérémonies religieuses; mais, comme il n'en recevait aucun soulagement, il commença à éclater[T.I pag.107] en murmures, à entourer le parlement et à le menacer. Vainement le 18 juin on tint une grande assemblée où l'on appela toutes les communautés ecclésiastiques, pour tâcher de soulager les pauvres, dont la multitude s'accroissait chaque jour[174]. Les secours étaient impuissants pour remédier à tant de maux, et le parlement devenait de plus en plus impopulaire. C'était la conséquence inévitable de la fausse position d'un corps qui proscrivait le cardinal Mazarin et repoussait en même temps l'alliance des princes qui voulaient l'entraîner à la guerre civile. Il était attaqué par les deux partis extrêmes. Le 21 juin, la salle du Palais fut envahie par la populace; les uns criaient: Point de Mazarin! les autres: La paix[175]! Les seconds étaient, disait-on, des émissaires de l'abbé Fouquet. Depuis qu'il avait recouvré la liberté, l'abbé se montrait plus ardent que jamais pour la cause de Mazarin. Il avait recruté parmi la populace un grand nombre de gens de sac et de corde, qu'il lançait contre le parlement. Toutes les boutiques qui entouraient le Palais se fermèrent au milieu de ce tumulte, le commerce qui souffrait depuis longtemps fut ruiné, et la bourgeoisie commença à se joindre avec énergie à ceux que l'abbé Fouquet payait pour demander la paix. Le parlement, menacé tout à la fois par les partisans des princes et par les émissaires de l'abbé Fouquet, n'avait pas de défenseurs capables d'opposer la force à la force. Lorsque les conseillers[T.I pag.108] sortirent de cette séance du 21 juin, ils furent violemment assaillis[176]. Le même jour, le duc de Beaufort réunit sa faction, l'après-dinée, à la place Royale, et promit de donner une liste des Mazarins, dont les maisons devaient être livrées au pillage[177].
Tel était, en juin 1652, le spectacle que présentait Paris, misère profonde et irrémédiable, pillages, violences, tyrannie des factions, impuissance des modérés[178]. Le parlement vint demander appui au duc d'Orléans; mais, en sortant du Luxembourg, le président de Longueil, un des chefs de la députation, fut attaqué, injurié et poursuivi à coups de pierre[179]. Il fut contraint de se réfugier dans une maison où le prince de Condé alla le délivrer. Le cardinal Mazarin, dont le parlement avait mis la tête à prix, n'était pas fâché de voir ce corps réduit à une aussi déplorable condition. Il écrivait, le 21 juin, à l'abbé Fouquet: «J'ai reçu votre billet d'hier, que j'ai lu au roi et à la reine. Leurs Majestés ont une entière satisfaction des diligences que vous faites pour fomenter la disposition qui commence à paraître, dans l'esprit du peuple, de demander hautement la paix. Je n'ai pas manqué de leur faire valoir le zèle avec lequel M. le procureur général, M. le prévôt des marchands, M. Villayer, M. de la Barre (fils du prévôt des marchands), s'y emploient aussi. Je ne fais point réponse à madame de Chevreuse, parce que n'ayant point de[T.I pag.109] chiffre avec elle, je ne le pourrais faire par cette voie, qui n'est point tout à fait sûre, sans courir risque que cela lui préjudiciât dans cette conjoncture; mais vous lui pourrez dire que j'ai lu sa lettre à la reine, qui a tout le ressentiment imaginable de la manière dont elle agit. Sa Majesté désire qu'elle demeure à Paris, parce que sa présence et ses soins peuvent être utiles, en diverses rencontres, au bien des affaires; et pour les menaces que lui fait M. le Prince, je pense qu'elle n'en a pas grande peur, n'y ayant guère d'apparence qu'elles soient suivies d'aucun effet. J'ai la même opinion à votre égard et des autres personnes qui lui sont suspectes.
«On continue toujours de parler d'accommodement; mais il n'est pas près d'être conclu, les princes insistant sur des conditions plus préjudiciables au roi que la continuation de la guerre, quand même les armes de Sa Majesté auraient de mauvais succès. C'est pourquoi vous devez continuer, ce que vous avez commencé, de distribuer de l'argent pour faire crier à la paix et d'afficher des placards, parce que cela excitant le peuple pourra rendre les princes plus traitables et faciliter l'accommodement, et vous pouvez bien croire que, s'il était en l'état que l'on vous a dit, je vous en aurais mandé quelque chose. Il serait bon de débaucher les cavaliers de l'armée des princes. Si vous savez quelqu'un propre pour cela, vous l'y pourrez envoyer avec quelque argent. Je serais bien aise de pouvoir, par ce moyen, remplir bientôt mes compagnies de gendarmes et de chevau-légers.» En terminant, Mazarin recommandait encore à l'abbé Fouquet de continuer à distribuer[T.I pag.110] de l'argent pour exciter le peuple à demander la paix à grands cris. Basile Fouquet ne manqua pas de suivre les instructions du cardinal.
De son côté, le duc de Beaufort ameuta la canaille, qui, le 25 juin, entoura le parlement, fit entendre des cris de menace et de mort, et, malgré la protection des milices bourgeoises, insulta les conseillers au moment où ils sortirent du Palais. «Il n'y eut pas un seul conseiller, dit Omer-Talon[180], qui, étant reconnu pour tel (car plusieurs étaient travestis), ne souffrît injures, malédictions, coups de poing ou coups de pieds ou de bâton, et qui ne fût traité comme un coquin. Quatre de messieurs les présidents furent attaqués de coups de fusil, coups de pierre, coups de hallebarde, et, s'ils ne furent pas blessés, c'est une espèce de merveille, parce que ceux qui étaient à leurs côté ou derrière eux furent tués avec fureur, toutes les fenêtres et les toits des maisons étant pleins de personnes qui criaient qu'il fallait tout tuer et assommer; et tout ce peuple ainsi ému ne savait ce qu'il désirait ni ce qu'il voulait demander, sinon qu'il voulait la paix ou que l'on fit l'union avec les princes.» Les compagnies de la milice bourgeoise en vinrent elles-mêmes aux mains sous un prétexte frivole, et, comme une de ces compagnies était commandée par le conseiller Ménardeau-Champré, on fit à cette occasion une Mazarinade sous le titre de Guerre des Ménardeaux[181].[T.I pag.111]
Le procureur général, Nicolas Fouquet, courut un sérieux danger dans cette émeute. On tira sur le carrosse où il se trouvait. Mazarin, qui était alors à Melun, écrivait le lendemain, 26 juin, à l'abbé Fouquet: «Par le péril qu'a couru M. votre frère, parce qu'il était dans votre carrosse et par les autres circonstances que vous me marquez, je suis dans des transes continuelles de ce qui vous peut arriver, et, quoique vos soins soient plus utiles que jamais dans les conjonctures présentes, je ne puis m'empêcher de vous conjurer de vous ménager un peu et de donner quelques limites à votre zèle, en sorte qu'il ne vous fasse pas exposer à des dangers trop évidents. On suivra l'avis de s'approcher le plus qu'on pourra de Paris, et cette approche, jointe aux forces du roi, à la bonne disposition qui commence à paraître dans les esprits à Paris, et aux diligences que les serviteurs du roi feront de leur côté, y pourra peut-être causer une révolution favorable aux affaires de Sa Majesté.» L'armée royale, commandée par Turenne, se rapprocha, en effet, de Paris, et vint camper à Saint-Denis. Les princes, de leur côté, amenèrent à Saint-Cloud les troupes qui avaient été assiégées dans Étampes, et auxquelles le traité conclu avec le duc de Lorraine avait rendu la liberté. Il était impossible que ces deux armées, ainsi rapprochées, n'en vinssent pas bientôt aux mains. On touchait à la crise définitive de cette lutte acharnée, mêlée d'incidents burlesques et de scènes sanglantes.[T.I pag.112]