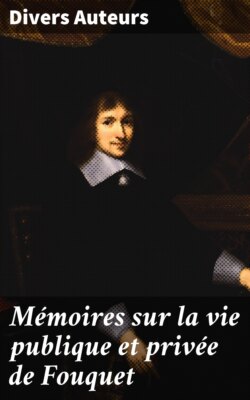Читать книгу Mémoires sur la vie publique et privée de Fouquet - Divers Auteurs - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLe duc d'Orléans est déclaré lieutenant général du royaume et le prince de Condé généralissime des armées (20 juillet).—Conseil établi par les princes; disputes de préséance; duel de Nemours et de Beaufort (30 juillet); querelle de Condé et du comte de Rieux (31 juillet).—Désordres commis par les troupes des princes.—Mécontentement de la bourgeoisie parisienne; assemblées aux halles et au cimetière des Innocents (20 août).—Mazarin s'éloigne pour quelque temps; sa correspondance avec les deux Fouquet.—Chavigny négocie avec la cour au nom des princes.—Inquiétude que le cardinal de Retz inspire à Mazarin.—Retz se rend à la cour (9 septembre), et veut traiter avec la reine au nom du duc d'Orléans.—Il n'y réussit pas.—L'abbé Fouquet excite la bourgeoisie parisienne et négocie avec Chavigny.—Assemblée des bourgeois au Palais-Royal (24 septembre); ils se déclarent antifrondeurs.—Conférence de l'abbé Fouquet avec Goulas (26 septembre).—Il part pour la cour.—On intercepte une lettre de l'abbé Fouquet adressée au secrétaire d'État le Tellier.
En présence des ordres précis et de l'attitude décidée de la cour, les princes n'avaient plus qu'à déposer les armes ou à déclarer ouvertement la guerre au roi. Ils n'hésitèrent pas à prendre ce dernier parti. Le parlement et la bourgeoisie, terrifiés par les dernières violences, les suivirent pendant quelque temps et parurent adhérer à toutes leurs résolutions. Dès le 20 juillet, le duc d'Orléans fut proclamé lieutenant général du[T.I pag.152] royaume par arrêt du parlement[281]; le prince de Condé fut en même temps nommé généralissime des armées. «Ceux qui ne furent pas de l'avis de l'arrêt, ajoute Omer-Talon, reconnurent, en sortant de la Grand'Chambre, qu'il était bien heureux que leur avis n'eût pas été suivi, parce que toutes choses étaient disposées pour la violence.» Le premier soin du régent fut d'organiser un conseil de gouvernement, où devaient siéger, avec les deux princes, le chancelier Pierre Séguier; le duc de Nemours, prince de la maison de Savoie; le duc de Beaufort, qui fut bientôt nommé gouverneur de Paris; le prince de Tarente, de la maison de la Trémouille; le duc de Rohan, le prince de Guéménée et plusieurs autres. A peine établi, ce conseil donna lieu à des querelles de préséance et à des scènes sanglantes. Le duc de Nemours provoqua le duc de Beaufort, son beau-frère, contre lequel il nourrissait une haine invétérée. Le duel eut lieu le 30 juillet, et Nemours y fut tué[282]. Le lendemain, le comte de Rieux, second fils du duc d'Elbeuf, ayant disputé la préséance au prince de Tarente, Condé intervint avec sa hauteur ordinaire, et, sur un mot blessant du comte de Rieux, il lui donna un soufflet. Le comte riposta par un coup, qui n'atteignit Condé qu'à l'épaule[283]. Au moment où le prince saisissait une épée, les témoins de cette scène, et entre autres le duc de Rohan, se jetèrent entre lui et le comte de[T.I pag.153] Rieux. Ce dernier fut arrêté et conduit à la Bastille par ordre du duc d'Orléans.
Ces luttes scandaleuses déconsidéraient le parti des princes, et en même temps les excès de leurs troupes le rendaient odieux. Depuis le combat du faubourg Saint-Antoine, elles campaient au faubourg Saint-Victor et pillaient les villages voisins. Sur les plaintes des habitants[284], les princes les éloignèrent, et on les dirigea vers Corbeil. Mais lorsque les habitants de cette ville apprirent l'approche des bandes de pillards, ils coupèrent leur pont et leur fermèrent le passage. Il fallut ramener la petite armée des princes à Saint-Cloud, d'où elle continua de dévaster les campagnes. Plus tard, on voulut de nouveau l'établir dans les faubourgs Saint-Victor et Saint-Marceau; mais les habitants se barricadèrent elles repoussèrent[285]. Pendant que les troupes des princes se livraient à ces désordres, les ennemis pénétraient dans le nord de la France et menaçaient les villes de Gravelines et de Dunkerque, anciennes conquêtes du duc d'Orléans et du prince de Condé. Ainsi les chefs de la Fronde sacrifiaient à leur ambition le repos, l'intérêt et l'honneur de la France.
Il était impossible que la bourgeoisie honnête et éclairée ne gémît pas d'une pareille oppression, surtout lorsqu'il fallut payer les taxes établies par le conseil des princes. Elle commençait à murmurer, et, dès qu'on[T.I pag.154] fut certain que le cardinal Mazarin était parti, elle se rassembla au cimetière des Innocents et sous les piliers des halles pour délibérer sur la situation présente et y porter remède. Les Parisiens résolurent d'envoyer des députations au duc d'Orléans pour le prier d'éloigner ses troupes de la capitale, et décidèrent qu'ils s'adresseraient directement au roi pour le supplier de revenir dans sa bonne ville de Paris[286]. Le parlement exprima le même vœu, et les princes déclareront qu'ils étaient disposés à s'y rendre, pourvu que la retraite du cardinal Mazarin fût sans apparence de retour. Ils espéraient, grâce à cette restriction, éluder les instances des Parisiens. Mais les partisans de la cause royale avaient repris courage, et ils ne cessèrent depuis cette époque de manifester leurs sentiments avec énergie. Nous retrouvons toujours à leur tête les deux Fouquet.
Mazarin, qui s'acheminait lentement vers l'exil, écrivait, de Reims, à l'abbé Fouquet (27 août): «Je vous remercie de tout mon cœur de la continuation de vos soins et de votre affection. Je vous prie d'assurer aussi M. le procureur général que j'ai une parfaite connaissance de la manière dont il agit. Vous lui manderez qu'il faut que lui et les autres du parlement portent les choses hautement et avec plus de vigueur que jamais, comme il a été concerté, parce que ceux de Paris n'oublieront rien pour affaiblir leurs résolutions ou mettre de la sédition entre eux, n'ayant plus d'autre ressource; car sans cela il faudra bien qu'à la fin ils se[T.I pag.155] mettent à la raison. Il faudrait tâcher de faire en sorte que les conseillers du parlement qui est à Pontoise ne désemparent point, et d'y en faire venir d'autres. Je crois qu'il serait bon d'y envoyer quelques-uns des maîtres des requêtes qui sont auprès du roi, n'étant pas malaisé, ce me semble, d'en faire venir d'autres de Paris en leur place, et ainsi l'on remédiera à l'inconvénient que vous me marquez du petit nombre de membres du parlement.» En terminant, Mazarin recommandait à l'abbé Fouquet de veiller à l'union et au concert de tousses amis. «Je vous prie, lui disait-il, de faire mes compliments à madame et à mademoiselle de Chevreuse, et surtout de contribuer en tout ce qui dépendra de vos soins pour tenir tous mes amis bien unis ensemble, particulièrement M. Servien et M. le Tellier[287] avec M. le procureur général, afin qu'ils agissent de concert en tout ce qui regarde le parlement et les propositions d'accommodement qui pourraient être faites.»
Les princes, voyant que la bourgeoisie, le parlement et le clergé étaient disposés à envoyer des députations au roi pour le supplier de rentrer à Paris, annoncèrent l'intention de prendre part à cette démarche, et firent demander des passe-ports pour le maréchal d'Étampes, le comte de Fiesque et la Mothe-Goulas, qui devaient se rendre à Compiègne où était la cour[288]. Leur demande[T.I pag.156] fut rejetée, comme ils s'y attendaient. Aussi avaient-ils adopté d'autres mesures. Ils appelaient en France des auxiliaires allemands que leur amena le duc Charles de Lorraine. Mécontent de la cour qui ne lui avait pas rendu ses États et toujours avide de pillage, le duc de Lorraine vint de nouveau apporter aux princes un secours aussi odieux et aussi inutile que le premier. Les troupes des princes rivalisaient de violences avec les Lorrains. Elles envahirent et pillèrent les faubourgs Saint-Germain, Saint-Jacques et Saint-Marceau. Elles se répandirent ensuite sur les deux rives de la Seine, aux faubourgs Saint-Victor et Saint-Antoine, et continuèrent à vivre aux dépens des habitants.
Les bourgeois, irrités de la conduite des princes, se réunirent alors en plus grand nombre et avec plus de hardiesse. «A quoi bon, disaient-ils[289], tant de délais? Que n'allons-nous trouver le roi et le prier de venir en sa bonne ville de Paris?» Les plus intrépides déclarèrent aux frondeurs qu'ils étaient disposés à demander au roi des troupes pour chasser les bandes de pillards qui ravageaient Paris et les environs.
En même temps on recevait de tous côtés de mauvaises nouvelles pour le parti des princes: Montrond (Cher), une de leurs principales forteresses, était pris. Le chancelier, qui pendant quelque temps avait suivi le parti des frondeurs, et le président de Mesmes,[T.I pag.157] étaient allés rejoindre le parlement de Pontoise, dont l'autorité commençait à s'établir. Enfin, les politiques du parti des princes reconnaissaient qu'il fallait songer à se réconcilier avec la cour. A leur tête était Chavigny. «Je vous dirai, dans la dernière confidence, écrivait Mazarin à l'abbé Fouquet le 5 septembre, que M. de Chavigny m'a fait savoir, par le moyen de M. Fabert, que M. Goulas se devait aboucher avec vous, et, comme vous ne m'en mandez rien, cela me met en peine. Il faudrait vous conduire dans cette conférence, selon ce que vous diraient MM. Servien et le Tellier, et je serais d'autant plus aise que les affaires passassent par les mains de M. Goulas, que je le sais très-homme d'honneur et extrêmement des amis de M. le procureur général. Vous pouvez aller à Pontoise, et vous m'obligerez de dire à M. le procureur général que j'ai la dernière confiance en lui sans aucune réserve.»
Le lendemain, 6 septembre, Mazarin écrivait au procureur général, Nicolas Fouquet, les lettres suivantes, qui attestent à quel point il comptait sur lui: «Je vous suis très-obligé du soin que vous avez voulu prendre de m'informer de ce qui s'est passé à Pontoise depuis mon départ, et de ce que vous avez appris du coté de Paris. Je n'ai pas écrit une lettre à M. votre frère que je ne l'aie prié de vous bien assurer de mon amitié, et que je me confie de tout en vous sans aucune réserve. Je vous confirme la même chose, et j'ose vous dire que, si vous pouviez voir là-dessus mes véritables sentiments, vous en seriez assurément fort satisfait.
«C'est un mal que le nombre de ceux qui composent[T.I pag.158] le parlement[290] soit si petit; mais comme l'on me mande de Compiègne que l'on y envoyait les maîtres des requêtes qui étaient auprès du roi, que je crois que M. de Mesmes et son fils parlaient pour le même effet et en très-bonne disposition de servir le roi, et que d'autres conseillers devaient sortir de Paris pour s'y rendre, je m'assure qu'à présent la compagnie sera bien augmentée.
«Je ne vois pas que de la cour on ait inclination à permettre à M. de Longueil d'y aller sans tout le reste de la famille, parce que, s'il y était, il semble que cela pourrait empêcher en quelque façon que l'on n'agit contre ses proches. Néanmoins, je vous prie d'en mander votre sentiment à MM. Servien et le Tellier aussi bien que toutes les pensées qui vous viendront dans l'esprit sur d'autres matières, parce que je sais qu'à la cour on y déférera extrêmement.
«Je sais ce que vous a mandé M. Goulas; c'est une personne pour qui j'ai estime et affection, et que je crois fort homme d'honneur et bien intentionné. Mais je veux bien vous dire qu'il semble qu'il use d'une manière de menaces dans son écrit, et qu'elles sont fort superflues à mon égard. Car je vous jure devant Dieu que je me confinerais avec joie en Canada, si je croyais que cela pût établir la tranquillité du royaume, et que l'on se trompe fort si ou croit que le désir de mon retour puisse contribuer en aucune façon à me faire faire un pas de plus ou de moins en ce que je ne croirai pas être du service du roi.[T.I pag.159]
«J'ai trouvé très-judicieux et bien conçu ce que vous me mandez sur le refus qu'on a fait des passe-ports[291], et je ne crois pas que la seconde fois il y eût un inconvénient de les accorder conditionnés comme vous le marquiez et avec les mêmes précautions, c'est-à-dire de ne souffrir les députés traiter avec personne, et de leur imposer silence, s'ils voulaient parler d'autre chose au roi que de remercîments et des offres d'exécuter ce que Sa Majesté désirait. Mais à présent qu'elle s'est encore plus engagée à ce refus, je crois que l'on y doit persister, parce que l'on ne pourrait pas retourner en arrière, sans que cela fût imputé à faiblesse.
«Je vous dirai de plus sur ce sujet, dans la dernière confidence, que M. de Chavigny m'a fait savoir, par le moyen de M. Fabert, que l'on était fort porté à Paris à l'accommodement, et que M. Coulas se devait aboucher avec M. votre frère, qui néanmoins ne m'en a rien écrit; de sorte qu'en ce cas il n'est plus besoin de députation, et il nous est bien plus avantageux que les choses se passent par cette voie, parce que, si cette conférence ne produit rien de bon pour nous, il sera fort aisé à Leurs Majestés de dire qu'elles n'en ont eu aucune connaissance, en cas que les princes en voulussent tirer avantage en la publiant, et il n'en serait pas de même d'une députation publique, où il ne se passerait rien que tout le monde ne sût.
«Je vous prie de faire mes recommandations à mes amis de delà, et particulièrement à ceux qui sont du grand secret, et surtout à M. le Coigneux, de qui, à[T.I pag.160] vous parler franchement, je vous dirai que la manière me plaît au dernier point, et que je prétends, à quelque prix que ce soit, qu'il soit mon ami de la bonne sorte.
«Il est impossible que le cardinal de Retz ne remue quelque chose en tout ceci; il faut bien prendre garde à lui; car assurément il n'a rien de bon dans l'âme, ni pour le roi, ni pour l'État, ni pour moi. J'en ai écrit au long à MM. Servien et le Tellier, et je vous conjure aussi de n'oublier rien de votre côté pour rompre ses desseins, en cas que vous les puissiez pénétrer.
«Je vous prie aussi de voir si, par le moyen des amis que vous avez à Paris, on pourrait adroitement, même en y employant quelque argent, ramener les esprits à mon égard, puisqu'ils commencent déjà à être mal satisfaits des princes, et qu'il y a apparence qu'ils le seront toujours de plus en plus.»
Une seconde lettre, du même jour, montre quelles étaient, à ce moment, les inquiétudes du cardinal. Il redoutait surtout le marquis de Châteauneuf et le cardinal de Retz; il connaissait leur habileté, leur ambition et leurs intrigues. «Je vous fais ce mot à part, écrivait-il à Nicolas Fouquet, pour vous dire qu'il est faux que M. le Prince ait envoyé vers moi, comme M. de Châteauneuf a assuré, s'il ne veut entendre ce que M. de Chavigny a écrit à M. Fabert. J'eusse été de votre avis à l'égard de la proposition que ledit Châteauneuf avait faite d'envoyer une personne de confiance en secret à Paris; car, comme vous dites, on aurait pu tout désavouer, si l'intérêt du roi l'eût ainsi requis. Mais, si l'abbé Fouquet a[T.I pag.161] vu Goulas, ce sera la même chose, et beaucoup mieux, puisque ledit Châteauneuf ne sera pas même de l'affaire.
«Je vous conjure de vous appliquer à rompre, par toutes sortes de voies, les desseins du cardinal de Retz, et de croire comme un article de foi, que, nonobstant toutes les belles choses qu'il fera et les protestations de sa passion au service de la reine et de vouloir me servir sincèrement et de pousser M. le Prince, il n'a rien de bon dans l'âme, ni pour l'État, ni pour la reine, ni pour moi. Il faut donc bien garder les dehors et empêcher qu'il ne s'introduise et qu'il ne puisse jouer en apparence, ni à la cour ni à Paris, le personnage de serviteur du roi bien intentionné; car il est incapable de l'être jamais en effet. Vous n'aurez pas grand'peine avec la reine sur ce sujet; car elle le connaît trop bien pour s'y fier jamais.
«Si par les artifices du cardinal de Retz ou autrement, il s'élevait quelque orage contre moi à Paris, comme de parler au roi contre mon retour, ou choses semblables, je crois qu'on pourrait faire en sorte que toute la maison du roi, y comprenant les officiers des gardes françaises et suisses, ceux des gardes du corps et des chevau-légers et gendarmes, parlât avec grand respect au contraire, disant avoir jugé à propos de dire en ce rencontre leurs sentiments à Sa Majesté, afin qu'elle sût qu'ils étaient tous prêts à périr pour soutenir son autorité en une affaire de cette importance, dans laquelle la cabale et l'artifice agissaient pour des intérêts particuliers et non pas pour le motif de son service. Cette[T.I pag.162] proposition est indigeste, et j'espère qu'on ne sera pas obligé d'en venir là; mais je vous dis en confidence mes pensées, afin que vous y fassiez réflexion en cas de besoin, sans en parler à qui que ce soit qu'à la reine.
«Peut-être c'est un soupçon mal fondé; mais je doute que MM. d'Épernon et de Candale tireront de longue à faire une réponse définitive sur le mariage[292], et que, donnant toujours de bonnes paroles, ils tâcheront cependant de tirer tous les avantages qu'ils pourront. C'est pourquoi je crois qu'il ne leur en faut accorder aucun, mais tenir les choses en suspens, et se conduire en sorte qu'ils connaissent qu'on ne veut rien faire qu'on ne voie auparavant la résolution qu'ils prendront sur ledit mariage, et il ne serait pas mal que vous en dissiez un mot comme de vous à M. de Miossens[293].»
On voit, par ces lettres, que Mazarin était vivement préoccupé des intrigues du cardinal de Retz, et qu'il cherchait à les déjouer. En effet, cet ancien chef de la Fronde, toujours ambitieux et prêt à profiter des circonstances, voyait le parti des princes en décadence, et la bourgeoisie avide de paix, mais encore hostile à Mazarin; il espéra que le tiers parti, qu'il avait tenté plusieurs fois d'établir, pourrait enfin triompher[294]. Sous[T.I pag.163] prétexte d'aller recevoir la barette, ou bonnet de cardinal, des mains du roi, il résolut de se rendre un grande pompe à Compiègne, qu'habitaient alors Louis XIV et la reine Anne. L'abbé Fouquet s'opposa avec beaucoup d'énergie à ce que la cour reçût cet ambitieux. C'est Retz lui-même qui nous l'apprend. «L'abbé Fouquet, dit-il[295], revenait à la charge, et soutenait que les intelligences qu'il avait dans Paris y rétabliraient le roi au premier jour, sans qu'il en eût obligation à des gens qui ne proposaient de l'y remettre que pour être plus en état de s'y maintenir eux-mêmes contre lui.» Ce témoignage d'un ennemi ne laisse aucun doute sur le zèle que mettait l'abbé Fouquet à soutenir les intérêts de Mazarin. Il dut céder en cette occasion, et, le 9 septembre, le cardinal de Retz partit en grande pompe pour Compiègne. Il dit lui-même, dans ses Mémoires[296], qu'il avait dans son cortège près de deux cents gentilshommes et cinquante gardes du duc d'Orléans. Les députés du chapitre de Notre-Dame, les curés de Paris et des congrégations religieuses, telles que celles de Saint-Victor, Sainte-Geneviève, Saint-Germain des Prés, Saint-Martin des Champs, le suivaient et remplissoient vingt-huit carrosses à six chevaux[297].
Le 11 septembre, M. de Berlise, introducteur des ambassadeurs, vint prendre dans un carrosse du roi le camérier du pape et le cardinal de Retz. Il les conduisit[T.I pag.164] au château de Compiègne, où le roi remit au cardinal le bonnet rouge. Le cardinal prononça ensuite une harangue, qu'il a eu soin de nous conserver[298]. Il y retraçait les maux de la France: «Nous voyons, disait-il, nos campagnes ravagées, nos villes désertes, nos maisons abandonnées, nos temples violés, nos autels profanés.» Pour mettre un terme à ces malheurs, il exhortait le roi à rentrer dans sa bonne ville de Paris, et à imiter les exemples de clémence que lui avait donnés son aïeul Henri IV. Le roi manifesta, dans sa réponse, des dispositions bienveillantes pour les Parisiens, mais en se tenant dans de vagues généralités.
Après ces pompeuses cérémonies et ces discours d'apparat, qui étaient bons pour amuser la foule, le cardinal de Retz voulut entrer dans le secret des affaires[299]. Il promit, au nom du duc d'Orléans, que Gaston se séparerait du prince de Condé et signerait la paix de bonne foi, pourvu que Condé conservât ses gouvernements. Un l'écouta; mais on ne prit pas au sérieux ses propositions. Lui-même avoue que l'abbé Fouquet, qui se trouvait alors à Compiègne avec la mission d'éclairer toutes ses démarches, se moquait de la dépense qu'il faisait[300]. «Il est vrai, ajoute Retz, qu'elle fut immense pour le peu de temps qu'il dura. Je tenais sept tables servies en même temps, et j'y dépensais huit cents écus par jour.» Le cardinal prétend qu'il fut dédommagé de ces dépenses excessives et des railleries de la cour par l'accueil qu'il[T.I pag.165] reçut à Paris. Ce qui est certain, c'est que sa négociation échoua complètement. L'abbé Fouquet, au contraire, réussit à provoquer dans Paris une manifestation énergique en faveur de la cause royale. Quant à l'intrigue secrète qu'il avait nouée avec Chavigny et Goulas, il la poursuivit mystérieusement jusqu'au jour où il devint inutile de dissimuler les projets et les forces du parti de la cour.
Le but principal de cette négociation était de séparer le duc d'Orléans du prince de Condé, Mazarin était persuadé que le second ne voulait pas sincèrement la paix. «M. le Prince, écrivait-il à l'abbé Fouquet le 24 septembre, n'a veine qui tende à l'accommodement, entrant en de nouveaux engagements et se liant tous les jours de plus en plus avec les Espagnols. Quoi qu'il en soit, il importe d'en être éclairci promptement et de façon ou d'autre, pour prendre résolution là-dessus. J'ai écrit au long à M. le Tellier sur ce sujet, et comme l'on vous aura donné connaissance de tout pour vous former la réponse que vous avez eue à faire à Paris, je n'ai rien à ajouter sur cette matière. C'est à ceux qui agissent sur les lieux par ordre de Leurs Majestés à y mettre la dernière main. Surtout la diligence est nécessaire, et il ne faut plus faire de renvoi vers moi pour cet effet.
«Il faut cultiver soigneusement les bonnes intentions de M. Goulas et s'en prévaloir pour détacher Son Altesse Royale de M. le Prince, en cas que M. le Prince ne veuille point la paix. Il faudra aussi se souvenir en son temps de ce qu'il propose pour le cardinal de Retz. Cependant[T.I pag.166] je vous prie de l'assurer de la bonne manière de mon amitié et de mon estime.
«C'est bien fait d'insinuer à M. de Chavigny qu'il ne sera pas épargné, si M. le Prince commence une fois à maltraiter, les serviteurs du roi en leurs biens. Au reste, je ne sais quel sujet nouveau il peut avoir de me haïr depuis les protestations qu'il me fit du contraire à Saint-Germain[301], et qu'il m'a confirmées par diverses voies.
«La reine a grande raison d'être satisfaite de M. le procureur général. Je ne vous puis celer l'inquiétude que j'ai de voir que vous me mandez qu'il mérite bien qu'on prenne quelque soin de le ménager; car si cela regarde la confiance, je pense que M. le Tellier n'en use point autrement avec lui qu'il ferait avec moi-même. Et pour l'affection, je ne cède à personne, comme je crois qu'il est entièrement de mes amis.
«Ce que vous m'écrivez à l'égard de madame la Palatine[302] est superflu. S'il est besoin qu'elle agisse, vous n'avez qu'à conférer avec M. Servien et M. le Tellier de ce qu'elle aura à faire, et après, sur un mot de la reine, je vous assure qu'elle fera tout ce qu'on voudra sans hésiter. Ce qui est d'autant plus vrai que je puis vous dire confidemment qu'elle n'est pas trop satisfaite du cardinal de Retz.»
La fin de la lettre de Mazarin est surtout remarquable.[T.I pag.167] Elle prouve qu'il avait le cœur plus français que ces princes qui laissaient les Espagnols s'emparer de Gravelines et de Dunkerque. Après avoir parlé de la difficulté de secourir Barcelone, qui était encore au pouvoir des Français, il ajoutait: «Je vous avoue que je suis fort touché de voir que, nonobstant toutes les peines que j'ai prises, la Catalogne se perd, et le roi en souffre un préjudice qu'on ne saurait réparer en des siècles entiers.»
Le jour même où Mazarin écrivait cette lettre, 24 septembre, quatre ou cinq cents bourgeois, dirigés par M. le Prévost, chanoine de Notre-Dame de Paris et conseiller clerc de la Grand'Chambre, se réunirent au Palais-Royal, et, plaçant à leurs chapeaux des morceaux de papier au lieu de la paille des frondeurs, annoncèrent l'intention de rappeler le roi dans Paris, malgré les princes[303]. Le duc d'Orléans envoya le maréchal d'Étampes pour connaître le but de cette réunion. Les bourgeois ne le dissimulèrent pas, et quelques-uns même, poussant des cris de menace et de provocation, s'écrièrent: La paille est rompue. Point de princes; vive le roi, notre seul souverain[304]! Le maréchal d'Étampes, bien loin de pouvoir réprimer ce mouvement royaliste, fut obligé de prendre le signe du parti et de rompre la paille. L'abbé Fouquet n'avait pas manqué de se trouver à cette assemblée. «Dès que j'y fus, écrivait-il au secrétaire d'État le Tellier, les bour[T.I pag.168]geois, qui étaient réunis en grand nombre, sont venus à moi avec la dernière joie, me demandant ce qu'ils avaient à faire et quel ordre il y avait pour eux. Ils voulaient aller au palais d'Orléans[305] et exciter des séditions par les rues. Je n'ai pas cru que l'affaire se dût mal embarquer; j'ai pensé qu'il était nécessaire que j'envoyasse en diligence demander les hommes de commandement que l'on voulait mettre à leur tête. Il ne faut pas perdre un moment de temps pour les envoyer. Le maréchal d'Étampes passa; ils l'ont obligé à prendre du papier, dont il a été assez embarrassé, et sur ce que je lui ai dit qu'il en verrait bien d'autres, il m'a répondu qu'il ne fallait point faire de rodomontades, et qu'il fallait conclure la paix.
«M. le duc d'Orléans a souhaité de me voir; j'ai été une bonne heure avec lui; j'ai trouvé seulement qu'il a un peu insisté sur les troupes[306], disant qu'il ne voulait que sortir honorablement de cette affaire. Je lui ai dit que, quand même on les accorderait, elles seraient cassées au premier jour. Il a ajouté que, si l'on en réformait d'autres, il consentait que celles-là le fussent aussi. Il m'a dit qu'il n'était point d'avis que l'on mit par un article séparé, que M. de Beaufort sortirait de Paris; qu'il lui ferait faire ce qu'il trouverait juste; que, pour le parlement, il serait bien aise que la réunion[307] se fit de manière qu'elle ne blessât point l'autorité[T.I pag.169] du roi; mais qu'il serait bien aise que le parlement ne fût pas mal satisfait de lui. Et par-dessus, M. de Chavigny m'a assuré que, quand M. le Prince ne s'accommoderait point, Monsieur s'accommoderait. J'ai vu qu'il voulait être médiateur entre la cour et M. le Prince, ayant voulu entrer dans le détail de tous les articles. Nous aurons contentement, pourvu qu'il ne vienne point de faux jours à travers qui détournent M. le duc d'Orléans. Tous les amis de M. le Prince approuvent les propositions de la manière dont la cour souhaite qu'elles passent. J'espère une trêve dès demain. Il y a une chose que M. de Chavigny me propose: c'est que M. le duc d'Orléans aurait peine à consentir que M. le cardinal fût nommé dans l'amnistie; qu'il était bon que l'on cassât tous les arrêts qui ont été donnés, et que M. le cardinal fût justifié par une déclaration particulière, et la raison de cela est qu'il fallait que Monsieur reçût l'amnistie, et qu'il aimait mieux solliciter secrètement la justification.
«Autant que je puis conjecturer, les affaires réussiront bien. Peut-être demandera-t-on quelque argent pour le rétablissement de Taillebourg[308]. Quant à Jarzé[309], n'ayant ordre de rien accorder, je me tiendrai ferme là-dessus. M. de Broussel s'est démis de la prévoie des marchands et s'en est repenti deux heures après, et, sur ce repentir, M. le duc d'Orléans demanda à M. de[T.I pag.170] Chavigny ce qu'il, avait à faire. Il lui répondit: Il s'en est démis, sans vous en parler; parlez-lui en, sans le rétablir. Si les affaires s'échauffent un peu, c'est un homme que je vois bien qu'on pourra accabler.
«Le cardinal de Retz fut hier deux heures avec M. de Lorraine, et lui fit espérer de grands avantages, s'il se voulait lier avec lui, et dit en même temps qu'il a fait avertir les têtes de papier (c'est ainsi que l'on nomme la nouvelle union), qu'il gouvernait tout à la cour, et qu'ils ne réussiraient jamais s'ils ne le demandaient pour leur chef[310]. Sur ce, la plupart me sont venus demander avis; je leur ai dit qu'il était bon d'avoir des gens de guerre à leur tôle; qu'il fallait faire beaucoup de civilités au cardinal de Retz, et même, s'il a des amis, lui demander secours; mais que, pour suivre ses ordres, cela n'était pas nécessaire. Demain, à dix heures du matin, j'aurai la dernière résolution de toutes choses. M. le Prince, si la paix ne se conclut point, ne voyant plus de sûreté pour lui dans Paris, emmènera son armée. Il est nécessaire que l'on nous envoie des placards imprimés.»
Le lendemain, 26 septembre, l'abbé Fouquet, après être resté trois heures en conférence avec Goulas et avoir pris les derniers arrangements, se mit en route pour rejoindre la cour[311].
Le parti royaliste introduisit dans Paris une centaine d'hommes résolus, soldats déguisés, qui devaient se[T.I pag.171] porter aux dernières violences contre les frondeurs obstinés[312]. Si l'on ajoute à ces négociations et à ces agitations intérieures les succès de l'armée de Turenne campée à Villeneuve-Saint-Georges, l'approche de la cour, qui s'établit à Pontoise, la maladie et le découragement du prince de Condé, on comprendra que la Fronde expirait, et qu'il ne s'agissait plus que de lui porter les derniers coups. Un incident en retarda la ruine. La lettre de l'abbé Fouquet, que nous venons de citer, fut interceptée[313], et le duc d'Orléans, pour ne pas rompre ouvertement avec le prince de Condé, suspendit pendant quelque temps les négociations avec Mazarin.[T.I pag.172]