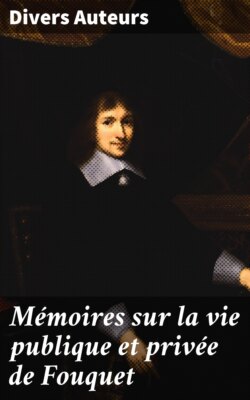Читать книгу Mémoires sur la vie publique et privée de Fouquet - Divers Auteurs - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеInquiétude que les divisions du parti royaliste inspirent à Mazarin.—Dans sa réponse au procureur général (12 octobre), il montre que le prince de Condé n'a jamais traité avec sincérité et que n'espérant pas conclure la paix avec lui, il a dû en référer au conseil du roi.—Il est disposé, quant à lui, à demeurer exilé toute sa vie si le service du roi l'exige, et approuve le projet de ramener le roi à Paris.—Peu de sincérité de cette lettre.—Mazarin est plus explicite avec l'abbé Fouquet: il exprime le désir de voir continuer les négociations particulières avec Goulas, et souhaite que l'on détermine le duc d'Orléans à se retirer dans son apanage.—Mazarin souhaite vivement entrer à Paris avec le roi; il va se rendre à Sedan et se tenir prêt à rejoindre la cour, dès qu'il sera nécessaire.—Inquiétude que lui inspirent le cardinal de Retz et ses relations avec l'hôtel de Chevreuse.—L'abbé Fouquet reçoit d'un des confidents de Mazarin des renseignements sur les causes de sa disgrâce.—Il conserve toute la confiance du cardinal, qui le charge de hâter son retour, au moment où la cour se rapproche de Paris.—Départ de Condé et du duc de Lorraine (13 octobre).—Entrée du roi à Paris (21 octobre).
Mazarin voyait avec peine la division se mettre dans le parti royaliste au moment où son triomphe semblait assuré. Il se hâta d'écrire au procureur général et à l'abbé Fouquet pour les apaiser. Il parla au premier avec les ménagements qu'exigeait la dignité d'un magistrat, interprète des opinions et des vœux du parlement fidèle. Quant à l'abbé Fouquet, il s'efforçait de[T.I pag.190] lui ouvrir les yeux et de lui prouver qu'il était dupe de madame de Châtillon, mais il évitait de blesser la vanité d'un partisan aussi dévoué. C'est seulement dans la lettre d'un confident du ministre que l'on trouve toute sa pensée. Ce dernier plaisante l'abbé Fouquet sur l'influence qu'exercent les beaux yeux de madame de Châtillon, et, en même temps, il lui fait entendre que c'est le secrétaire d'État le Tellier qui l'a desservi près de la reine, et lui a fait enlever la direction de la négociation avec les princes. Le ton de ces trois lettres marque bien les nuances et fait connaître les intrigues secrètes qui s'agitaient à la cour en l'absence du cardinal. Voici d'abord la lettre que Mazarin écrit au procureur général, Nicolas Fouquet, en réponse à ses plaintes:
«Je vous suis très-obligé des bons avis que vous me donnez de concert avec MM. les présidents, auxquels je vous prie d'en faire mes remercîments, et de les assurer que je conserverai toujours une particulière reconnaissance de l'affection qu'ils me témoignent. Il n'y aurait rien de plus fort ni de plus judicieux que le raisonnement que vous faites touchant l'accommodement avec les princes, si le principal fondement sur lequel vous l'établissez pouvait subsister; mais vous présupposez que M. le Prince donnerait volontiers les mains à l'accommodement, et il n'y a rien de si certain que jamais il n'en a été plus éloigné qu'à présent et n'a été plus persuadé de pouvoir aisément faire réussir ses desseins, étant pour cet effet entré en de nouveaux engagements avec les Espagnols, qui sont si étroits et si précis,[T.I pag.191] que, quand même il lui viendrait des pensées de s'accommoder, il ne passerait pas outre, qu'au préalable il ne leur eût fait donner satisfaction par la paix générale, comme il est porté par son traité, et comme depuis peu il en a fait faire des promesses positives de sa part à don Louis de Haro par Saint-Agoulin, qui est en Espagne, et à Fuensaldagne par Saint-Romain et par d'autres qu'il lui a dépêchés après lui, le priant de ne concevoir aucun soupçon du contraire sur le bruit des négociations qui seraient sur le tapis, auxquelles il était obligé de prêter l'oreille, pour ne s'attirer pas la haine des peuples et pour ne donner pas sujet à M. le duc d'Orléans de se séparer de lui. C'est la pure vérité que je vous dis, et je n'ai pas eu grande peine à me confirmer dans cette créance, après avoir vu le refus qu'il a fait des marques si extraordinaires de la bonté du roi, que M. l'abbé Fouquet lui avait portées; de sorte que ce n'est pas le plus ou le moins des conditions du traité qui en arrête la conclusion, mais le défaut de volonté en M. le Prince.
«Je demeure d'accord de ce que vous dites que, pour rétablir l'autorité royale, pacifier le dedans du royaume et faire cesser les maux que la guerre civile fait souffrir, le roi se devrait beaucoup relâcher, et vous voyez bien aussi à quel point on l'a fait, puisque toute la cour en a murmuré jusqu'à dire que je faisais bon marché de l'intérêt du roi, parce que cela servait au mien particulier. Enfin, il est assez vraisemblable que, si M. le Prince avait eu la moindre disposition à s'accommoder, il ne se serait pas arrêté de le faire pour[T.I pag.192] la suppression de la cour des aides et pour procurer plus ou moins d'avantages au comte du Daugnion.
«En outre, il faut considérer que M. le duc d'Orléans, qui témoigne une si grande passion de faire son accommodement avec M. le Prince, est tombé d'accord qu'on lui accorde plus de grâces qu'on ne devait. En dernier lieu, S.A.R. et M. de Lorraine se sont laissés entendre sur ce sujet à diverses personnes, qu'on n'avait pas grand soin à la cour de ménager la dignité du roi, et vous aurez même su que M. de Châteauneuf a publié partout qu'il avait offert de faire conclure l'accommodement à des conditions bien plus honorables et plus avantageuses pour Sa Majesté que celles qu'on a envoyées à M. le Prince par M. votre frère.
«Il est vrai que, lorsque j'ai vu que tout ce qui se traitait avec M. le Prince était public, tant à Paris qu'à la cour, et qu'il n'y avait pas grande apparence de rien conclure, j'écrivis que j'estimais du service du roi que l'on examinât cette affaire dans le conseil, afin de ne demeurer pas seul garant de l'événement, et qu'on ne donnât pas sujet à ceux dudit conseil qui n'étaient pas de ce secret, de blâmer également la conduite qu'on aurait tenue, soit que la chose réussit ou ne réussît pas.
«Vous me dites que mon retour à la cour dans la condition présente des affaires pourrait peut-être faire un méchant effet. Cependant, lorsque j'en partis, l'on ne présupposait pas que les princes se dussent accommoder; mais au contraire que, mon éloignement n'empêchant pas que la guerre ne continuât, les peuples se[T.I pag.193] dessillant les yeux connaîtraient à la fin que je n'étais que le prétexte et non pas la cause des maux qu'on leur faisait souffrir; ce qui étant, je pourrais m'en retourner auprès de Leurs Majestés avec toute sorte de raison et de bienséance, et avec l'applaudissement de tout le monde. Cependant, sur le point de mon retour, je vous puis assurer avec sincérité que je n'en ai nulle démangeaison, et que, si je croyais que ma demeure pour toute ma vie en ce lieu pût, en quelque façon, contribuer au service du roi et au bonheur de ses sujets, je l'y établirais avec plaisir, sans que personne m'en pût empêcher. Mais j'ose dire, sans aucune préoccupation et sans autre égard que celui du bien de l'État, que ma présence à la cour peut être encore plus utile, les mouvements présents continuant, que s'ils étaient apaisés, et je me flatte dans la créance que les intérêts de MM. les présidents, les vôtres et ceux de tout le parlement se rencontrent dans cette pensée.
«Pour ce qui est de nos forces, je vous assure qu'elles ne sont pas si peu considérables, que nous soyons en état de beaucoup appréhender les ennemis, et qu'elles augmenteront tous les jours, en sorte que je ne crois pas qu'il nous soit fort mal aisé de les empêcher de prendre des quartiers d'hiver en France. Si raccommodement se fait avec M. le duc d'Orléans, comme il y a grande apparence, tout ira à souhait, et, quand il y aurait des difficultés, je m'assure que Son Altesse Royale voyant le roi s'approcher de Paris en résolution d'y entrer, elle ne l'empêcherait pas du passer outre.[T.I pag.194]
«Par les avis que je reçois, je vois que la disposition de la ville de Paris est aussi bonne qu'elle a jamais été; que le roi est en état d'en profiter, et que tout le monde s'applique à la cour, afin que Sa Majesté le puisse faire avec une entière sûreté. Sur quoi j'ai écrit comme je devais, étant de votre avis qu'un semblable coup peut extrêmement contribuer à rétablir l'autorité du roi et mettre ses affaires en tel état, que, quand il sera contraint à continuer la guerre étrangère et domestique, ayant Paris de son côté, il en ait plus de moyen et de facilité.
«Je crois que ce que vous me dites de faire la réunion du parlement dans le Louvre est en cas qu'il ne se fit point d'accommodement. Car cela étant, il serait bien plus avantageux, et pour le roi, et pour vous autres, Messieurs[328], que les officiers qui sont à Paris sortissent pour tenir quelques séances à Pontoise. A quoi j'estime d'autant plus qu'ils consentiraient, que M. de Besançon m'a assuré de la part de M. de Nesmond que, si le roi les mandait pour aller à Saint-Germain, ils y obéiraient très-volontiers. Je lui ai fait réponse là-dessus que je ne me mêlais de rien; mais que, s'il avait quelque chose à proposer, il se devait adresser ou à vous ou à quelqu'un des ministres du roi.»
Cette lettre, destinée à être montrée aux membres du parlement siégeant à Pontoise, est loin d'exprimer toute la pensée de Mazarin: il glisse rapidement sur son désir de rentrer à Paris avec la cour, et il ne parle que de l'in[T.I pag.195]térêt public dans une circonstance où il était dirigé avant tout par son intérêt personnel. Quant à la disgrâce de l'abbé Fouquet, il s'en tait aussi bien que le procureur général, quoiqu'elle fut la véritable cause du ton de dignité offensée qu'on remarque dans la première partie de la lettre de ce dernier. Mazarin se borne à expliquer pourquoi il a dû soumettre la question de la paix au conseil du roi. Avec l'abbé Fouquet, le cardinal est beaucoup plus explicite: il ne craint pas d'aborder le point délicat. Il montre à son confident qu'il s'est trompé sur les dispositions de Condé et de madame de Châtillon; mais il conserve l'espoir qu'il pourra diriger, par l'intermédiaire de Goulas, une négociation séparée avec le duc d'Orléans et le déterminer à se retirer dans son apanage de Blois. Enfin Mazarin insiste sur son vif désir de rentrer à Paris avec le roi. «J'avais eu quelque chagrin, lui écrit-il, de ce que vous n'étiez plus retourné à Paris, et qu'on eût employé un autre que vous en la négociation avec Son Altesse Royale; mais je vois que les choses continuent toujours à se traiter par l'intelligence qui est entre votre frère et M. Goulas. Je m'assure que l'affaire ne changera point de face et que vous aurez l'un et l'autre la principale part à la conclusion, à laquelle il me semble que l'opiniâtreté de M. le Prince, la bonne intention de M. Goulas et beaucoup d'autres raisons contribuent extrêmement.
«J'attends cependant avec impatience des nouvelles de ce qui se devait dire en la conférence qui devait être faite, si l'accommodement se peut faire avec Son Altesse Royale en la manière que vous me l'écrivez, et qu'elle[T.I pag.196] demeure d'accord de s'en aller dans son apanage. C'est tout ce que nous saurions souhaiter, et ce serait un grand malheur s'il demeurait à Paris gouverné par M. le cardinal de Retz, M. de Châteauneuf et autres de cette cabale-là, puisque, par ce séjour, nous serions exposés aux mêmes inconvénients où l'on est tombé par le passé.
«Je vous remercie du conseil que vous me donnez de m'approcher, et du désir que vous témoignez que je sois en état de pouvoir accompagner le roi à Paris. Je vous avoue confidemment que c'est une chose que je souhaiterais, et pour la dignité de Leurs Majestés, et pour ma réputation, et pour l'avantage qu'en retireront messieurs du parlement de Paris qui est à Pontoise, par le concert avec lequel on agirait en toutes choses, et surtout par l'intelligence que j'aurais avec M. votre frère, duquel je ferai toujours une estime particulière, et je m'y fie à un tel point que je n'oublierai rien, afin qu'il soit toute ma vie un de mes plus intimes amis.
«Je fais donc état de partir un de ces jours pour aller à Sedan. Je ne m'avancerai pas plus avant, mais je me tiendrai prêt pour me rendre en diligence à la cour, aussitôt que l'on le jugera nécessaire, et comme vous avez bien pris d'autres peines pour moi, je m'assure que vous ne refuserez pas de prendre encore celle de m'écrire toujours quand vous aurez quelque chose d'important à me faire savoir sur ces sujets ou sur tel autre que ce puisse être.
«J'avais oublié de vous dire que je sais de source certaine que le cardinal de Retz est dans le dernier bien[T.I pag.197] avec M. de Lorraine, de façon que, s'il est vrai, comme tout le monde dit, que celui-ci ait tout pouvoir sur l'esprit de M. le Prince, il ne faut pas douter qu'il ne vienne à bout de seconder ledit cardinal, dans la pensée que, pendant que lui et M. le Prince tiendront la campagne avec les ennemis, ils auront Son Altesse Royale de leur côté, le laissant entre les mains du cardinal de Retz, qui paraît agir de concert en toutes choses avec madame de Chevreuse.»
Cette insinuation contre madame de Chevreuse, qui avait pendant quelque temps soutenu énergiquement Mazarin, n'est pas la seule que l'on trouve dans les lettres du cardinal. Les Mémoires de Retz parlent aussi de tentatives de rapprochement qui eurent lieu à cette époque entre lui et l'hôtel de Chevreuse[329]: mais il ajoute qu'il ne s'y prêta pas. Ce qui est certain, c'est que les pamphlets du temps signalèrent ce rapprochement des chefs de la vieille Fronde et la conformité de leur génie. Une des mazarinades, intitulée la Vérité, insiste sur ce point: «On examine la conduite de la duchesse de Chevreuse; on n'y rencontre jamais qu'une importune suite de souplesses qui s'engagent insensiblement l'une après l'autre, et dont elle ne se dégage jamais. On examine l'économie du cardinal de Retz, et la même confusion la rend désagréable. La première ne vit que par les tempêtes qu'elle a soulevées: point d'ordre, point de calme, point d'économie dans sa conduite. Le cardinal de Retz ne se brouille pas[T.I pag.198] moins. Sa conduite n'est autre chose qu'une suite de souplesses entrelacées les unes avec les autres; il ne finit jamais, parce que, en sortant d'un abîme, il tombe dans un autre. Il a l'intrigue inépuisable.»
L'abbé Fouquet, initié à tous les secrets de l'hôtel de Chevreuse, savait à quoi s'en tenir sur les avances que l'on faisait de ce côté au cardinal de Retz. On voulait amener Paul de Gondi à conclure un traité qui l'éloignât de Paris et du duc d'Orléans qu'il gouvernait. Ce qui inquiétait davantage l'abbé Fouquet, c'était le parti qui se formait à la cour contre lui, et qui déjà lui avait infligé une sorte de disgrâce. Un de ses amis, qui avait suivi le cardinal dans son exil, lui donna sur ce point d'utiles renseignements. Nous ne pouvons affirmer quel était cet ami qui garde l'anonyme. Il est probable cependant que c'était un des secrétaires intimes de Mazarin, Roussereau ou Roze. Le premier est peu connu; le second, qui devint après la mort de Mazarin, secrétaire de Louis XIV et qui tint la plume, comme on disait alors, avait un esprit piquant, libre et hardi pour un homme de cour. Il sut tenir tête aux Condé[330]. Je pense que la lettre suivante est de lui. Ce qui est certain, c'est qu'elle fait bien connaître la situation de l'abbé Fouquet à cette époque, les accusations de ses ennemis, les espérances ambitieuses qu'ils lui prêtaient, et l'estime qu'en faisait Mazarin.
«Je ne m'étais pas trompé, quand je vous ai écrit que vous ne manqueriez pas d'envieux qui tâcheraient de[T.I pag.199] censurer votre conduite pour vous discréditer. Diverses personnes de la cour ont écrit contre vous, vous accusant particulièrement d'être contraire à l'affaire de Paris[331], soit parce qu'on ne vous en avait pas donné part dans le commencement, ou parce que vous aviez si fort dans l'esprit l'accommodement de M. le Prince, par lequel même on marque que vous prétendiez vous élever à la pourpre, que vous ne pouviez goûter aucune autre voie que l'on voulût prendre pour avancer le service du roi. On a été jusqu'à dire que, quelque esprit qu'eût madame de Châtillon, ses yeux sont encore plus éloquents que sa bouche, et qu'il n'y a point de raisons qui ne cèdent à leur force. Enfin, ils concluaient que tout le monde connaissant à présent clairement que M. le Prince ne veut point de paix, la passion que vous témoigniez était une marque, ou de peu de clairvoyance, ou d'opiniâtreté, ou de préoccupation. Mais je vous puis assurer sans déguisement que tout ceci ne vous a point nui auprès du patron, et que vous y êtes mieux que jamais. Je vous supplie cependant de tenir ce que dessus secret, parce qu'il serait bien difficile, si vous en témoigniez quelque chose, qu'on ne se doutât que c'est moi qui vous en ai averti, M. le Tellier étant un de ceux qui vous a porté le plus de charité.
«Aussitôt que Son Éminence vit que l'on vous avait substitué M. d'Aligre, elle me témoigna en être fort fâchée. Je lui dis que, si on pouvait vous accuser de quelque[T.I pag.200] chose, ce ne saurait être que de n'avoir peut-être pas assez d'expérience pour les grandes affaires. Il me répliqua que vous aviez assez de capacité, et que vous étiez connu pour un homme d'honneur; que tout le monde, par cette raison, se fierait en vous, et que vous étiez plus propre qu'aucun autre à cette négociation, outre que Goulas étant un de vos amis, il serait plus aise de traiter avec vous qu'avec aucun autre; enfin, qu'en toutes façons, il ne faisait aucune comparaison de M. d'Aligre avec vous, et qu'il était marri de ce choix. Ce qu'il m'a encore confirmé ce matin dans son lit, et m'a chargé de vous le mander, ne voulant pas vous en écrire lui-même.
«Je vous supplie de nous faire retourner bientôt à Paris en quelque façon que ce soit, car ce n'est que là que je peux rétablir ma santé, qui est encore languissante. Il n'y a point de nouvelles de la cour dont je sois si curieux et si impatient, que de savoir comment je suis en l'honneur de votre bienveillance; car n'ayant reçu aucune marque de votre souvenir depuis votre départ, je ne sais point si vous ne m'avez point disgracié, quoique je sois plus que jamais votre très-humble serviteur.»
Les lettres de Mazarin à l'abbé Fouquet prouvent également qu'il avait conservé toute la confiance du cardinal. C'est à lui que Mazarin s'en remet du soin de gagner les Parisiens pour préparer sa rentrée dans la capitale en même temps qu'aura lien celle du roi. «Leurs Majestés, lui écrivait-il le 17 octobre, s'approchent de Paris avec un dessein formé d'y entrer. Je vois que[T.I pag.201] c'est une résolution prise et qui ne peut être que très-utile; mais je vous dirai confidemment que j'aurais souhaité pour la dignité du roi, pour l'intérêt même des Parisiens, pour celui du parlement qui est à Pontoise, et particulièrement des amis que j'ai dans cette compagnie, et pour ma propre réputation[332], que l'on eût fait en sorte que j'eusse eu l'honneur d'y accompagner Leurs Majestés. A quoi ce me semble on n'aurait pas trouvé d'obstacle. Si les choses étaient encore en cet état, comme je le crois, que cela se pût faire, je me promets que vous y contribueriez en tout ce qui dépendrait de vous pour me donner cette nouvelle marque de votre amitié.»
Mazarin n'obtint pas la satisfaction qu'il désirait si vivement; mais du moins la victoire du parti royaliste fut complète. Condé, abandonné depuis longtemps par le duc d'Orléans, avait quitté Paris en même temps que le duc de Lorraine (15 octobre). La cour était venue s'établir à Saint-Germain, où elle avait reçu des députations des bourgeois pour presser le roi de rentrer dans Paris. Déjà le maréchal de l'Hôpital avait été rétabli dans la dignité de gouverneur, et l'ancien prévôt des marchands, le conseiller Lefèvre, était rentré en fonctions (17-19 octobre). Cependant Mazarin, qui suivait les mouvements des partis et qui recevait sans cesse les avis les plus détaillés, était loin d'être sans inquiétude. La présence du cardinal de Retz à Paris et l'influence[T.I pag.202] qu'il exerçait sur le duc d'Orléans le préoccupaient vivement. «On m'assure, écrivait-il à l'abbé Fouquet (17 octobre), que madame de Chevreuse et le cardinal de Retz sont dans la meilleure intelligence; que beaucoup de personnes sont de cette intrigue, et qu'assurément il y a sur le tapis quelque chose qui doit bientôt éclater. Je vous prie de dire au fidèle[333] d'y prendre bien garde et de tâcher de pénétrer ce qui en est par le moyen qu'il a, puisqu'il n'y en peut avoir de meilleur[334]. C'est, à mon avis, la chose à laquelle on doit le plus s'appliquer dans l'état présent des affaires. Je vous prie d'en parler à la reine, et il serait bon aussi de savoir de la Palatine ce que le cardinal de Retz se promet[335]. On dit qu'il est raccommodé avec M. le Prince par le moyen du duc de Lorraine, et que tous les deux contribuent à le rendre maître de l'esprit de Son Altesse Royale. Je ne le crois pas tout à fait; mais on doit tout appréhender du naturel des gens à qui nous avons affaire.»
Ce qui paraît certain, au milieu des intrigues compliquées de cette époque, c'est que Retz ne négligea rien pour s'emparer de l'esprit du duc d'Orléans[336] et lui inspirer des résolutions énergiques. Tout ce qu'il put obtenir du prince fut de rester au Luxembourg et d'y at[T.I pag.203]tendre l'arrivée du roi. Gaston, qui avait eu un si triste rôle pendant la Fronde, ne pouvait compter ni sur le peuple ni sur l'armée. A la première injonction, il se retira à Blois. Louis XIV fit son entrée à Paris le 21 octobre au milieu des acclamations qui saluaient le retour de l'ordre et de la paix, après avoir trop souvent retenti en l'honneur des factions et même des armées étrangères[337]. Le lendemain, le roi tint au Louvre un lit de justice et fit lire quatre déclarations. Par la première, il accordait l'amnistie; la seconde rétablissait le parlement à Paris; la troisième exilait un certain nombre de frondeurs et défendait au parlement de se mêler des affaires publiques. Enfin, par la quatrième, le roi instituait une chambre des vacations.[T.I pag.204]